Pourquoi
lire les apocryphes ?
Pourquoi lire les apocryphes aujourd’hui ? Non pas d'abord
pour y découvrir un enseignement qui aurait été occulté par l'Eglise
officielle, ni pour recueillir des informations historiques dont nous ne
disposerions plus. L'intérêt indéniable de ces textes est ailleurs : reflets
des représentations, parfois étranges, que les chrétiens se sont faites de la
figure de Jésus, du rôle des apôtres, de l'origine des Eglises locales, les
apocryphes offrent un éclairage passionnant sur la vie et les croyances
diversifiées des premières communautés chrétiennes. A ce titre, et à ce
titre seulement, ils méritent d'être lus.
Certains peuvent être considérés comme rapportant des faits
authentiques, mais mêlés à des imaginations plus ou moins naïves. D’autres
évangiles apocryphes, en revanche, déforment profondément la vie et l’enseignement
du Christ, pour les faire coïncider avec les idées de groupes extérieurs à l’Église.
C’est le cas des évangiles dits « gnostiques », qui furent
rédigés autour du troisième et du quatrième siècles. La caractéristique
des évangiles gnostiques est qu’ils prétendent rapporter la doctrine
« secrète de Jésus », transmise seulement à quelques initiés, et
donc en marge de l’enseignement « public » du Christ.
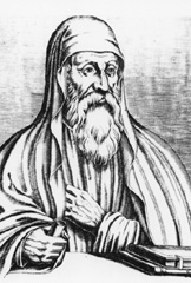 Origène
donne un témoignage très clair sur la façon dont les chrétiens ont voulu,
dès le début, protéger les évangiles authentiques contre les falsifications
des apocryphes : « Au temps du Nouveau Testament, beaucoup ont essayé d’écrire
des évangiles, mais tous n’ont pas été acceptés… L’Église possède
quatre évangiles ; les hérétiques, un très grand nombre… Ainsi
beaucoup ont essayé d’écrire, mais quatre évangiles seulement sont
approuvés ; et c’est d’eux que l’on doit tirer, pour le mettre en
lumière, ce qu’il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je
sais qu’il existe un évangile que l’on appelle selon Thomas et un autre
selon Matthias ; et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir
l’air d’être des ignorants à cause de ceux qui s’imaginent savoir
quelque chose, quand ils connaissent ces textes. Mais, en tout cela, nous n’approuvons
rien sinon ce qu’approuve l’Église : on doit admettre quatre
évangiles seulement ». Origène distingue donc deux groupes de livres : celui des
apocryphes, qu’il considère comme utiles, mais que l’on doit utiliser avec
beaucoup de précaution ; et celui des livres scripturaires qui comprennent
la Bible
hébraïque et les deutérocanoniques, même si ces derniers ne sont pas lus
par l’Église et ne font pas, non plus, l’objet de commentaires. Ainsi, aux
origines, certains Pères de l'Eglise lisent les apocryphes, mais à leur suite
une génération de théologiens, conduits au départ par Jérôme, seront des
pourfendeurs d'apocryphes. Puis au Moyen-âge, avec la légende dorée, avec la
multiplication des manuscrits, on verra des gens tout à fait partagés sur la
place à donner à ces textes. Plus tard encore la discussion reprendra avec
la Réforme
, pour savoir si, oui ou non, on peut faire quelque chose de la littérature
apocryphe. Aujourd'hui la discussion se poursuit, aidée maintenant par tout un
travail d'analyse historique.
Origène
donne un témoignage très clair sur la façon dont les chrétiens ont voulu,
dès le début, protéger les évangiles authentiques contre les falsifications
des apocryphes : « Au temps du Nouveau Testament, beaucoup ont essayé d’écrire
des évangiles, mais tous n’ont pas été acceptés… L’Église possède
quatre évangiles ; les hérétiques, un très grand nombre… Ainsi
beaucoup ont essayé d’écrire, mais quatre évangiles seulement sont
approuvés ; et c’est d’eux que l’on doit tirer, pour le mettre en
lumière, ce qu’il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je
sais qu’il existe un évangile que l’on appelle selon Thomas et un autre
selon Matthias ; et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir
l’air d’être des ignorants à cause de ceux qui s’imaginent savoir
quelque chose, quand ils connaissent ces textes. Mais, en tout cela, nous n’approuvons
rien sinon ce qu’approuve l’Église : on doit admettre quatre
évangiles seulement ». Origène distingue donc deux groupes de livres : celui des
apocryphes, qu’il considère comme utiles, mais que l’on doit utiliser avec
beaucoup de précaution ; et celui des livres scripturaires qui comprennent
la Bible
hébraïque et les deutérocanoniques, même si ces derniers ne sont pas lus
par l’Église et ne font pas, non plus, l’objet de commentaires. Ainsi, aux
origines, certains Pères de l'Eglise lisent les apocryphes, mais à leur suite
une génération de théologiens, conduits au départ par Jérôme, seront des
pourfendeurs d'apocryphes. Puis au Moyen-âge, avec la légende dorée, avec la
multiplication des manuscrits, on verra des gens tout à fait partagés sur la
place à donner à ces textes. Plus tard encore la discussion reprendra avec
la Réforme
, pour savoir si, oui ou non, on peut faire quelque chose de la littérature
apocryphe. Aujourd'hui la discussion se poursuit, aidée maintenant par tout un
travail d'analyse historique.
 Il
est faux de faire du Concile œcuménique de Nicée
(20 mai-25 juillet 325) l’organe qui a constitué le canon du
Nouveau Testament : non seulement Constantin n’a jamais fait rédiger
aucun évangile, mais le canon est le fruit d’un long travail de sélection
que mena l’Eglise à partir du deuxième siècle et qui s’acheva avec le
Concile de Carthage (397). A Nicée, ce furent de toutes autres questions qui
occupèrent les esprits, en particulier celle de l’arianisme, théorie
relative à la divinité du Christ et qui fut alors déclarée hérétique.
Il
est faux de faire du Concile œcuménique de Nicée
(20 mai-25 juillet 325) l’organe qui a constitué le canon du
Nouveau Testament : non seulement Constantin n’a jamais fait rédiger
aucun évangile, mais le canon est le fruit d’un long travail de sélection
que mena l’Eglise à partir du deuxième siècle et qui s’acheva avec le
Concile de Carthage (397). A Nicée, ce furent de toutes autres questions qui
occupèrent les esprits, en particulier celle de l’arianisme, théorie
relative à la divinité du Christ et qui fut alors déclarée hérétique.
Constantin siège parmi les évêques, comme s’il était l’un d’entre
eux. Il se pose en gardien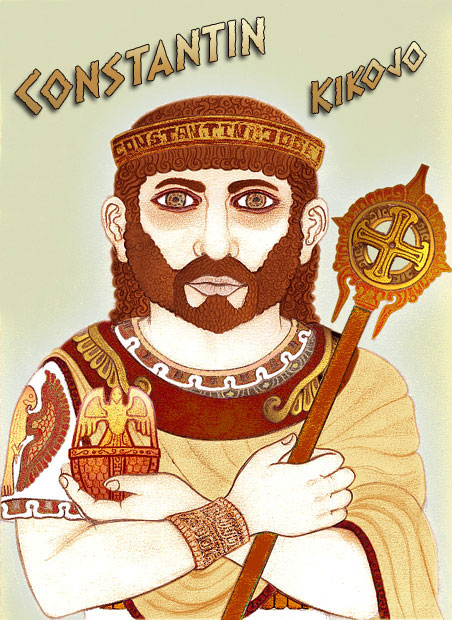 attitré du dogme et de la discipline.
Il intervient dans toutes les affaires de l’Église, légiférant et jugeant
pour elle, souvent à l'appel de chrétiens eux-mêmes, l’organisant et la
dirigeant, dictant les formules de foi. Dans son organisation et son
fonctionnement l'Église a besoin de l'empereur. Le pouvoir assure le bon ordre
des réunions souvent houleuses, tant les questions christologiques soulèvent
les passions. Les décisions conciliaires sont appuyées par des lois
impériales. Constantin affirme : « la providence
divine agit de concert avec moi ». Ses décisions sont sacralisées, les
décisions religieuses relèvent de son autorité. Il s'entoure d'un faste
incroyable pour exalter la grandeur de la fonction impériale. Désormais la
romanité et la religion chrétienne sont liées. L'empereur reçoit la mission
de guide de la foi chrétienne. Son intervention grandissante dans les questions
religieuses se trouve ainsi légitimée ainsi que le césaropapisme. On dit parfois que Constantin aurait déterminé le canon des livres reconnus ; en fait, il ne s’en est
jamais occupé : une liste consacrant les quatre évangiles et la plupart
des autres livres du Nouveau Testament existait dès 180. À l’époque de
Constantin, le texte actuel du Nouveau Testament était reconnu comme fidèle à
l’enseignement des apôtres depuis au moins deux siècles. La moindre
altération du message aurait été vivement rejetée par les milliers de
chrétiens déjà répandus dans tout l’Empire. En outre, le texte du Nouveau
Testament circulait déjà dans d’innombrables copies, traitées avec
vénération par les communautés chrétiennes : il est inimaginable que
ces textes aient pu être détruits, ou même altérés, sur les ordres de l’empereur
romain. Il est donc faux de penser que Constantin aurait fait modifier
la Bible
, comme il est erroné de penser qu’il aurait constitué le christianisme
comme religion officielle de l’empire en 325, ce qui en fait sera l’œuvre
de Théodose en 385.
attitré du dogme et de la discipline.
Il intervient dans toutes les affaires de l’Église, légiférant et jugeant
pour elle, souvent à l'appel de chrétiens eux-mêmes, l’organisant et la
dirigeant, dictant les formules de foi. Dans son organisation et son
fonctionnement l'Église a besoin de l'empereur. Le pouvoir assure le bon ordre
des réunions souvent houleuses, tant les questions christologiques soulèvent
les passions. Les décisions conciliaires sont appuyées par des lois
impériales. Constantin affirme : « la providence
divine agit de concert avec moi ». Ses décisions sont sacralisées, les
décisions religieuses relèvent de son autorité. Il s'entoure d'un faste
incroyable pour exalter la grandeur de la fonction impériale. Désormais la
romanité et la religion chrétienne sont liées. L'empereur reçoit la mission
de guide de la foi chrétienne. Son intervention grandissante dans les questions
religieuses se trouve ainsi légitimée ainsi que le césaropapisme. On dit parfois que Constantin aurait déterminé le canon des livres reconnus ; en fait, il ne s’en est
jamais occupé : une liste consacrant les quatre évangiles et la plupart
des autres livres du Nouveau Testament existait dès 180. À l’époque de
Constantin, le texte actuel du Nouveau Testament était reconnu comme fidèle à
l’enseignement des apôtres depuis au moins deux siècles. La moindre
altération du message aurait été vivement rejetée par les milliers de
chrétiens déjà répandus dans tout l’Empire. En outre, le texte du Nouveau
Testament circulait déjà dans d’innombrables copies, traitées avec
vénération par les communautés chrétiennes : il est inimaginable que
ces textes aient pu être détruits, ou même altérés, sur les ordres de l’empereur
romain. Il est donc faux de penser que Constantin aurait fait modifier
la Bible
, comme il est erroné de penser qu’il aurait constitué le christianisme
comme religion officielle de l’empire en 325, ce qui en fait sera l’œuvre
de Théodose en 385.
L'idée donnée par l'Eglise elle-même de sa propre histoire n'est
peut-être pas conforme à la réalité historique. On serait, selon la
tradition, parti de l'unité en Jésus-Christ, de la première communauté
chrétienne et il y aurait eu ensuite des dégradations, des disputes, des
divisions, des hérésies. Or, il apparaît de plus en plus, aux yeux des
historiens, que la réalité de départ c'est la diversité et que l'unité
n'est venue qu'ensuite. Elle s'est faite après, à coup d'accusations,
d'exclusions, de tri, et de discussions théologiques de haut niveau…
C’est ainsi que, dans leur multiplicité, leur diversité et leur
foisonnement, les textes apocryphes sont les témoins de l'immense variété des
traditions nées avec le Christianisme. Mais il ne s’agit pas simplement d’un
aspect « folklorique » ou anecdotique. Aux traditions qui touchaient
à des problèmes théologiques de fond des réponses ont été tentées et
elles étaient très diverses. Certaines furent retenues comme
« orthodoxes » par la grande Eglise, et les autres perdurèrent au
travers des apocryphes. La « grande Eglise », s’est formée au
deuxième siècle sous l'égide de Pierre et Paul, en affichant l'image des
Douze et en se réclamant de la tradition qu’ils véhiculaient.
Les communautés marginales, qui échappaient à l'orthodoxie naissante vont être contraintes
d’exploiter des figures secondaires des Evangiles qui deviennent des figures pour permettre à ces chrétientés d’afficher
leur compréhension du message tout en l'enracinant dans l'histoire de Jésus.
En luttant contre ce qu'elle estimait être des hérésies, la grande Eglise va
non seulement lutter contre ces théologies déviantes, mais elle va refuser la
place éminente qu'accordaient aux femmes ces groupes marginaux. Et le cercle
vicieux est amorcé : plus l'Eglise va se crisper sur des figures masculines,
plus les chrétientés marginales vont mettre en avant des figures féminines,
qui seront à leur tour combattues par l'orthodoxie.
 D'où
la fortune de Marie-Madeleine, Marie de Magdala... qui
est la femme la plus célèbre du Nouveau Testament. Elle deviendra
l'inspiratrice de nombreuses communautés dès le deuxième siècle. Sa
célébrité ne faiblira pas durant le Moyen Age et connaîtra une période de
grâce dans la piété populaire au dix-septième et dix-huitième siècles. Ce
qui lui vaut cet honneur, c'est qu'elle fait partie du groupe des femmes qui ont
suivi Jésus au Calvaire et ont été témoins de sa crucifixion. Ce statut
justifie qu'elle ait pu avoir une relation affective particulière avec Jésus. Elle est devenue la figure de proue pour les gnostiques qui en
appellent à la rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus ressuscité. Selon
eux, Jésus aurait donné à Marie-Madeleine un enseignement privilégié, qui a
été refusé aux premiers disciples. Mais il s'agit, comme souvent chez les
apocryphes, d'une construction narrative visant à légitimer l'enseignement de
ces traditions particulières. L'Evangile de Pierre, au deuxième siècle, la qualifie également de « disciple
du Seigneur ».
D'où
la fortune de Marie-Madeleine, Marie de Magdala... qui
est la femme la plus célèbre du Nouveau Testament. Elle deviendra
l'inspiratrice de nombreuses communautés dès le deuxième siècle. Sa
célébrité ne faiblira pas durant le Moyen Age et connaîtra une période de
grâce dans la piété populaire au dix-septième et dix-huitième siècles. Ce
qui lui vaut cet honneur, c'est qu'elle fait partie du groupe des femmes qui ont
suivi Jésus au Calvaire et ont été témoins de sa crucifixion. Ce statut
justifie qu'elle ait pu avoir une relation affective particulière avec Jésus. Elle est devenue la figure de proue pour les gnostiques qui en
appellent à la rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus ressuscité. Selon
eux, Jésus aurait donné à Marie-Madeleine un enseignement privilégié, qui a
été refusé aux premiers disciples. Mais il s'agit, comme souvent chez les
apocryphes, d'une construction narrative visant à légitimer l'enseignement de
ces traditions particulières. L'Evangile de Pierre, au deuxième siècle, la qualifie également de « disciple
du Seigneur ».
En
fait, aucun, parmi ces évangiles dits « apocryphes », c’est-à-dire
« non intégrés par l’Eglise dans la liste officielle de ses Saintes
Ecritures », ne contredit les données des écrits canoniques. Ces
évangiles apocryphes n’apportent aucune révélation explosive, ni même
aucun fait historique sur la vie de Jésus que nous ne
connaissions déjà. On a plutôt l’impression, en les
lisant, d’assister aux efforts de chrétiens pour combler, par des détails
imaginaires et tirant sur le merveilleux, les silences des évangiles
canoniques... Même si l’intention semblait louable, l’Eglise a préféré s’en
tenir à la sobriété des évangiles, et on ne saurait le lui reprocher. On
ne peut donc éviter de se poser la question du rapport entre le canon et les
apocryphes.
Mais avant de poursuivre sur les textes apocryphes, il faut
également mentionner qu’il existe des textes chrétiens, reconnus par l’Eglise
officielle, mais qui ne font pas partie du canon proprement dit, tout en
remontant aux débuts de l’histoire de l’Eglise… ce sont des livres
chrétiens non-canoniques, parmi lesquels on peut citer :
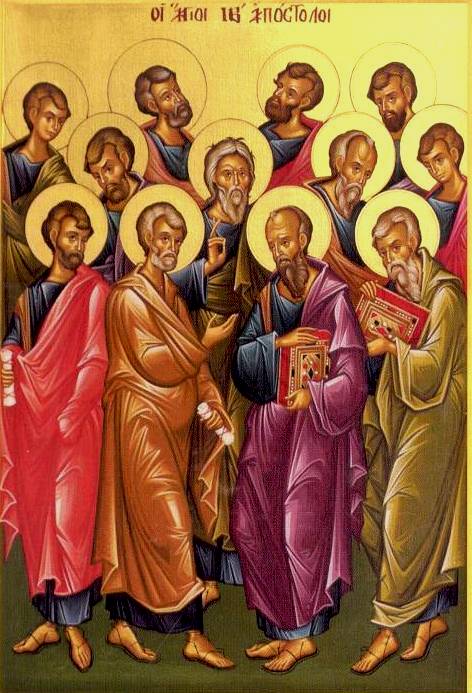
L'épître de Clément de Rome à l'Eglise de Corinthe,
La Didaché ou Enseignement des douze apôtres est un recueil de préceptes de
morale chrétienne et d'instructions sur le baptême, la cène et les pasteurs.
L'épître de Barnabas a quelques points communs avec l'épître aux Hébreux.
Le Pasteur d'Hermas, frère de l'évêque Pie de Rome. C'est une sorte d'Apocalypse.
L'Apocalypse de Pierre contient deux visions, l'une du ciel, l'autre de l'enfer.
Ces livres jouissaient d'une haute estime dans certaines Eglises au
moins, puisque des auteurs chrétiens du deuxième ou du troisième siècles les
classent dans l'Ecriture Sainte. Parmi les autres ouvrages du deuxième siècle
qui ont exercé une grande influence dans l'Eglise, on peut citer les épîtres
d'Ignace  d'Antioche, celle de Polycarpe, évêque de Smyrne, les apologies de
Justin, etc...
d'Antioche, celle de Polycarpe, évêque de Smyrne, les apologies de
Justin, etc...
On
sait, par des citations d’auteurs anciens, que d'autres évangiles ont été
écrits, outre ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'un d'entre eux,
« l'Evangile selon Thomas »,
est maintenant connu, car on en a trouvé une copie, dans une traduction copte,
en 1946 en Egypte. Il s'agit d'un recueil de paroles de Jésus, dont une partie
reproduit des passages des Evangiles, alors qu'ailleurs ce sont des Evangiles
apocryphes qui sont cités (Evangile selon les Hébreux, par exemple) ;
cependant certaines paroles de Jésus sont inédites. Cet
« évangile de Thomas » ne contient pas une histoire de Jésus et il
n’y a pas un seul récit de miracles. C’est une collection de cent quatorze
logia ou « paroles nues » attribuées au Maître, le Doux, le Vivant. L’Evangile
selon Thomas commence ainsi : « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu’a écrites Didyme Jude Thomas. Et celui qui trouvera l’interprétation de ces paroles ne
goûtera point la mort ». Ces paroles ne sont pas bavardes mais posent de nombreuses énigmes ; ce
sont de petites phrases qui semblent manquer de sens mais qui, si on les laisse
pénétrer, peuvent interpeller.
Cet
Evangile de Thomas, qui contient des paroles attribuées à Jésus, contredit à
plusieurs reprises les autres textes du Nouveau Testament. La parole 114 est
carrément misogyne : « Simon Pierre leur dit : Que Marie sorte
du milieu de nous car les femmes ne sont pas dignes de
la Vie. Jésus
dit : Voici que je la guiderai afin de la faire mâle, pour qu’elle
devienne, elle aussi, un esprit vivant semblable à vous, mâles. Car toute
femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux ». La parole 77 est
panthéiste : « Jésus a dit : je suis la lumière qui est sur
eux tous. Je suis le Tout : le Tout est sorti de moi, et le Tout est
arrivé à moi. Fendez du bois : je suis là ; levez la pierre et vous
me trouverez là ». De nombreuses autres paroles, en revanche, sont des
citations directes des Evangiles canoniques, souvent sorties de leur contexte,
preuve qu’elles sont reprises et non antérieures aux Evangiles canoniques.
Les
apocryphes du Nouveau Testament diffèrent et ressemblent à la fois aux écrits
du Nouveau Testament. Ils diffèrent quant à la hauteur de vue,
quant à l’étendue des informations.
Ils ressemblent quant à certaines paroles de Jésus.
Ils ressemblent en tant que copies : Evangiles, Actes, Apocalypses, noms d’apôtres,
style littéraire oriental… Pour faire bref, les apocryphes du Nouveau
Testament sont intéressants pour la curiosité, mais n’apportent rien de
nouveau, rien de spirituel et rien de fiable, ils n’ajoutent ni ne retranchent
rien aux croyances cardinales du christianisme.
Certains
de ces évangiles sont connus depuis longtemps et ont exercé une influence sur
la représentation chrétienne de Marie. C’est, par exemple, le cas du
Protévangile de Jacques, datant probablement du milieu du deuxième siècle,
qui parle de Joachim et Anne, les parents  de Marie, et qui nous fait le récit d’une
présentation de Marie au temple. C’est le cas du Transitus Mariae, qui
raconte l’assomption de Marie, contribuant à faire de la mère de Jésus
une personne plus importante que dans le Nouveau Testament où elle est peu
présente.
de Marie, et qui nous fait le récit d’une
présentation de Marie au temple. C’est le cas du Transitus Mariae, qui
raconte l’assomption de Marie, contribuant à faire de la mère de Jésus
une personne plus importante que dans le Nouveau Testament où elle est peu
présente.
Néanmoins,
les Evangiles dits apocryphes se démarquent des textes apostoliques sur
plusieurs points : ils répondent à la curiosité humaine en inventant les
histoires que les Evangiles n’ont pas traitées
; ils contiennent des notions théologiques tardives ;
ils contiennent des notions parfois contraires au Nouveau Testament ; ils
sont pseudépigraphiques, c’est-à-dire faussement attribués à un auteur
connu.
Les
apocryphes du Nouveau Testament imitent le style du Nouveau Testament et se
regroupent sous quatre formes : les Evangiles, les Actes, les Epitres et
les Apocalypses.
Trois thèmes prédominent : l’histoire de Marie et de Joseph, l’enfance
de Jésus et l’histoire de Pilate. Les plus connus sont l’évangile selon
Jacques, l’évangile selon Nicodème (ou Les Actes de Pilate), l’évangile
selon Pierre.
Dans ce dernier, Jésus semble ne pas souffrir et il ne meurt pas mais est
enlevé. Cela correspond au docétisme
gnostique qui enseignait que Jésus n’était pas vraiment humain et n’avait
qu’une apparence humaine.
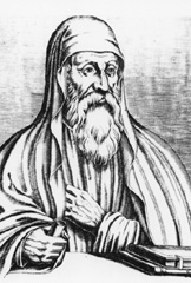 Origène
donne un témoignage très clair sur la façon dont les chrétiens ont voulu,
dès le début, protéger les évangiles authentiques contre les falsifications
des apocryphes : « Au temps du Nouveau Testament, beaucoup ont essayé d’écrire
des évangiles, mais tous n’ont pas été acceptés… L’Église possède
quatre évangiles ; les hérétiques, un très grand nombre… Ainsi
beaucoup ont essayé d’écrire, mais quatre évangiles seulement sont
approuvés ; et c’est d’eux que l’on doit tirer, pour le mettre en
lumière, ce qu’il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je
sais qu’il existe un évangile que l’on appelle selon Thomas et un autre
selon Matthias ; et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir
l’air d’être des ignorants à cause de ceux qui s’imaginent savoir
quelque chose, quand ils connaissent ces textes. Mais, en tout cela, nous n’approuvons
rien sinon ce qu’approuve l’Église : on doit admettre quatre
évangiles seulement »[2]. Origène distingue donc deux groupes de livres : celui des
apocryphes, qu’il considère comme utiles, mais que l’on doit utiliser avec
beaucoup de précaution ; et celui des livres scripturaires qui comprennent
Origène
donne un témoignage très clair sur la façon dont les chrétiens ont voulu,
dès le début, protéger les évangiles authentiques contre les falsifications
des apocryphes : « Au temps du Nouveau Testament, beaucoup ont essayé d’écrire
des évangiles, mais tous n’ont pas été acceptés… L’Église possède
quatre évangiles ; les hérétiques, un très grand nombre… Ainsi
beaucoup ont essayé d’écrire, mais quatre évangiles seulement sont
approuvés ; et c’est d’eux que l’on doit tirer, pour le mettre en
lumière, ce qu’il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je
sais qu’il existe un évangile que l’on appelle selon Thomas et un autre
selon Matthias ; et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir
l’air d’être des ignorants à cause de ceux qui s’imaginent savoir
quelque chose, quand ils connaissent ces textes. Mais, en tout cela, nous n’approuvons
rien sinon ce qu’approuve l’Église : on doit admettre quatre
évangiles seulement »[2]. Origène distingue donc deux groupes de livres : celui des
apocryphes, qu’il considère comme utiles, mais que l’on doit utiliser avec
beaucoup de précaution ; et celui des livres scripturaires qui comprennent  Il
est faux de faire du Concile œcuménique
Il
est faux de faire du Concile œcuménique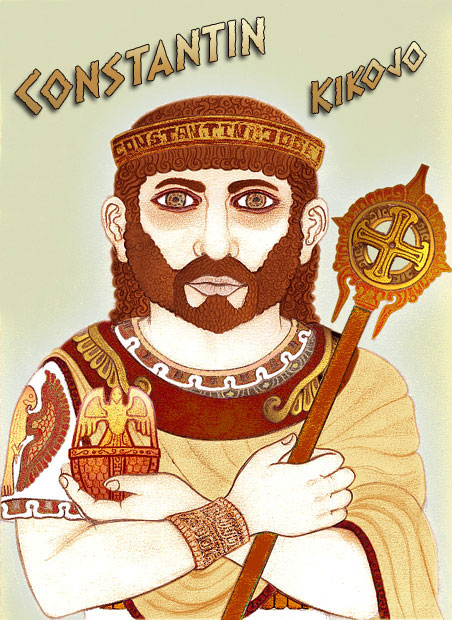 attitré du
attitré du  D'où
la fortune de Marie-Madeleine, Marie de Magdala...
D'où
la fortune de Marie-Madeleine, Marie de Magdala... 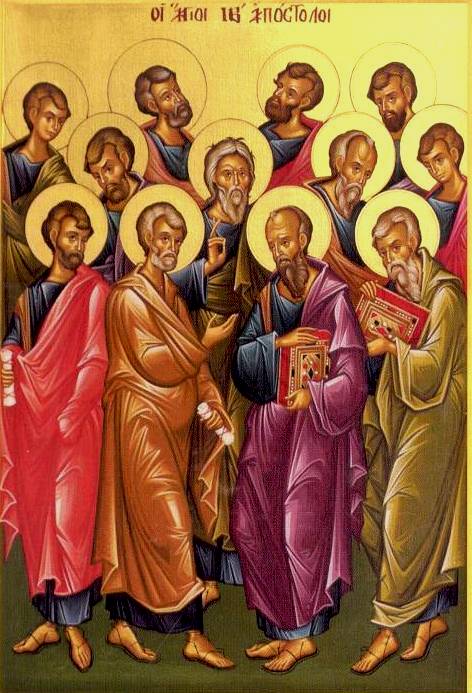
 d'Antioche, celle de Polycarpe, évêque de Smyrne, les apologies de
Justin, etc...
d'Antioche, celle de Polycarpe, évêque de Smyrne, les apologies de
Justin, etc...  de Marie, et qui nous fait le récit d’une
présentation de Marie au temple. C’est le cas du Transitus Mariae, qui
raconte l’assomption de Marie, contribuant à faire de la mère de Jésus
de Marie, et qui nous fait le récit d’une
présentation de Marie au temple. C’est le cas du Transitus Mariae, qui
raconte l’assomption de Marie, contribuant à faire de la mère de Jésus