En
guise de conclusion…
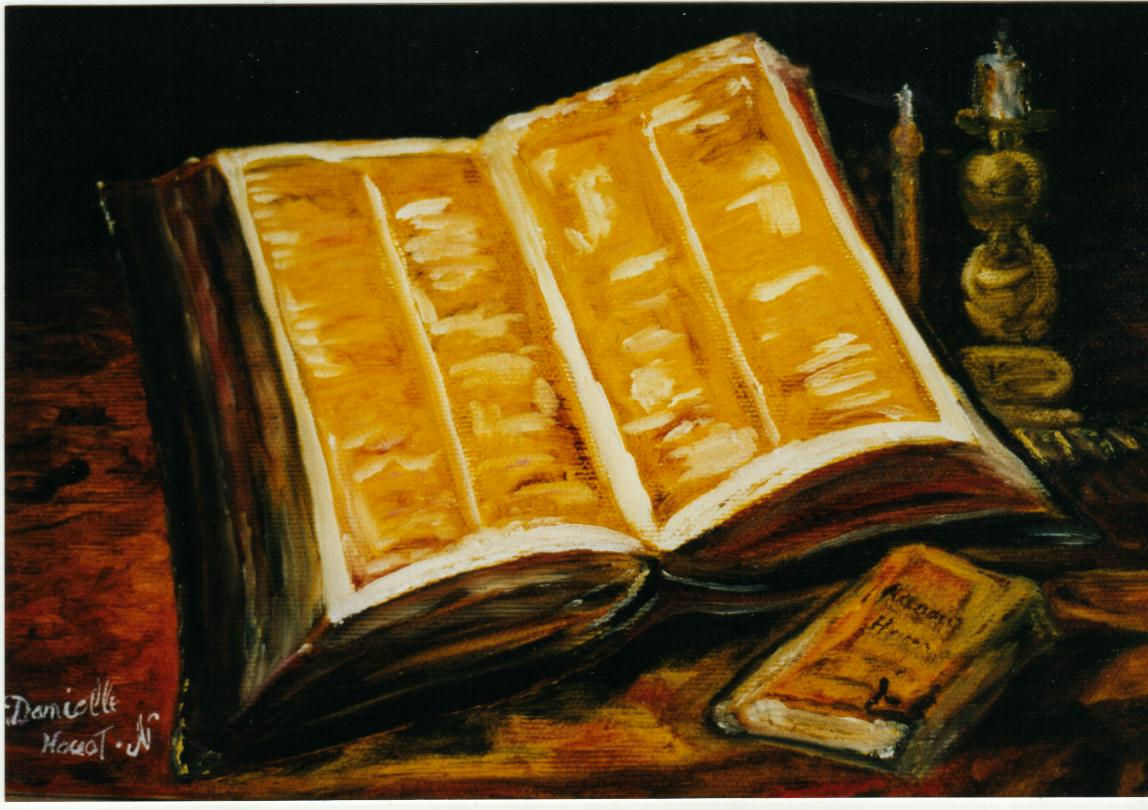 La Bible chrétienne est le résultat d’un long processus de sélection
des textes. S’il était déjà bien avancé dans les premiers siècles, il ne
s’est achevé que tardivement : il faut attendre le seizième siècle pour que
les catholiques disposent d’un inventaire des livres de la Bible faisant
autorité, le dix-septième siècle pour les orthodoxes et ce n’est qu’au
dix-neuvième siècle que le contenu de la Bible protestante sera véritablement
stabilisé. « Evangile » est un terme issu du grec « euaggelion »,
signifiant « bonne nouvelle ». Les évangiles
rapportent la « bonne
La Bible chrétienne est le résultat d’un long processus de sélection
des textes. S’il était déjà bien avancé dans les premiers siècles, il ne
s’est achevé que tardivement : il faut attendre le seizième siècle pour que
les catholiques disposent d’un inventaire des livres de la Bible faisant
autorité, le dix-septième siècle pour les orthodoxes et ce n’est qu’au
dix-neuvième siècle que le contenu de la Bible protestante sera véritablement
stabilisé. « Evangile » est un terme issu du grec « euaggelion »,
signifiant « bonne nouvelle ». Les évangiles
rapportent la « bonne nouvelle » que constitue la venue de Jésus. Ces écrits
relatent la vie et l'enseignement du Christ, par ceux qui sont considérés
comme des témoins directs de ses faits et gestes. Le
christianisme, dès ses origines, se présente pourtant sous la forme d'un
ensemble de communautés étonnamment diverses. Ainsi, loin d'offrir une
image unifiée de la religion chrétienne, les apocryphes introduisent à sa
diversité doctrinale, mais aussi mythologique et linguistique.
nouvelle » que constitue la venue de Jésus. Ces écrits
relatent la vie et l'enseignement du Christ, par ceux qui sont considérés
comme des témoins directs de ses faits et gestes. Le
christianisme, dès ses origines, se présente pourtant sous la forme d'un
ensemble de communautés étonnamment diverses. Ainsi, loin d'offrir une
image unifiée de la religion chrétienne, les apocryphes introduisent à sa
diversité doctrinale, mais aussi mythologique et linguistique.
A
qui se plonge dans la littérature apocryphe, ces œuvres peuvent réserver une
cruelle déception. Certains apocryphes prétendent apprendre au lecteur des
faits sur Jésus : l'un rapporte un enseignement ésotérique qu'il aurait
confié à un disciple particulier, un autre transcrit le récit que deux
ressuscités auraient fait de sa visite aux enfers… S'il ne faut pas attendre
des apocryphes la découverte de secrets ou de révélations cachées sur Jésus
et ses disciples,
ils permettent de se faire une idée sur les représentations que les chrétiens
de divers lieux et de divers temps se sont faites de la figure de Jésus... Ils
témoignent de leurs questions et des réponses qu'ils ont données sur la
nature du Christ, sur les liens du christianisme avec le judaïsme et la culture
romaine.
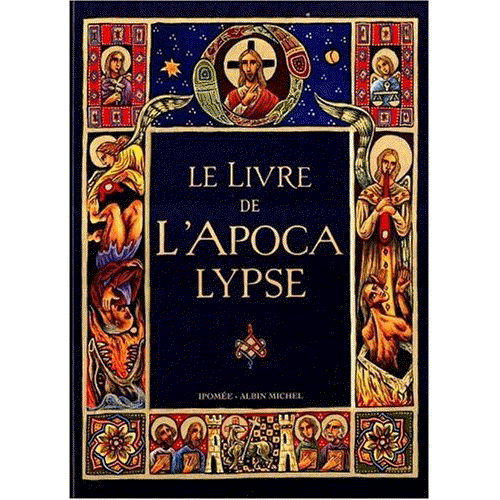 Au
sein de l'extraordinaire foisonnement de textes, le choix de l'Église ancienne
fut difficile. L'Apocalypse de Jean a bien failli ne pas être retenue
dans le canon. Quant au Pasteur d'Hermas, il a manqué de peu d'y entrer.
Il n'y a aucune différence intrinsèque entre écrits canoniques et apocryphes.
Le Nouveau Testament résulte du choix que les autorités ecclésiastiques ont
opéré parmi des dizaines de textes pour fixer un corpus de référence.
D'autres œuvres, non retenues, continuèrent à alimenter la piété, au point
d’être à la source de traditions encore vivaces. Ces textes ont traversé l’histoire
de la pensée et de la foi chrétienne depuis leur rédaction, recueillant les
traditions orales des premières communautés chrétiennes. Ils témoignent de
la forte impression produite sur la conscience des fidèles par l’événement
qui venait de se produire et dont ils étaient presque les contemporains.
Au
sein de l'extraordinaire foisonnement de textes, le choix de l'Église ancienne
fut difficile. L'Apocalypse de Jean a bien failli ne pas être retenue
dans le canon. Quant au Pasteur d'Hermas, il a manqué de peu d'y entrer.
Il n'y a aucune différence intrinsèque entre écrits canoniques et apocryphes.
Le Nouveau Testament résulte du choix que les autorités ecclésiastiques ont
opéré parmi des dizaines de textes pour fixer un corpus de référence.
D'autres œuvres, non retenues, continuèrent à alimenter la piété, au point
d’être à la source de traditions encore vivaces. Ces textes ont traversé l’histoire
de la pensée et de la foi chrétienne depuis leur rédaction, recueillant les
traditions orales des premières communautés chrétiennes. Ils témoignent de
la forte impression produite sur la conscience des fidèles par l’événement
qui venait de se produire et dont ils étaient presque les contemporains.
Oublier
les apocryphes équivaudrait à nier tout un pan de la culture occidentale,
aussi bien dans l’iconographie
que dans la littérature.
Ces textes sont une partie intégrante de la mémoire collective, alors que nos
contemporains sont obligés de reconnaître de plus en plus de lacunes dans la
connaissance qu’ils peuvent avoir de l’histoire religieuse.
Il
ne faut pas attendre de ces Evangiles beaucoup d’informations
historiographiques,
mais leur existence en marge des livres sacrés oblige à demander pourquoi
avoir introduit dans le corpus biblique, certains écrits et en avoir écarté d’autres.
Dans les textes considérés comme apocryphes, la pensée n’est pas
cristallisée, les événements n’ont pas l’architecture des évangiles
canoniques. Ils dépassent la mesure ; tout y est plus abrupt, plus
élémentaire ; les traits sont grossis… Ils ne sont pas l’œuvre de théologiens
savants. Plusieurs, parmi ces livres, ont été reconnus par l’Eglise, comme
inspirés, mais ils n’ont jamais bénéficié du crédit des textes que le
christianisme a intronisés comme Ecriture sainte. Certains pensent qu’il faut
que les fidèles les lisent, car ils sont très importants pour comprendre les
enjeux
religieux et idéologiques des premiers siècles. D’autres affirment le
contraire… même si la franchise très directe du Nouveau Testament apocryphe
soutient la discrétion réfléchie du Nouveau Testament canonique. Pour parler
à l’intelligence comme le font les canoniques, il fallait que les apocryphes
puissent s’adresser à l’imagination.
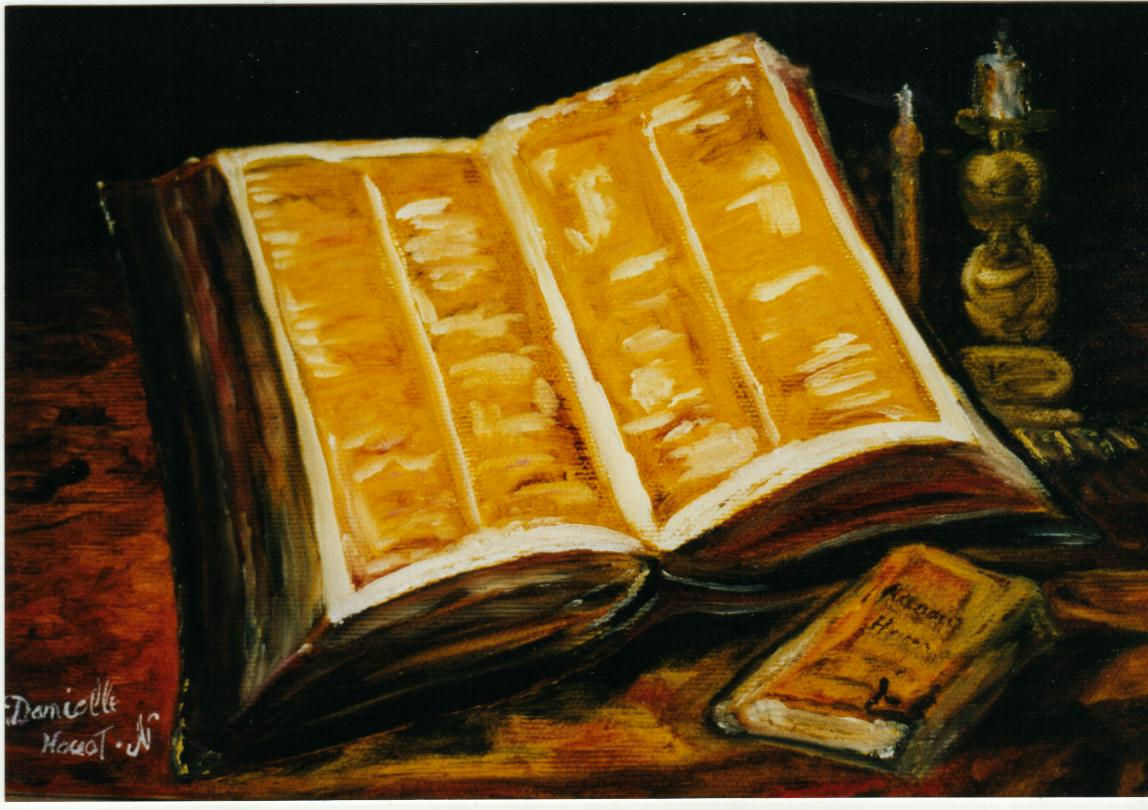 La Bible chrétienne est le résultat d’un long processus de sélection[1]
des textes. S’il était déjà bien avancé dans les premiers siècles, il ne
s’est achevé que tardivement : il faut attendre le seizième siècle pour que
les catholiques disposent d’un inventaire des livres de la Bible faisant
autorité, le dix-septième siècle pour les orthodoxes et ce n’est qu’au
dix-neuvième siècle que le contenu de la Bible protestante sera véritablement
stabilisé. « Evangile » est un terme issu du grec « euaggelion »,
signifiant « bonne nouvelle ». Les évangiles[2]
rapportent la « bonne
La Bible chrétienne est le résultat d’un long processus de sélection[1]
des textes. S’il était déjà bien avancé dans les premiers siècles, il ne
s’est achevé que tardivement : il faut attendre le seizième siècle pour que
les catholiques disposent d’un inventaire des livres de la Bible faisant
autorité, le dix-septième siècle pour les orthodoxes et ce n’est qu’au
dix-neuvième siècle que le contenu de la Bible protestante sera véritablement
stabilisé. « Evangile » est un terme issu du grec « euaggelion »,
signifiant « bonne nouvelle ». Les évangiles[2]
rapportent la « bonne nouvelle » que constitue la venue de Jésus. Ces écrits
relatent la vie et l'enseignement du Christ, par ceux qui sont considérés
comme des témoins directs de ses faits et gestes. Le
christianisme, dès ses origines, se présente pourtant sous la forme d'un
ensemble de communautés étonnamment diverses. Ainsi, loin d'offrir une
image unifiée de la religion chrétienne, les apocryphes introduisent à sa
diversité doctrinale, mais aussi mythologique et linguistique.
nouvelle » que constitue la venue de Jésus. Ces écrits
relatent la vie et l'enseignement du Christ, par ceux qui sont considérés
comme des témoins directs de ses faits et gestes. Le
christianisme, dès ses origines, se présente pourtant sous la forme d'un
ensemble de communautés étonnamment diverses. Ainsi, loin d'offrir une
image unifiée de la religion chrétienne, les apocryphes introduisent à sa
diversité doctrinale, mais aussi mythologique et linguistique. 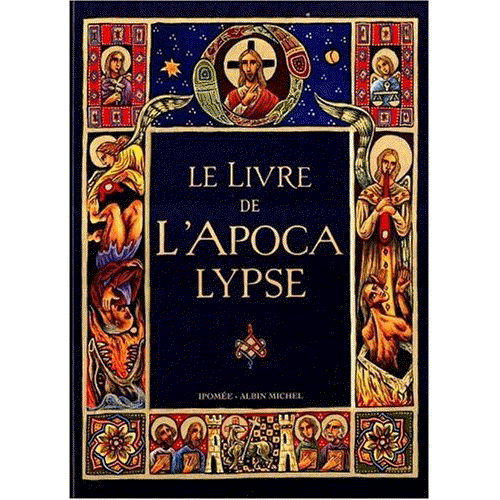 Au
sein de l'extraordinaire foisonnement de textes, le choix de l'Église ancienne
fut difficile. L'Apocalypse de Jean a bien failli ne pas être retenue
dans le canon. Quant au Pasteur d'Hermas, il a manqué de peu d'y entrer.
Il n'y a aucune différence intrinsèque entre écrits canoniques et apocryphes.
Le Nouveau Testament résulte du choix que les autorités ecclésiastiques ont
opéré parmi des dizaines de textes pour fixer un corpus de référence.
D'autres œuvres, non retenues, continuèrent à alimenter la piété, au point
d’être à la source de traditions encore vivaces. Ces textes ont traversé l’histoire
de la pensée et de la foi chrétienne depuis leur rédaction, recueillant les
traditions orales des premières communautés chrétiennes. Ils témoignent de
la forte impression produite sur la conscience des fidèles par l’événement
qui venait de se produire et dont ils étaient presque les contemporains.
Au
sein de l'extraordinaire foisonnement de textes, le choix de l'Église ancienne
fut difficile. L'Apocalypse de Jean a bien failli ne pas être retenue
dans le canon. Quant au Pasteur d'Hermas, il a manqué de peu d'y entrer.
Il n'y a aucune différence intrinsèque entre écrits canoniques et apocryphes.
Le Nouveau Testament résulte du choix que les autorités ecclésiastiques ont
opéré parmi des dizaines de textes pour fixer un corpus de référence.
D'autres œuvres, non retenues, continuèrent à alimenter la piété, au point
d’être à la source de traditions encore vivaces. Ces textes ont traversé l’histoire
de la pensée et de la foi chrétienne depuis leur rédaction, recueillant les
traditions orales des premières communautés chrétiennes. Ils témoignent de
la forte impression produite sur la conscience des fidèles par l’événement
qui venait de se produire et dont ils étaient presque les contemporains.