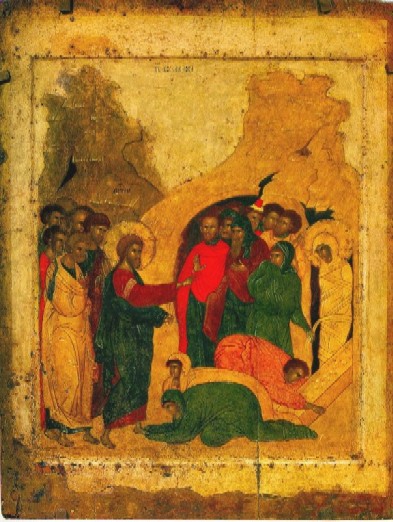Le
Christ, maître absolu
de
la vie et de la mort
 Les
deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la
résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous
les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière
et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte
au péché (et la lumière pour l’aveugle est le
signe d’une autre lumière qui est donnée à
ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus
redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe
d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout
croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,
Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus
important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus
seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire
revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à
Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa
mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la
mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que
le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,
4), « Je suis heureux de n’avoir pas été
là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,
je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je
savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à
cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu
m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).
Les
deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la
résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous
les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière
et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte
au péché (et la lumière pour l’aveugle est le
signe d’une autre lumière qui est donnée à
ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus
redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe
d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout
croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,
Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus
important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus
seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire
revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à
Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa
mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la
mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que
le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,
4), « Je suis heureux de n’avoir pas été
là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,
je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je
savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à
cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu
m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).
Le
cadre et les personnages
Ce
signe se passe à. Béthanie, près de Jérusalem.
En hébreu. Béthanie signifie : la maison du pauvre, la
maison de l’humilité. Actuellement, c’est le village
de « El Azarieh », à deux kilomètres
environ de la capitale, où l’on montre encore le tombeau de
Lazare creusé dans le roc... Ce village est celui de Marthe et
de Marie, deux femmes que l’auteur du quatrième évangile
pense bien connues des chrétiens pour qui il rédige son
texte. Très rapidement, on les a identifiées aux deux
femmes présentées dans un épisode de Luc.
« Comme
ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du
nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur
nommée Marie qui, s’étant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s’affairait à un
service compliqué. Elle survint et dit : Seigneur, cela
ne te fait rien que ma sœur m’ait laissée seule à
faire le service ? Dis-lui donc de m’aider. Le Seigneur lui
répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu
t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera
pas enlevée » (Lc. 10, 38-42).
Luc
n’a pas indiqué l’endroit où s’est passée
cette scène. Il n’est pas impossible que ce soit Béthanie,
mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude qu’il s’agit
des mêmes personnes. Marie est présentée comme
cette « même Marie qui avait oint le Seigneur d’une
huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses
cheveux » (Jn. 11, 2). Cette action est racontée au
passé, mais l’évangéliste parle d’une action
qui se déroulera au chapitre suivant de sa rédaction
(Jn. 12, 1-2) ; et en 12, 1, il mentionnera le récit de la
résurrect1on de Lazare comme étant aussi un fait passé.
Au moment où l’évangéliste rédige son
texte, les deux événements sont bien passés et
il y a pour lui comme un télescopage dans le temps. Toutefois,
rien ne permet d’identifier cette Marie avec la pécheresse
qui est présentée par Luc (7, 36-50). Lazare n’est
pas connu par ailleurs, et il ne semble même pas être
connu par les lecteurs de cet évangile, puisqu’il est
simplement présenté comme « le frère »
des deux femmes. Pourtant, il porte un nom prédestiné :
« Dieu vient en aide » ; et ses deux sœurs le
présentent comme un ami de Jésus : « Seigneur,
celui que tu aimes est malade » (Jn. 11, 3). Cette amitié
sera rappelée : « or Jésus aimait Marthe et
sa sœur et Lazare » (v. 5) ; « notre ami
Lazare s’est endormi, je vais amer le réveiller »
(v. 11). Cette même amitié sera encore soulignée
par les juifs : « voyez comme il l’aimait »
(v. 36). Une semblable insistance sur les sentiments de Jésus
est exceptionnelle chez Jean : tout semble amener à conclure
que c’est l’amour qui fait vivre.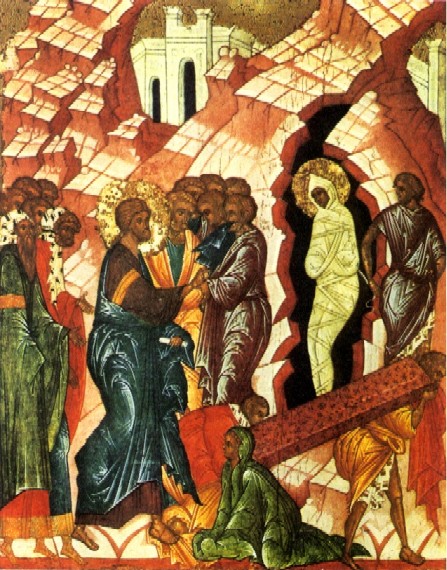
Proposition
de structure pour ce texte
Dans
une première partie, tout se passe selon une référence
constante à la maison de Lazare et de ses sœurs. Cette maison
constitue un système clos : l’amour qui peut unir les sœurs
et le frère est un amour sans fécondité, sans
postérité possible, ce qui était difficilement
admis par le judaïsme de l’époque.
« Il
y avait un homme malade » (v. 1). La maladie peut
connaître deux solutions : la guérison qui marque un
retour à l’état précédent ou la mort
qui constitue une nouveauté. Le vide qui sera causé par
la mort de Lazare est immédiatement comblé par la
présence des juifs dans la maison des deux sœurs.
Dans
la seconde partie, tout va se dérouler selon un processus de
sortie : la maison, comme système clos, s’ouvre, se vide de
tous ses occupants, puis le tombeau va être également
vidé. Mais, rien, dans le texte ne permet de dire ce qu’il
advient de Lazare et de ses sœurs après la résurrection.
Le « déliez-le et laissez-le amer » (v.
44 b) laisse simplement supposer qu’il ne peut s’agir d’un
simple retour à l’état antécédent.
Une maison et ses
habitants : vv. 1-2
Annonce de la
maladie à Jésus : v. 3
Jésus reste
sur place : vv. 4-6
Annonce de la mort
de Lazare par Jésus : vv. 7-14
Départ de
Jésus et des disciples : vv. 15-17
Les juifs viennent
consoler les deux sœurs : vv. 18-19
Marthe sort vers
Jésus : vv. 20-27
Marthe vient vers
Marie : v. 28
Marie et les juifs
sortent ensemble : vv. 29-37
Jésus
s’adresse à Lazare : vv. 38-43
Lazare sort du
tombeau vivant mais lié : v. 44 a
Lazare est libéré
: v. 44 b
Une
maison et ses habitants
Voir
ce qui a été dit précédemment sur la
recherche d’identification des personnages et des lieux dans le
cadre des évangiles de Luc et de Jean.
Annonce
de la maladie à Jésus
« Les
sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, celui
que tu aimes est malade » (v. 3). C’est une manière
pour elles de dire : « Nous voulons qu’il guérisse
! » ailleurs les deux sœurs reprocheront à Jésus
son absence, en lui disant que sa présence aurait pu guérir
leur frère : « Seigneur, si tu avais été
ici, mon frère ne serait pas mort » (v. 21 et v.
32).
Jésus
reste sur place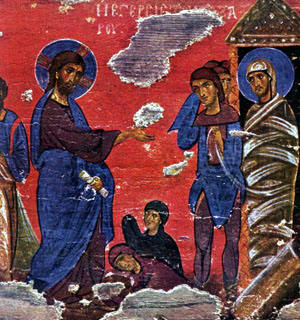
Alors
qu’il sait que Lazare est malade, à la porte de la mort,
Jésus ne se dérange pas, il reste « deux
jours encore à l’endroit où il se trouvait »
(v. 6). Déjà, aux noces de Cana, il n’avait pas
répondu immédiatement au désir exprimé
par sa mère : « Mon heure n’est pas encore
venue » (Jn. 2, 4). Jésus ne règle pas sa
conduite sur des sentiments humains, mais sur la volonté de
son Père, il veut servir la gloire de Dieu : « Cette
maladie n’aboutira pas à la mort, elle servira à la
gloire de Dieu, c’est par elle que le Fils de Dieu doit être
glorifié » (v. 4). Cette réponse ressemble
étrangement à la réponse que Jésus avait
faite à la question de ses disciples quant à l’origine
de la cécité de l’aveugle-né : « Ni
lui ni ses parents (n’ont péché). Mais c’est pour
que se manifestent en lui les oeuvres de Dieu » (Jn. 9,
3). La gloire de Dieu n’est pas une sorte de satisfaction égoïste
que Dieu se réserverait au détriment de ses créatures
(aveugle-né, Lazare) : chaque fois qu’il est question de la
gloire de Dieu, c’est toujours pour le bien du peuple tout entier,
ou pour le bien de ceux qu’il aime. Il manifeste pour eux sa
volonté de salut. Et celle-ci se manifestera d’une façon
particulièrement éclatante pour Jésus que le
Père ressuscitera lui-même d’entre les morts : en lui,
il propose sa présence et son salut.
Annonce
de la mort de Lazare par Jésus
Ayant
laissé deux jours s’écouler, Jésus annonce à
ses disciples son intention de retourner en Judée. Ceux-ci
voudraient l’en dissuader en raison du danger que Jésus peut
alors courir : « Les juifs, à nouveau, ramassèrent
des pierres pour le lapider... Ce n’est pas pour une belle oeuvre
que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème parce que
toi qui es un homme, tu te fais Dieu » (Jn.10, 31-33).
Mais on ne peut arrêter la marche de Jésus, on ne peut
pas davantage le lapider tant que son « heure n’est pas
encore venue ». C’est ce qu’il fait entendre à
ses disciples, en citant une sorte de proverbe populaire : « N’
y a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu’un marche le jour, il
ne trébuche pas parce qu’il voit la lumière de ce
monde, mais si quelqu’un marche de nuit, il trébuche parce
que la lumière n’est pas en lui » (vv. 9-10),
parole qui est à rapprocher de ce qu’il disait aussi à
ses disciples avant la guérison de l’aveugle-né :
« Tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux
oeuvres de Celui qui m’a envoyé ; la nuit vient où
personne ne peut travailler Aussi longtemps que je suis dans le
monde, je suis la lumière du monde (Jn. 9, 4-5).
Ultérieurement, Jésus utilisera la même image
pour faire comprendre à ses adversaires qu’il est encore
temps de rendre gloire à Dieu : « La lumière
est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tandis que vous
avez la lumière, pour que les ténèbres ne
s’emparent pas de vous, car celui qui marche dans les ténèbres
ne sait pas où il va Pendant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière »
(Jn. 12, 35-36) .
Sauver
Lazare de la mort sera, pour Jésus, le signe ultime, celui que
les juifs réclamaient : « Si tu es le Christ,
dis-le nous ouvertement » (Jn. 10, 24), mais cela sera
aussi le signe de sa propre condamnation : la gloire qui va rejaillir
de ce miracle, gloire annoncée au v. 4, sera finalement la
glorification de Jésus sur la croix. Jésus reste sur
place pendant deux jours, et il se met en route le troisième
jour, comme c’est le troisième jour qu’il ressuscitera des
morts.
En
employant le vocabulaire du sommeil pour désigner la mort de
Lazare, Jésus change la signification de la mort. Elle n’est
pas un châtiment, mais un passage qui conduit au réveil
de la résurrection. Mourir, dans toute la littérature
biblique, était considéré comme une conséquence
du péché, et donc comme le pire des châtiments.
Pourtant, la mort perdait son caractère tragique quand la vie
avait été longue et heureuse, particulièrement
comblée par la bonté divine. Jésus, en
dédramatisant la mort, lui donne le sens du sommeil : ceux qui
sont morts ne sont qu’endormis, dans l’attente d’un réveil.
Jésus se réjouit de la mort de Lazare, non pas parce
que, ayant attendu, il manifestera sa puissance avec plus d’éclat
aux yeux de ses disciples, mais parce qu’ils croiront. Le motif de
la joie ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,
mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des
disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau
prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais
bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine
(vv. 33-36).
ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,
mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des
disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau
prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais
bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine
(vv. 33-36).
Départ
de Jésus et des disciples
« Allons
à lui ! Alors, Thomas, celui que l’on appelle Didyme, dit
aux autres disciples : Allons nous aussi et nous mourrons avec lui »
(vv. 15-17). Thomas donne le sens du départ : celui de la mort
« avec lui ». Le caractère de ce « lui »
est assez ambigu : s’agit-il de Lazare ou s’agit-il de Jésus
? De fait, les disciples doivent partager complètement la
destinée de Jésus et mourir avec lui. De plus, les
disciples meurent symboliquement dans ce récit, ils
disparaissent complètement de la scène... A son arrivée
(alors qu’il était accompagné de ses disciples),
Jésus trouve Lazare au tombeau depuis quatre jours : c’est
dire qu’il est mort depuis quatre jours, car l’ensevelissement se
faisait le jour même. Dans la mentalité populaire, l’âme
continuait à tourner autour du cadavre pendant trois jours, et
lorsque le visage commençait à se décomposer,
elle quittait pour toujours les alentours de la tombe. Marthe
reviendra sur cet aspect : « Seigneur, il doit déjà
sentir... Il y a en effet quatre jours... » (v. 39).
Les
juifs viennent consoler les deux sœurs.
Contrairement
aux autres juifs, présentés dans les chapitres
précédents, ces juifs ne sont pas hostiles à
Jésus : ils seront les témoins oculaires de la
résurrection de Lazare, et l’évangéliste
notera même que certains crurent en Jésus après
ce signe (v. 45).
RECAPITULATION
DE LA PREMIERE PARTIE
|
du
côté de la maison
|
du
côté de Jésus
|
|
Lazare
est malade (v. 1)
Nous
voulons qu’il guérisse (v. 3)
Cette
maladie n’aboutira pas à la mort (v. 4)
donc
elle conduit à la guérison, et à la vie.
Lazare
doit donc guérir
et
pourtant Lazare meurt
Il
laisse un vide dans la maison,
vide
comblé par la présence des Juifs
VIVRE
EST CONDITION POUR MOURIR
|
Lazare
est mort (v. 14)
Nous
mourrons aussi (v. 16)
Je
me réjouis... afin que vous croyiez (v. 15)
MOURIR
EST CONDITION POUR CROIRE
|
Marthe
sort vers Jésus
Après
avoir présenté l’attitude des deux sœurs (Marie
reste à la maison alors que Marthe part à la rencontre
de Jésus) l’évangéliste propose une catéchèse
de la foi. C’est d’abord le reproche affectueux de Marthe :
« Seigneur, si tu avais été là, mon
frère ne serait pas mort », autrement dit : « tu
n’es pas venu et mon frère est mort, alors qu’il n’aurait
pas dû mourir ». En cela, elle présente
l’état de sa foi en Jésus au moment présent.
Mais elle poursuit et montre l’endroit où sa foi doit
aboutir à la fin de l’entretien : « Mais
maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l’accordera » (v. 22). La foi de Marthe
est liée à la présence matérielle de
Jésus, et sa demande s’exprime en termes de connaissance :
« si tu avais été là... je sais... ».
Jésus lui-même fera écho à la demande de
Marthe, telle elle l’exprime, dans sa prière d’action de
grâce : « Père, je te rends grâce de ce
que tu m’as exaucé. Certes, je savais bien que tu m’exauces
toujours... » (vv. 41-42). Pour l’instant, Jésus
veut la faire progresser dans sa foi : « Ton frère
ressuscitera » Marthe comprend cette proposition de
Jésus dans le sens de la tradition juive. Sous l’influence
du pharisaïsme (dont il faut reconnaître les nombreux
aspects positifs, même si les pharisiens sont souvent
caricaturés dans les récits évangéliques),
l’espérance en la résurrection des morts s’était
développer pour rétribuer les justes qui étaient
morts sans avoir connu le bonheur.
Ainsi,
vers les années 100 avant Jésus-Christ, un auteur
anonyme expose comment des croyants, sûrs de la résurrection,
ont assumé jusqu'au bout la fidélité â
Yahwé. Il faudrait relire intégralement le chapitre 7
du deuxième livre des Martyrs d’Israël. Le roi
Antiochus voulait contraindre sept frères et leur mère
â manger de la viande interdite par la Loi mosaïque. Au
moment de son supplice, le deuxième frère s'écrie :
« Scélérat que tu es, tu nous exclus de la
vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons
morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle »
(2 M. 7, 9). Ainsi se trouve affirmé le fait que ceux qui
meurent pour leur foi ressusciteront, car cela est nécessaire
à la justice de Dieu. Et la mère de ces sept frères
les encourageait dans leur supplice : « Je ne sais
comment vous avez apparu dans mes entraimes. Ce n'est pas moi qui
vous ai gratifiés de l'esprit et de la vie, et ce n'est pas
moi qui ai organisé les éléments dont chacun de
vous est composé. Aussi bien le Créateur du monde, qui
a formé l'homme à sa naissance et qui est à
l'origine de toute chose vous rendra-t-il dans sa miséricorde
et l'esprit et la vie parce que vous vous sacrifiez maintenant
vous-mêmes pour ses lois » (7, 22-24) .
Peu
à peu, les développements de la pensée juive,
sous l'influence des pharisiens, amenaient à penser que chaque
membre du peuple élu bénéficierait de la
résurrection « au dernier Jour » quand
la justice même de Dieu rétablirait toute chose dans
l'équité. Mais le fait de la résurrection
n’était pas admis par tous, et particulièrement pas
par les sadducéens. C'est ainsi que Paul, arrêté
à Jérusalem, aux portes du Temple et traduit devant le
Sanhédrin, peut utiliser cette opposition entre pharisiens et
sadducéens pour échapper à la colère des
Juifs (Ac. 23, 6-10).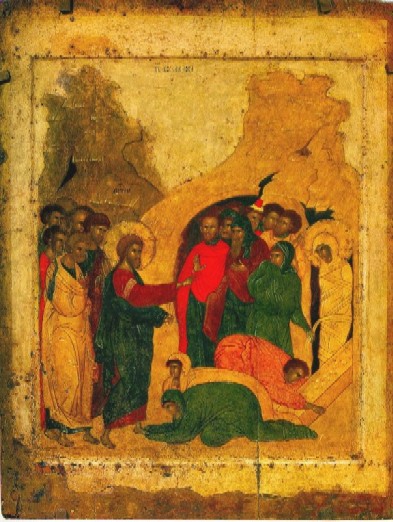
Mais
autre chose est d'affirmer la résurrection eschatologique (au
dernier jour) autre chose est de dire : « Je suis la
résurrection et la vie » (v. 25). Ce qui est
remarquable dans ce récit de la résurrection de Lazare,
c'est précisément que cette révélation
précède le signe, alors habituellement la révélation
suit le miracle. L'explicitation de Jésus commence par un « Je
suis » qui indique la présence divine elle : le nom
de Dieu s'exprimait simplement par ce terme. On peut y voir la
prétention de Jésus à l'égalité
avec Dieu... Mais il y a plus : la résurrection n'est pas pour
un au-delà, elle est exprimée au présent : « Je
suis la résurrection et la vie ». Maintenant que
Jésus est présent, auprès de Marthe - alors
qu'il est très proche de sa propre mort - la mort ne pose plus
de problème pour Lazare et pour tous ceux qui croient en
Jésus. Et au-delà de la mort de Lazare, il est question
de la mort de tout croyant : la mort est devenue irréelle,
elle était déjà présentée comme un
sommeil (v. 22). Celui qui croit est déjà passé
de la mort à la vie. Jésus essaie donc d'élever
l'esprit de la sœur de Lazare vers cette idée qu'il y a déjà
résurrection et vie pour ceux qui croient en lui. Cependant,
il y a une condition à l'obtention de la résurrection
et de la vie, c'est la foi : « Crois-tu cela ? »
Par sa foi, le croyant possède l'espérance d'avoir déjà
part à la vie même de Jésus, qui se présente
comme le principe, l'auteur et la source de la vie et du salut.
Lorsque
Jésus affirme : « Je suis la résurrection et
la vie », il se révèle lui-même comme
celui qui communique la vie par ce qui sera sa glorification sur la
croix : la vie est reçue à travers la mort à
soi-même. Jésus, en montant en Judée pour amer
réveiller son ami Lazare marchait vers sa mort : le don de sa
vie permettait de redonner la vie à Lazare. Et la résurrection
de Lazare devient, inversement, le signe de la glorification de Jésus
et le gage de notre propre résurrection.
La
foi de Marthe doit amer jusqu'à cette affirmation que la mort
même de Jésus est source de vie. La réponse de
Marthe sera nette : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le
Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde » (v. 27). En
posant cette affirmation, Marthe progresse, dans sa foi : elle ne
perçoit plus Jésus comme un puissant faiseur de
miracles. Mais elle découvre en Jésus celui que le Père
a envoyé. En reconnaissant et en confessant la qualité
messianique de Jésus, Marthe reconnaît qu'il possède
la pleine puissance de la résurrection. Il y a là une
triple profession de foi qui est affirmée par Marthe :
·
Jésus est le Christ (traduction de l’hébreu :
Messie),
·
il est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant,
·
il est celui qui vient.
C'est
le modèle même de la foi qui est demandé à
tout chrétien. Il n'est pas nécessaire d'avoir
rencontré le Christ pour croire en sa parole :
« Bienheureux ceux qui sans avoir vu ont cru »
(Jn. 20, 29).
Marthe
vient vers Marie
Après
sa profession de foi, Marthe court prévenir sa sœur, tout
bas. Pour Jean, Marthe a fait ce qu'el1e devait : elle a professé
sa foi, elle prévient Marie pour elle accomplisse la même
démarche. Si « le Maître est là et il
appelle », c'est qu'il va faire progresser Marie sur le
même chemin de la foi et de l'espérance.
Marthe
et les Juifs sortent ensemble
L'acte
de foi de Marie commence par manifester que la foi de l'homme est
toujours une réponse à une initiative du Maître.
Les juifs sortent de la maison et suivent Marie. Toute la scène
se passe" à l'extérieur, la maison se vide
entièrement de ses occupants, comme le tombeau va bientôt
se vider de son occupant, mais il convient de noter la différence
d’attitude entre Marie et les juifs. Marie s’empresse d'aller
rejoindre Jésus pour se jeter à ses pieds, alors que
les juifs pensent qu'elle part se lamenter au tombeau. Mais
l'essentiel, pour Jésus et pour l'évangéliste,
n'était-il pas simplement d’amener les témoins vers
le lieu du signe ? Marie reprendra la même supplique que sa
sœur : tu n'étais pas là et mon frère est mort
! Elle se plaint de la même manière que sa sœur, mais
son attitude est plus démonstrative : elle se jette à
ses pieds pour reprendre le refrain qui exprime toute sa désillusion,
voire la désespérance qui est la sienne depuis ces
derniers jours.
« Lorsqu'il
la vit se lamenter, elle et les juifs qui l’accompagnaient, Jésus
frémit intérieurement et se troubla ». La
démonstration de la peine de Marie est tout orientale, elle se
lamente à grands cris, ainsi que les juifs qui
l'accompagnaient. Et l'évangéliste emploie deux termes
pour désigner les sentiments de Jésus à ce
moment: il frémit intérieurement (en esprit) et il se
troubla. On s'est beaucoup interrogé sur le sens de ces deux
sentiments de Jésus. Pour certains, Jésus se serait ému
du chagrin éprouvé par Marie, il aurait été
complètement remué par la tristesse des deux sœurs et
de leurs amis. Pour d'autres, il se serait indigné devant ce
deuil purement conventionnel, que les juifs soulignent au verset 37 :
« Celui qui a ouvert les yeux de l’aveugle n’a pas été
capable d'empêcher Lazare de mourir », ce qui
motiverait la colère de Jésus contre l'incrédulité
des Juifs. D'autres encore pensent que Jésus manifeste alors
sa colère, ou du moins son aversion envers la mort (et son
auteur) qui a atteint son ami Lazare, et qui va bientôt
l'atteindre. Il est vrai que Jésus pleure (v. 35), et ses
pleurs manifestent simplement l'amitié qu'il éprouvait
pour Lazare, et ils provoquent une double réaction : la
sympathie des uns et le mécontentement des autres. Certains
Juifs rappellent donc la guérison de l'aveugle-né et
mettent en doute la puissance de Jésus : pourquoi n'est-il pas
venu pendant la maladie ? Maintenant, il est trop tard il aurait pu
prévenir cette mort. Mais c'est précisément ce
que Jésus a voulu éviter : il devait laisser mourir
Lazare s'il voulait faire éclater la gloire de Dieu.
Jésus
s'adresse à Lazare
Jésus
arrive alors au tombeau, situé vraisemblablement dans une
grotte. L'évangéliste dit simplement qu'une pierre en
fermait l'entrée. Alors, Jésus donne un ordre bref :
« Enlevez la pierre ». Mais les témoins
élèvent des objections que Marthe traduit aussitôt
: « Seigneur, il doit sentir... il y a quatre jours
déjà... ». Sa remarque montre simplement
qu'elle n’a pas réalisé entièrement la portée
de sa profession de foi, et Jésus rappelle une fois encore ce
qu'il a promis. Avant de réaliser ce qui sera son dernier
signe, le plus grand miracle de sa vie, « Jésus
leva les yeux », comme il le fera au cours de sa dernière
prière (Jn. 17, 1).
L’expression
« lever les yeux » est typique de la tradition
liturgique chrétienne, alors que les juifs se tournaient
plutôt vers le Temple de Jérusalem. Sa prière ne
sera pas une supplication, mais davantage une action de grâce.
C'est le type même de la prière de Jésus (elle
est toujours action de grâce, car il sait que son Père
l'écoute toujours). A la limite, Jésus n'avait pas
besoin de prier car toute son existence est en harmonie, en communion
avec la volonté du Père, toute sa vie est une prière
- toute prière des chrétiens sera aussi exaucée
dans la mesure où elle s'accorde avec la volonté du
Père. Mais Jésus prie à cause des témoins,
« afin qu'ils croient que tu m'as envoyé ».
Il
faut attendre les deux derniers versets d'un long récit
inauguré par le « il y avait un homme malade »
(v. 1) pour que l'évangéliste nous conduise là
où il voulait en venir : le miracle de la résurrection
de Lazare. Le principal intéressé par l'ensemble de ce
texte n'occupe que quelques lignes... Alors Jésus commande :
« Lazare, sors ! »
Lazare
sort du tombeau vivant, mais lié
« Et
celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains
attachées par des bandes et le visage enveloppé d’un
linge ».
Tandis
que, pour Lazare, il a fallu rouler la pierre qui obstruait l'entrée
du tombeau et le détacher de tout ce qui pouvait l'entraver,
lors de la résurrection de Jésus, Marie de Magdala ne
pourra que constater que « la pierre a été
enlevée du tombeau » (Jn. 20, 1) et les deux
disciples constateront « les bandelettes posées là
et le linge qui avait recouvert la tête ; celui-ci n'avait
pas été déposé avec les bandelettes, mais
il était roulé à part, dans un autre endroit »
(Jn. 20, 6-7).
RECAPITULATION
DE LA DEUXIEME PARTIE
|
du
côté de la maison
|
du
côté de Jésus
|
|
Lazare
aurait dû guérir (v. 21 et 32)
sorties
successives
Je
sais qu'il ressuscitera (v. 24)
Crois-tu
?
VIVRE
EST CONDITION CROIRE
|
Lazare
est vivant (v. 44)
Je
suis la résurrection (v. 25)
Oui,
Seigneur, je crois (v. 27)
CROIRE
EST CONDITION POUR VIVRE
|
SCHEMA
RECAPITULATIF
|
les hommes
|
Jésus
|
|
Lazare
est malade
Nous
voulons qu'il guérisse
Cette
maladie n’aboutira pas à la mort
VIVRE
EST CONDITIQN POUR MOURIR
|
Lazare
est mort
Mourons
avec lui
Je
me réjouIs que Lazare soit mort afin que vous croyiez
MOURIR
EST CONDITION POUR CROIRE
|
|
Lazare
aurait dû guérir
Il
ressuscitera
Crois-tu
?
VIVRE
EST CONDITION POUR CROIRE
|
Lazare
est vivant
Je
suis la résurrection
Je
crois
CROIRE
EST CONDITION POUR VIVRE
|
La
foi en Jésus
Tout
le quatrième évangile est l'évangile de la foi
en Jésus envoyé par le Père, et cette foi en
Jésus donne la vie éternelle. En réponse aux
« oeuvres de Dieu » accomplies par Jésus,
en réponse aux différents signes, l'homme est amené
à prendre position. Les hommes sont appelés à
croire en Celui que Dieu a envoyé. Mais dans le procès
qu'ils intentent à Jésus, tout au long de l'évangile
johannique, les juifs refusent de croire, malgré les
témoignages rendus. Ils accusent Jésus de revendiquer
l'égalité avec Dieu, ils l'accusent de se faire Dieu,
et, avec la résurrection de Lazare, la tension est à
son point maximum. Les juifs l'avaient sommé de répondre
clairement à leur interrogation : « Jusqu'à
quand vas-tu nous tenir en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous
ouvertement ! » (Jn. 10, 24).
La
réponse de Jésus se trouvera dans la résurrection
de Lazare : la vie appartient à Dieu, et Jésus possède
en lui la puissance de la vie et de la résurrection, parce
qu’il est l’envoyé du Père. Mais cette réponse
sera précisément la cause de sa condamnation à
mort. A la suite de ce miracle, les grands prêtres et les
pharisiens réunissent le Sanhédrin, une instance de
décision dans les affaires religieuses juives : ils
reconnaissent que Jésus accomplit beaucoup de signes,
peut-être même trop de signes. Et, au lieu de le
reconnaître comme le Messie attendu, ils lancent un appel à
la prudence : il faut se soucier du bien commun. Si Jésus est
vraiment le Messie, s'il est celui qui doit libérer le peuple
de l'oppression étrangère, il est permis de craindre
une réaction de la part de la puissance d'occupation qui
pourrait détruire la nation et le Temple. Caïphe, qui
était grand-prêtre cette année-là (en
principe, dans la religion juive, les grands-prêtres étaient
élus à vie, mais les Romains destituaient souvent les
grands-prêtres, ce qui pouvait donner à penser qu'ils
n'étaient élus que pour une année ; lors de sa
consécration, le grand-prêtre recevait des insignes qui
faisaient de lui une sorte de prophète pour la nation ; c'est
ainsi que Jean va montrer que Caïphe va se mettre à
prophétiser involontairement). Caïphe déclare donc
que Jésus doit mourir pour le peuple, pour le bien de la
nation, mais l'évangéliste va préciser que Jésus
ne meurt pas seulement pour la nation juive, mais pour « réunir
dans l'unité les enfants de Dieu qui étaient
dispersés » (Jn. 11, 52).
Jésus
va donc mourir pour permettre la constitution d'un nouveau peuple de
Dieu. Alors, le grand conseil décide de faire périr
Jésus. La Passion commence donc à ce moment, avec
l'onction de Béthanie qui apparaît comme
l'ensevelissement préfiguré de Jésus. Jésus
va mourir mais c'est pour vivre pour toujours, car il est la
résurrection et la vie.
La
résurrection de Lazare est le signe de la résurrection
de Jésus, mais la réalité de cette dernière
dépasse de beaucoup la figure qui est proposée par le
retour à la vie de Lazare. Si Lazare revit, i1 se voit quand
même menacé d'un retour de la mort. La mort n'aura plus
d'emprise sur Jésus après sa résurrection. Il
est le maître absolu de la mort et de la vie.
La
crainte des chefs des prêtres pour leur Temple est justifiée :
ce Temple sera bientôt détruit par les Romains, non pas
parce qu’ils ont cru que Jésus était le Messie, mais
plutôt parce qu'ils ont refusé de croire. Pour les
chrétiens, le Temple de Jérusalem n’a plus
d'importance, parce que Jésus, dans son corps ressuscité
a remplacé ce Temple. Il est le Temple vivant en qui les
croyants peuvent rendre un culte « en esprit et en
vérité » (Jn. 4, 24), il rassemble les
enfants de Dieu qui étaient dispersés (Jn. 11, 52), il
donne la vie à ceux qui croient en lui (Jn. 11, 25-26). La
fête de la Dédicace du Temple, qui était la toile
de fond temporelle du miracle de la résurrection de Lazare,
s'accomplit en Jésus.
 Les
deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la
résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous
les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière
et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte
au péché (et la lumière pour l’aveugle est le
signe d’une autre lumière qui est donnée à
ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus
redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe
d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout
croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,
Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus
important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus
seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire
revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à
Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa
mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la
mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que
le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,
4), « Je suis heureux de n’avoir pas été
là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,
je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je
savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à
cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu
m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).
Les
deux signes de la guérison de l’aveugle-né et de la
résurrection de Lazare se répondent. Ils gravitent tous
les deux autour de l’expression majeure du don de Dieu : la lumière
et la vie. Jésus, lumière véritable, s’affronte
au péché (et la lumière pour l’aveugle est le
signe d’une autre lumière qui est donnée à
ceux qui ont foi en Jésus-Christ et en son Père). Jésus
redonne la vie à son ami Lazare (et cette vie est le signe
d’une autre vie, celle qui est donnée à. tout
croyant). Ce « miracle », ce dernier signe,
Jésus le fait devant les Juifs : c’est le signe le plus
important qu’il donne de sa puissance. il ne s’agit plus
seulement de multiplier les pains ou de guérir, mais de faire
revenir quelqu’un du monde des morts, un pouvoir qui est propre à
Dieu seul. Et Jésus en fait une preuve importante de sa
mission : « Cette maladie n’aboutira pas à la
mort. Elle servira à la gloire de Dieu, c’est par elle que
le Fils de Dieu doit être glorifié » (Jn. 11,
4), « Je suis heureux de n’avoir pas été
là afin que vous croyiez » (Jn. 11, 15), « Père,
je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Certes, je
savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à
cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu
m’as envoyé » (Jn. 11, 41-42).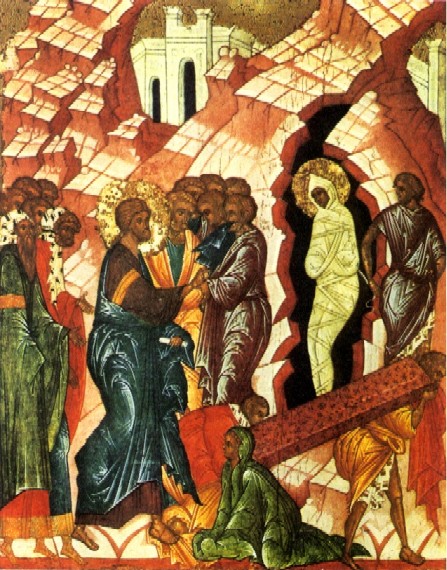
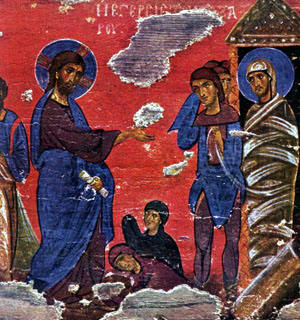
 ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,
mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des
disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau
prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais
bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine
(vv. 33-36).
ne se trouve pas dans l’acte que Jésus va réaliser,
mais dans l’acte de foi qui pourra s’ensuivre de la part des
disciples. ailleurs, l’attitude de Jésus devant le tombeau
prouve qu’il ne se réjouit pas de la mort de son ami, mais
bien que celle-ci l’ébranle dans toute sa dimension humaine
(vv. 33-36).