LA PROFESSION DE FOI CHRETIENNE
Les origines
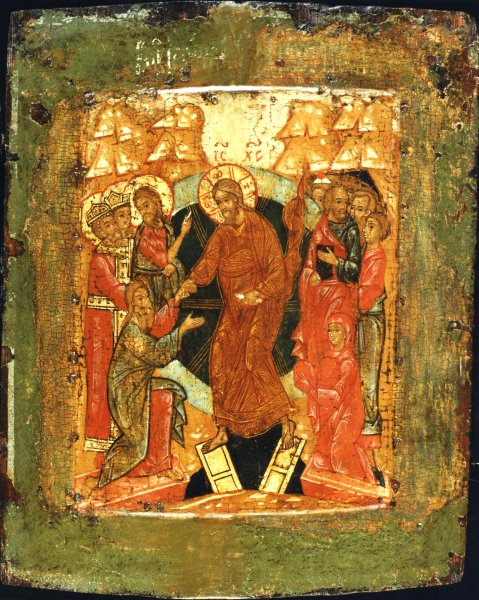 Dans
les premiers temps de l’Église, au moment des apôtres et des premiers
disciples qui avaient connu Jésus, la profession de foi était toute simple.
Pour être baptisé, pour faire partie de la communauté chrétienne, il
suffisait de dire : Je crois que Jésus est le Seigneur. Un peu à la fois, il a
fallu exprimer qui était Jésus, puisque les nouveaux chrétiens n’avaient
pas connu directement Jésus. La profession de foi a été amenée à raconter
également sa vie terrestre, sa mort et sa résurrection. Elle est devenue plus
explicite sur la vie de Jésus. Comme elle affirmait qu’il est Seigneur, c’est-à-dire
Dieu, il a été nécessaire de préciser qu’il était le Fils de Dieu et donc
d’expliquer qui était le Père. Et comme Jésus avait envoyé son Esprit sur
les apôtres et sur les chrétiens par la suite, il a fallu expliquer aussi qui
était l’Esprit Saint et quel était son rôle dans Église et dans la vie des
communautés chrétiennes. Ces communautés vivaient de plus deux dimensions
importantes de la foi : le pardon des péchés et des offenses, ainsi que l’espérance
en la résurrection et en la vie éternelle. Ces deux composantes de la foi sont
également entrées dans l’affirmation de la foi. C’est ainsi qu’est né
le Symbole de la foi que nous récitons chaque dimanche pendant la célébration
eucharistique. Au long des siècles, les chrétiens ont essayé d’exprimer
leur foi de différentes manières. Chaque fois que les chrétiens disent le
Credo, ils disent que depuis le commencement du monde jusqu’au retour du
Christ, ils forment une longue lignée de croyants, ils transmettent ce qu’ils
ont reçu, ils se disent les uns aux autres ce qu’ils ont reçu, ils se disent
les uns aux autres et ils disent à tous les hommes qu’ils font partie de l’immense
peuple que Dieu rassemble.
Dans
les premiers temps de l’Église, au moment des apôtres et des premiers
disciples qui avaient connu Jésus, la profession de foi était toute simple.
Pour être baptisé, pour faire partie de la communauté chrétienne, il
suffisait de dire : Je crois que Jésus est le Seigneur. Un peu à la fois, il a
fallu exprimer qui était Jésus, puisque les nouveaux chrétiens n’avaient
pas connu directement Jésus. La profession de foi a été amenée à raconter
également sa vie terrestre, sa mort et sa résurrection. Elle est devenue plus
explicite sur la vie de Jésus. Comme elle affirmait qu’il est Seigneur, c’est-à-dire
Dieu, il a été nécessaire de préciser qu’il était le Fils de Dieu et donc
d’expliquer qui était le Père. Et comme Jésus avait envoyé son Esprit sur
les apôtres et sur les chrétiens par la suite, il a fallu expliquer aussi qui
était l’Esprit Saint et quel était son rôle dans Église et dans la vie des
communautés chrétiennes. Ces communautés vivaient de plus deux dimensions
importantes de la foi : le pardon des péchés et des offenses, ainsi que l’espérance
en la résurrection et en la vie éternelle. Ces deux composantes de la foi sont
également entrées dans l’affirmation de la foi. C’est ainsi qu’est né
le Symbole de la foi que nous récitons chaque dimanche pendant la célébration
eucharistique. Au long des siècles, les chrétiens ont essayé d’exprimer
leur foi de différentes manières. Chaque fois que les chrétiens disent le
Credo, ils disent que depuis le commencement du monde jusqu’au retour du
Christ, ils forment une longue lignée de croyants, ils transmettent ce qu’ils
ont reçu, ils se disent les uns aux autres ce qu’ils ont reçu, ils se disent
les uns aux autres et ils disent à tous les hommes qu’ils font partie de l’immense
peuple que Dieu rassemble.
Croire, ce n’est pas seulement connaître par coeur des
formules, ce n’est pas le fait de quelques heures par semaine. Croire, cela
peut et doit remplir toute la vie d’un homme, car le Seigneur s’intéresse
à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, à ce que nous sommes.
Deux confessions de foi ont marqué Église depuis les
premiers siècles. Il s’agit d’une part du Symbole des apôtres et du Credo
de Nicée et de Constantinople.
Le Symbole des apôtres
Le Symbole des apôtres est un court sommaire, un condensé
de la foi de Église Sa forme actuelle ne remonte pas au-delà du quatrième
siècle. Mais son expression est certainement plus ancienne. A la fin du
quatrième siècle, Rufin composa un Commentaire sur ce Symbole, dans lequel il
en expliquait l’origine : les apôtres, ayant reçu l’Esprit-Saint au jour
de la Pentecôte, décidèrent, avant de partir en mission, de se mettre d’accord
sur un bref résumé de la foi chrétienne. Ce résumé serait la base de leur
enseignement ultérieur.
Il est pratiquement certain que les énoncés du Symbole
remontent à l’âge apostolique, même si la forme ne s’est développée que
graduellement. L’histoire de la composition de ce texte doit être relié
très étroitement à la liturgie baptismale, au cours de laquelle on
interrogeait le nouveau chrétien :
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre ?
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été
enseveli, est ressuscité d’entre les morts et qui est assis à la droite
du Père ?
Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la
résurrection de la chair et à la vie éternelle ?
Par sa réponse affirmative à chacune de ces interrogations,
celui qui allait être baptisé montrait son engagement dans la vie de Église
Le Credo de Nicée-Constantinople
On sait que les deux conciles de Nicée et de Constantinople
eurent pour motivation la condamnation des erreurs d’Arius et de ses
partisans. Ce qu’Arius voulait, c’était sauvegarder, au sein de la
Trinité, l’originalité du Père, non engendré et non devenu, seul à être
sans principe, finalement seul à être véritablement Dieu. Cette insistance le
conduisait irrésistiblement à dévaloriser le Verbe, la seconde personne de la
Trinité, en accordant au Père une véritable supériorité, beaucoup plus qu’une
simple antériorité chronologique. Malgré toutes ses précautions, Arius avait
tendance à subordonner le Fils au Père. La réaction ne se fit pas attendre :
Alexandre d’Alexandrie convoqua un concile des évêques d’Égypte et de
Libye pour condamner ces erreurs et excommunier Arius et ses partisans. Mais l’affaire
n’en resta pas là, elle déborda les frontières d’Égypte. Arius rechercha
des appuis auprès d’Eusèbe de Césarée et auprès de ceux qui, comme lui,
furent disciples de Lucien d’Antioche. Alexandre ne resta pas davantage
inactif : il fit parvenir, sous forme de lettres, ses décisions aux évêques
grecs et au pape Sylvestre. Devant l’agitation qui s’étendait, l’empereur
Constantin décida de convoquer un concile, le premier concile oecuménique, à
Nicée en 325. Selon le désir de l’empereur, les évêques commencèrent par
examiner le dossier de l’affaire arienne, et les pères conciliaires
confirmèrent la sentence du concile d’Alexandrie.
Pour enrayer le développement de l’hérésie, il restait
aux Pères conciliaires à proclamer la foi catholique, c’est-à-dire
universelle, dans son authenticité. « D’une part, affirmait Alexandre d’Alexandrie,
le concile voulait effacer les expressions impies des ariens et, d’autre part,
employer des termes tirés de l’Écriture et admis par tous pour confesser que
le Fils n’est pas tiré du néant mais de Dieu, qu’il est Verbe et Sagesse,
et non pas une créature ou un ouvrage, qu’il est le propre rejeton du
Père ».
Ainsi, les Pères conciliaires proclamèrent la vraie
doctrine sous la forme d’un symbole affirmant la consubstantialité (la même
nature) du Père et du Fils. Après la mention de l’Esprit Saint, ils
ajoutèrent une condamnation expresse des erreurs d’Arius : « Pour ceux
qui disent : il fut un temps où il n’était pas, et, avant de naître il n’était
pas, ou qui déclarent que le Fils de Dieu est d’une autre substance ou d’une
autre essence, ou qu’il est soumis au changement ou à l’altération,
Église catholique et apostolique les anathématise ».
Malgré cela, l’arianisme n’était pas encore totalement
expurgé de Église, et d’autres tendances hérétiques se firent jour,
concernant alors également la personne de l’Esprit. Pour tenter d’en
terminer avec ces erreurs et ces discussions, l’empereur Théodose réunit un
nouveau concile à Constantinople, en 381, le deuxième concile oecuménique,
mais où ne furent pas accueillis les évêques occidentaux et où le pape
Damase ne fut même pas représenté. Les Pères de Constantinople se
contentèrent de faire quelques additions aux énoncés de Nicée, à partir de
certains éléments qui se trouvaient dans le Symbole des apôtres. Ils
développèrent en outre l’article concernant l’Esprit, en le nommant
Seigneur et en déclarant qu’il est source de vie, qu’il procède du Père
(Église d’Occident ajoutera : et du Fils), qu’il reçoit le même culte que
le Père et le Fils, qu’il est Dieu en un mot. Ils développèrent également
l’expression de l’Esprit comme don de Dieu à son Église, à travers la
finale de leur Credo : « Nous croyons en Église, une, sainte, catholique
et apostolique, nous confessons un baptême pour la rémission des péchés,
nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir ».
Ainsi, le Credo des conciles qui est une expression
communautaire vise surtout à expurger Église, à faire sortir ceux qui sont
hérétique. Si le Symbole des apôtres visait à l’engagement du fidèle, le
Credo de Nicée-Constantinople vise plutôt au « dégagement » des
non-fidèles...
Lecture synoptique des deux professions de foi
|
Credo de Nicée-Constantinople |
Symbole des apôtres |
|
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant
créateur du ciel et de la terre
de l’univers visible et
invisible.
Je crois en un seul Seigneur
Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les
siècles.
Il est Dieu né de Dieu,
lumière née de la lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré non pas créé,
de même nature que le Père
et par lui tout a été fait.
Pour nous, les hommes
et pour notre salut,
il descendit du ciel.
Par l’Esprit-Saint,
il a pris chair
de la Vierge Marie
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous a souffert
sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion
et fut mis au tombeau,
et a été enseveli
il ressuscita
le troisième jour,
des morts
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel,
il est assis à la droite du
Père.
Il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les
morts.
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint
qui est Seigneur
et qui donne la vie,
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et
même gloire,
il a parlé par les prophètes.
Je crois en Église,
une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des
morts
et la vie du monde à venir. AMEN. |
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant
créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus-Christ
son Fils unique
notre Seigneur
qui a été conçu du Saint-Esprit
est né
de la Vierge Marie
sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort
Le troisième jour,
est ressuscité
est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra
juger les vivants et les
morts
Je crois en l’Esprit Saint
à la sainte Église
catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. AMEN. |
De la sorte, il est possible de constater que les deux
confessions de foi se présentent comme des discours similaires. Ce sont les
mêmes énoncés qui se retrouvent de part et d’autre, mis à part les
développements explicatifs des deux conciles. La structure interne est la même
: il s’agit du déploiement éternel et temporel du Dieu chrétien. Tout l’aspect
historique de Jésus de Nazareth se réfère aux mêmes sources du Nouveau
Testament. Il s’agit donc de deux expressions d’une même foi, et c’est
cette foi qu’il faut analyser, pour la faire nôtre et la transmettre.
Les confessions de foi présentent des récits
En tant que professions de foi, ces deux symboles se
présentent comme des discours personnels : quelqu’un énonce sa foi, que ce
soit un individu ou que ce soit une communauté. Ce sont des discours de
croyants, mais le corps même du texte se trouve être un récit, une narration
d’événements qui font accéder le sujet qui confesse à un acte, celui de
croire. Le caractère narratif est certainement plus sensible dans le Credo de
Nicée-Constantinople. Cela peut s’expliquer par le fait que le récit des
événements qui concernaient Jésus de Nazareth « que les juifs avaient
crucifié, mais que Dieu a ressuscité avec puissance (Ac. 2, 36) ne constituait
pas un problème capital pour les premières générations chrétiennes, car l’événement
pascal était encore proche.
Si l’on s’en tient uniquement à une explication
littéraire, la narration d’un événement quelconque suppose et implique
nécessairement que celui-ci soit passé. C’est la raison pour laquelle tous
les verbes portent la marque du passé, à l’exception de ceux qui indiquent l’acte
de foi : je crois, je reconnais, j’attends. De plus, un verbe est au futur :
il reviendra ; cela indique que le récit concernant Jésus n’est pas achevé
mais qu’il comporte une suite prochaine, même si le récit lui-même est
achevé. D’autre part, le « est assis » relève du présent (c’est
le cas dans la version grecque de référence) ; cela exprime qu’il y a un
dépassement de l’élément narratif : depuis le moment où Jésus est monté
au ciel, il échappe à toute l’histoire humaine, il rejoint le temps de Dieu.
Or, quel est le temps de Dieu ? Pour le Père, force est de
constater qu’il n’y a pas de temps. Le Père se caractérise par une absence
totale de narrativité. On ne peut rien dire du Père, car il n’agit pas
directement dans le temps des hommes.
L’Esprit, quant à lui, échappe à toute détermination
temporelle dans le Symbole des apôtres, mais il reçoit quelques
déterminations dans le Credo, et c’est le présent qui le caractérise :
« il donne la vie, il procède du Père (et du Fils), il reçoit même
adoration et même gloire ». Cette marque temporelle n’est pas un
élément narratif comparable à la marque temporelle et humaine concernant
Jésus. L’Esprit n’intervient pas dans l’histoire des hommes de la même
manière que le Fils. Pourtant, il convient de ne pas négliger la temporalité
de l’Esprit, d’autant plus que son rôle se trouve également mentionné par
un passé narratif : « il a parlé par les prophètes ». L’Esprit
a une forme particulière d’intervention : pour entrer dans l’histoire, il a
recours à un adjuvant historique, à des hommes déterminés, les prophètes
qui situent son action dans le temps de l’histoire humaine. Par cette
intervention, l’Esprit échappe au caractère mythique, légendaire. Et
cependant, il est permis de dire que l’action du Père comme celle de l’Esprit
n’échappe pas au mythe dans la mesure où elle ne se situe pas dans l’histoire
humaine.
La confession de foi serait-elle un mythe ?
Devant les multiples définitions possibles du mythe, il
convient de se limiter à dire que le mythe, en général, raconte une histoire
sacrée, un événement qui a eu lieu dans le temps primordial. Il explique
ainsi comme, grâce à l’intervention d’un être surnaturel, une réalité
quelconque est parvenue à l’existence. A la suite de cette intervention, l’homme
est devenu ce qu’il est aujourd’hui. C’est l’un des caractères
principaux du mythe : il veut expliquer les choses, les situations actuelles par
leur origine, dans un temps primordial, avant même l’apparition de l’homme
sur la terre.
Dans les sociétés qu’on appelle primitives, mais qui sont
souvent très évoluées, le mythe se réactualise sans cesse dans des rites.
Les rites du renouveau, les fêtes du Nouvel An par exemple, sont dans les
religions anciennes traditionnelles la réactualisation rituelle des mythes de
création.
Ce que nous pouvons appeler « le mythe
chrétien », tel que nous le voyons apparaître dans les professions de
foi de Église ancienne, se coule assez bien dans les définitions du mythe des
origines. Il s’inaugure par un récit très raccourci de la création :
« Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ».
La création est bien un fait qui a eu lieu en dehors du temps humain. Le mythe
chrétien se poursuit en donnant une explication de la venue d’une réalité
sociale. Il explique, en effet, comment, grâce à l’intervention d’un être
surnaturel, Jésus-Christ, Église est parvenue à devenir ce qu’elle est
aujourd’hui. Et, dans la perspective qui est celle de tout mythe d’origine,
il présente les origines du chrétien en référence constante avec ce qu’il
est devenu aujourd’hui. Il explique la réalité chrétienne actuelle dans une
structuration du réel ecclésial, qui est aussi le fait d’un être spirituel,
l’Esprit-Saint. De plus, comme tout mythe également, il appelle sa propre
fin, il vise une eschatologie (la science des fins dernières), il invite à se
tourner vers un avenir, vers une vision de la fin qui sera un nouveau
commencement (la vie du monde à venir). C’est dans ce contexte que la
résurrection des morts apparaît comme une nouvelle création.
 La
fonction mythique est d’autant plus sensible que ce qui ne relève pas
immédiatement de l’histoire échappe au temps du récit pour être présenté
dans l’actualité du présent, ce qui n’est pas un véritable temps pour le
récit. Ainsi, le Père se trouve complètement dans la non-temporalité,
exprimée par l’absence de tout verbe ; ainsi, le Fils échappe lui aussi au
temps par son ascension, et l’Esprit développe son action dans le présent.
Et il est même possible de souligner que l’aspect historique, à savoir l’existence
concrète de Jésus de Nazareth, joue un rôle particulièrement important dans
cette fonction mythique : toute son activité sera d’échapper au temps de l’histoire,
en la faisant projeter dans un temps primordial, initial (l’engendrement de
toute éternité) et dans un avenir (son action prolongée par l’Esprit).
La
fonction mythique est d’autant plus sensible que ce qui ne relève pas
immédiatement de l’histoire échappe au temps du récit pour être présenté
dans l’actualité du présent, ce qui n’est pas un véritable temps pour le
récit. Ainsi, le Père se trouve complètement dans la non-temporalité,
exprimée par l’absence de tout verbe ; ainsi, le Fils échappe lui aussi au
temps par son ascension, et l’Esprit développe son action dans le présent.
Et il est même possible de souligner que l’aspect historique, à savoir l’existence
concrète de Jésus de Nazareth, joue un rôle particulièrement important dans
cette fonction mythique : toute son activité sera d’échapper au temps de l’histoire,
en la faisant projeter dans un temps primordial, initial (l’engendrement de
toute éternité) et dans un avenir (son action prolongée par l’Esprit).
L’expression de la foi chrétienne a réussi un tour de
force extraordinaire par rapport à toute mythologie. Elle fait entrer son
histoire dans un temps mythique, alors que toutes les autres religions,
caractérisées précisément par leurs mythologies, ont toujours vainement
cherché à présenter leurs origines comme des récits historiques.
Par Jésus-Christ, la Trinité entre dans le temps
Ce que nous faisons n’est autre qu’une lecture des temps
grammaticaux pour essayer de saisir l’importance de l’événement
Jésus-Christ dans l’histoire des hommes, et même aussi dans l’histoire de
Dieu.
|
Hors du temps |
Le Père |
absence totale de narrativité |
|
Le temps |
Le Fils |
narrativité se dégageant du temps |
|
Hors du temps |
L’Esprit |
absence s’insérant temporellement |
Dans les deux professions de foi, le rôle du Fils est de
faire en sorte que le non-temps (c’est-à-dire Dieu) s’inscrive dans le
temps, dans l’histoire des hommes. Cela, le Fils le fait en tant qu’il est
né du Père, mais aussi en tant qu’il a pris chair de la Vierge Marie par l’action
de l’Esprit-Saint. Et c’est précisément à partir de sa naissance humaine
que le récit peut commencer : sans naissance, il n’y a pas d’histoire, il n’y
a pas de récit qui puisse être historique. Des intervenants historiques, comme
Marie et Ponce-Pilate, permettent de vérifier la confession de foi dans un
rapport direct avec l’histoire des hommes.
Le récit concernant Jésus-Christ dans le Symbole
Pour saisir toute la dimension du récit concernant Jésus de
Nazareth dans le Symbole, il est possible de disposer chaque élément le
concernant dans un schéma synthétique.
|
les vivants et les morts
pour juger
d’où il viendra
a été conçu (a)
du Saint-Esprit |
(a’) est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant |
|
est né (b)
de la Vierge Marie |
(b’) est monté
aux cieux |
|
a souffert (c)
sous Ponce-Pilate |
(c’) est ressuscité
le troisième jour |
|
a été crucifié (d)
est
mort |
(d’) est descendu aux enfers
a été enseveli |
Il est assez facile de justifier les correspondances
structurelles qui existent entre les différents membres mis en parallèles :
dans (a) et (a’), les intervenants, le Père et l’Esprit,
sont similaires dans leur rapport au temps historique,
dans (b) et (b’), la naissance est une venue au monde, une
descente sur la terre, alors que le fait de monter aux cieux est une sortie de
ce monde,
dans (c) et (c’) intervient une dimension temporelle,
historique : Ponce-Pilate est un individu repérable dans l’histoire des
hommes, et le troisième jour indique aussi une connotation temporelle, un
repère dans le temps, même si, en la situation présente, ce terme devient la
désignation de la fin des temps, puisque le « troisième jour »,
dans la tradition juive, indique le jour de la résurrection des morts.
Quitter ce monde, monter aux cieux, est un euphémisme pour
signifier : mourir, ainsi que le soulignent (c) et (d). Mais, pour le Fils,
quitter ce monde passe par un événement très singulier : s’il passe par la
mort (d), ce à quoi correspond son ensevelissement (d’) et sa descente aux
enfers, au séjour des morts, par opposition à la mise en croix qui l’élevait
entre ciel et terre, le Fils inaugure alors une remontée par sa résurrection d’entre
les morts (c’) qui joue un rôle d’opposition par rapport à sa mort, comme
résultat de sa souffrance sous Ponce-Pilate.
Le fait de juger les vivants et les morts peut s’expliquer
directement par la mention du troisième jour. En effet, toujours dans la
tradition juive, ce jour est non seulement celui de la résurrection finale mais
aussi celui du jugement à la fin des temps.
Le récit concernant Jésus-Christ dans le Credo de Nicée-Constantinople
Il est possible de constituer un schéma comparable à celui
du Symbole pour le Credo, en utilisant les mêmes procédés de partition. Ce
tableau sera plus complexe parce que le récit se déploie dans une plus grande
extension.
|
|
|
et son règne n’aura pas de fin
pour juger les vivants et les morts
|
|
Engendré |
|
il reviendra dans la gloire |
|
non pas créé
de même nature |
|
|
|
que le Père |
Par l’Esprit-Saint |
il est assis à la droite du Père |
|
Pour nous, les hommes
et pour notre salut |
|
|
|
il descendit
du ciel |
il a pris chair
de la Vierge Marie |
et il monta
au ciel |
|
|
et s’est fait homme |
|
|
|
Crucifié
pour
nous
sous Ponce-Pilate
il souffrit sa passion |
il ressuscita
conformément aux Écritures
le troisième jour
|
Dans le Credo, le rôle du Fils est entièrement inscrit
entre une descente et une montée. Sa venue dans le monde des hommes, dans le
temps de l’histoire, marquée par une prise de chair de la part du Fils, est
un événement qui concerne tous les hommes, ce que met en relief le
« pour nous, les hommes, et pour notre salut », et se poursuit
après la montée au ciel, puisque « son règne n’aura pas de
fin » sur ceux qu’il aura préalablement jugés, c’est-à-dire
sauvés.
Le rôle de l’Esprit dans les confessions de foi
La troisième partie des confessions de foi ne renvoie pas
seulement à l’Esprit-Saint en tant que troisième personne de la Trinité,
mais plutôt et surtout au fait que l’Esprit est un don de Dieu aux hommes, à
tous ceux qui sont engagés dans la communauté de ceux qui croient au Christ.
Ce que les chrétiens affirment, quand ils proclament leur
foi, c’est que le « pour nous et pour notre salut » les atteint
encore aujourd’hui, dans leur vie quotidienne, dans la vie de Église, dans la
vie selon l’Esprit de Dieu, dans toute vie chrétienne authentique. Dire sa
foi devient alors non plus seulement proclamer des paroles, mais entrer dans un
processus. Et ce processus est calqué sur ce qui a eu cours dans l’existence
de Jésus de Nazareth. Affirmer sa foi devient synonyme d’engager toute sa vie
à la suite de Jésus-Christ. Dire la foi, c’est alors se pénétrer d’un
double mouvement : mouvement de la descente du Fils de Dieu sur la terre,
mouvement de la montée de cet homme Jésus-Christ au ciel.
Mais il faut le remarquer, le Christ est absent de l’histoire
de même que Jésus appartient à un passé qu’il est impossible de faire
revivre. Et c’est précisément l’absence de Jésus qui permet la
communication : c’est parce que le Christ est absent qu’il est possible de
parler de lui. La forme corporelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a disparu,
mais un message s’y est substitué, et ce message doit être entendu pour que
la confession de foi puisse naître. C’est la raison pour laquelle la
confession de foi baptismale peut paraître préférable, en ce sens que le
futur baptisé répond de sa foi à une proposition de foi de la part de Église
: Croyez-vous...? - Je crois. Ainsi le message est entendu et la foi peut s’exprimer
dans une réponse active.
Dans le cas de la proclamation commune, comme le Credo
dominical, c’est le « Amen » qui apparaît comme la ratification
de l’assemblée à l’ensemble de la proclamation de la foi.
« Amen » est une affirmation : « ainsi est-il, c’est
vrai », et non pas un simple souhait : « ainsi soit-il ». C’est
un terme d’origine araméenne qui indique que l’on est absolument d’accord,
dans le cas d’une réponse à une question. C’est aussi un terme qui
signifie l’importance, du point de vue de l’authenticité, de ce qui va
suivre, quand il est placé en tête d’une proposition : « en vérité,
vraiment ».
Pour en revenir au rôle de l’Esprit-Saint, il faut dire
que c’est lui qui permet d’exister véritablement comme le Christ le
demande. Ainsi, Karl Barth, dans son Esquisse d’une dogmatique, peut écrire :
« Avoir l’Esprit ne fait pas partie de l’état naturel de l’homme, c’est
toujours une marque distinctive accordée par un don de Dieu. Il ne s’agit
pas, à propos de l’Esprit-Saint, de quelque chose de différent du Christ, d’une
nouveauté... Le Saint Esprit n’est rien d’autre qu’une certaine relation
entre la Parole de Dieu et l’homme » (Esquisse d’une dogmatique).
Il n’est pas possible d’isoler l’Esprit de son action
et de sa manifestation concrète dans Église Église existe dans son rapport à
celui qui « est assis à la droite du Père ». Le pardon des
péchés est la suite logique du salut apporté aux hommes par la mort du Fils.
La résurrection de la chair résulte de l’espérance soulevée dans le coeur
des hommes par la résurrection du Christ. La vie éternelle, « la vie du
monde à venir » est la réalisation de la promesse de « celui qui
viendra juger les vivants et les morts ».
Celui qui confesse sa foi dans Église se reconnaît comme
transformé au plus profond de son existence, d’abord par son baptême, qui le
marque du signe de la croix, qui le fait entrer dans la forme d’existence qui
fut celle du Christ. Sa vie est transformée par la participation à la vie
même de Église, à la vie unique de la communauté qui se rassemble autour de
la même table eucharistique. Dès lors, la transformation de la vie humaine ne
saurait être le fait d’une décision venant exclusivement de l’homme, mais
cette transformation est la résultante d’un appel qui lui vient de l’extérieur.
Cet extérieur, c’est l’Esprit, en tant que ce dernier est le don que Dieu
fait à la communauté qui se rassemble au nom de Jésus-Christ, en réponse
également à la prédication apostolique.
Dans le Symbole et le Credo, l’Esprit est envisagé dans
son lien profond avec Église C’est ce que constatait Irénée de Lyon :
« Là où est Église, là aussi est l’Esprit de Dieu, et là où est l’Esprit
de Dieu, là est Église et toute grâce ».
L’Esprit et sa manifestation historique, Église, n’ont d’autre
tâche que de conduire l’homme au Christ, lequel introduit l’homme auprès
de son Père. Le sujet croyant doit alors parvenir à la connaissance de
Jésus-Christ et de celui qu’il révèle, le Père tout-puissant.
Je crois. Amen.
Tous les chrétiens partagent la même foi reçue des
apôtres. Pour tous, le Credo est un signe de reconnaissance mutuelle :
« Celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, soulignait saint
Jean, celui-là est un enfant de Dieu ».
La foi a été suscitée dans le coeur du croyant par une
initiative de Dieu. Lui, le premier, s’est toujours intéressé aux hommes,
alors qu’ils étaient pécheurs, détournés de lui. C’est toujours Dieu qui
est premier. Et pour montrer son amour aux hommes, il leur donne son Fils.
Le propre Fils de Dieu se fait homme pour que tous les
hommes, à leur tour, puissent devenir les enfants de Dieu.
La foi, suscitée par Dieu, amène à prendre une décision,
à faire un choix.
Dire « Je crois », c’est se laisser prendre par
le processus qui établit l’homme à la ressemblance de Jésus-Christ, mort et
ressuscité, c’est avoir part au destin du Christ. C’est dans une réponse,
personnelle et communautaire, ecclésiale, que réside la foi chrétienne.
Tous les baptisés sont fils de Dieu, par le Fils unique.
Tous, ils sont appelés à partager une seule espérance, celle de passer de la
mort à la vie, par la résurrection du Christ.
Dire « Amen », c’est accepter de remettre toute
sa confiance sur la seule Parole de Dieu, sur la Parole faite chaire,
Jésus-Christ, le seul Seigneur.
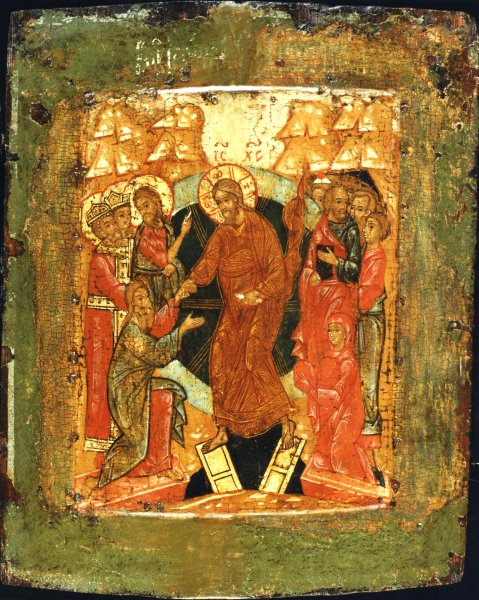 Dans
les premiers temps de l’Église, au moment des apôtres et des premiers
disciples qui avaient connu Jésus, la profession de foi était toute simple.
Pour être baptisé, pour faire partie de la communauté chrétienne, il
suffisait de dire : Je crois que Jésus est le Seigneur. Un peu à la fois, il a
fallu exprimer qui était Jésus, puisque les nouveaux chrétiens n’avaient
pas connu directement Jésus. La profession de foi a été amenée à raconter
également sa vie terrestre, sa mort et sa résurrection. Elle est devenue plus
explicite sur la vie de Jésus. Comme elle affirmait qu’il est Seigneur, c’est-à-dire
Dieu, il a été nécessaire de préciser qu’il était le Fils de Dieu et donc
d’expliquer qui était le Père. Et comme Jésus avait envoyé son Esprit sur
les apôtres et sur les chrétiens par la suite, il a fallu expliquer aussi qui
était l’Esprit Saint et quel était son rôle dans Église et dans la vie des
communautés chrétiennes. Ces communautés vivaient de plus deux dimensions
importantes de la foi : le pardon des péchés et des offenses, ainsi que l’espérance
en la résurrection et en la vie éternelle. Ces deux composantes de la foi sont
également entrées dans l’affirmation de la foi. C’est ainsi qu’est né
le Symbole de la foi que nous récitons chaque dimanche pendant la célébration
eucharistique. Au long des siècles, les chrétiens ont essayé d’exprimer
leur foi de différentes manières. Chaque fois que les chrétiens disent le
Credo, ils disent que depuis le commencement du monde jusqu’au retour du
Christ, ils forment une longue lignée de croyants, ils transmettent ce qu’ils
ont reçu, ils se disent les uns aux autres ce qu’ils ont reçu, ils se disent
les uns aux autres et ils disent à tous les hommes qu’ils font partie de l’immense
peuple que Dieu rassemble.
Dans
les premiers temps de l’Église, au moment des apôtres et des premiers
disciples qui avaient connu Jésus, la profession de foi était toute simple.
Pour être baptisé, pour faire partie de la communauté chrétienne, il
suffisait de dire : Je crois que Jésus est le Seigneur. Un peu à la fois, il a
fallu exprimer qui était Jésus, puisque les nouveaux chrétiens n’avaient
pas connu directement Jésus. La profession de foi a été amenée à raconter
également sa vie terrestre, sa mort et sa résurrection. Elle est devenue plus
explicite sur la vie de Jésus. Comme elle affirmait qu’il est Seigneur, c’est-à-dire
Dieu, il a été nécessaire de préciser qu’il était le Fils de Dieu et donc
d’expliquer qui était le Père. Et comme Jésus avait envoyé son Esprit sur
les apôtres et sur les chrétiens par la suite, il a fallu expliquer aussi qui
était l’Esprit Saint et quel était son rôle dans Église et dans la vie des
communautés chrétiennes. Ces communautés vivaient de plus deux dimensions
importantes de la foi : le pardon des péchés et des offenses, ainsi que l’espérance
en la résurrection et en la vie éternelle. Ces deux composantes de la foi sont
également entrées dans l’affirmation de la foi. C’est ainsi qu’est né
le Symbole de la foi que nous récitons chaque dimanche pendant la célébration
eucharistique. Au long des siècles, les chrétiens ont essayé d’exprimer
leur foi de différentes manières. Chaque fois que les chrétiens disent le
Credo, ils disent que depuis le commencement du monde jusqu’au retour du
Christ, ils forment une longue lignée de croyants, ils transmettent ce qu’ils
ont reçu, ils se disent les uns aux autres ce qu’ils ont reçu, ils se disent
les uns aux autres et ils disent à tous les hommes qu’ils font partie de l’immense
peuple que Dieu rassemble.
 La
fonction mythique est d’autant plus sensible que ce qui ne relève pas
immédiatement de l’histoire échappe au temps du récit pour être présenté
dans l’actualité du présent, ce qui n’est pas un véritable temps pour le
récit. Ainsi, le Père se trouve complètement dans la non-temporalité,
exprimée par l’absence de tout verbe ; ainsi, le Fils échappe lui aussi au
temps par son ascension, et l’Esprit développe son action dans le présent.
Et il est même possible de souligner que l’aspect historique, à savoir l’existence
concrète de Jésus de Nazareth, joue un rôle particulièrement important dans
cette fonction mythique : toute son activité sera d’échapper au temps de l’histoire,
en la faisant projeter dans un temps primordial, initial (l’engendrement de
toute éternité) et dans un avenir (son action prolongée par l’Esprit).
La
fonction mythique est d’autant plus sensible que ce qui ne relève pas
immédiatement de l’histoire échappe au temps du récit pour être présenté
dans l’actualité du présent, ce qui n’est pas un véritable temps pour le
récit. Ainsi, le Père se trouve complètement dans la non-temporalité,
exprimée par l’absence de tout verbe ; ainsi, le Fils échappe lui aussi au
temps par son ascension, et l’Esprit développe son action dans le présent.
Et il est même possible de souligner que l’aspect historique, à savoir l’existence
concrète de Jésus de Nazareth, joue un rôle particulièrement important dans
cette fonction mythique : toute son activité sera d’échapper au temps de l’histoire,
en la faisant projeter dans un temps primordial, initial (l’engendrement de
toute éternité) et dans un avenir (son action prolongée par l’Esprit).