Les premières communautés chrétiennes
 Le Nouveau Testament, dans un de ses livres, celui des Actes
des Apôtres retrace la vie et les activités des premières générations qui
ont accepté d'entendre la parole de Jésus de Nazareth comme une Parole venant
de Dieu lui-même. Ce livre se présente ainsi comme une sorte d'épopée des
premiers disciples se lançant à la conquête du monde, comme témoins de la
mort et de la résurrection du Christ. Le livre des Actes des Apôtres
s'inaugure par un court texte, relatant des derniers instants de Jésus au
milieu de ses disciples :
Le Nouveau Testament, dans un de ses livres, celui des Actes
des Apôtres retrace la vie et les activités des premières générations qui
ont accepté d'entendre la parole de Jésus de Nazareth comme une Parole venant
de Dieu lui-même. Ce livre se présente ainsi comme une sorte d'épopée des
premiers disciples se lançant à la conquête du monde, comme témoins de la
mort et de la résurrection du Christ. Le livre des Actes des Apôtres
s'inaugure par un court texte, relatant des derniers instants de Jésus au
milieu de ses disciples :
Ils étaient donc réunis et ils lui avaient posé cette question :
Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? Il leur répondit : Vous n'avez pas à connaître les temps et les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir
une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, vous serez alors
mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre. A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva et une
nuée vint le soustraire à leurs regards (Ac. 1, 6-9).
 Arguant de la présence de Jésus parmi eux, les disciples
peuvent l'interroger, afin de savoir si le temps de la restauration d'Israël
est enfin arrivé. Et, à la fin de cette péricope, Jésus est définitivement
absent. Il est enlevé aux regards de ses amis, par une nuée signifiant et
symbolisant la divinité à laquelle il retourne ; de cette façon, Jésus
accède à Dieu d'une manière visible pour ses disciples. Ceux-ci ont reçu de
sa part une promesse, qui sera, pour eux un ordre de mission : ils recevront
l'Esprit qui fera d'eux des témoins, et non seulement dans le cadre étroit du
pays d'Israël, mais aussi dans l'univers tout entier. L'espace de leur
prédication ne sera plus limité au seul peuple d'Israël vers lequel ils
tournaient encore leur espérance, l'espace leur est ouvert jusqu'à
l'extrémité de la terre. Parallèlement, le temps qui est le leur, ce n'est
plus le passé, mais l'avenir qui s'ouvre devant eux, par le fait même de la
disparition du Christ. La présence de Jésus au milieu d'eux leur permettait
encore de tourner les yeux vers le passé, vers la restauration royale en
Israël ; sa disparition et son absence définitive leur permettent de se
découvrir comme porteurs d'une nouvelle espérance, qui n'est plus sélective,
mais universelle. Ils auront une tâche à remplir, maintenant que le Christ
leur est absent. Il ne s'agit plus d'une connaissance des desseins secrets du
Dieu-Père, il ne s'agit pas davantage de travailler à la réalisation d'une
restauration royale en Israël, il s'agit pour eux de témoigner des actes du
Père en faveur de ce Jésus qui, à présent, est soustrait à leurs regards,
de témoigner finalement de la réalisation de la promesse du don de l'Esprit de
Dieu à tous les hommes. Le témoignage qui est demandé aux premiers disciples
n'a donc rien à voir avec une connaissance spéculative de Dieu : ils n'ont pas
à connaître Dieu en lui-même mais plutôt à rendre témoignage à cet homme
singulier qu'était Jésus de Nazareth, et qui est le révélateur du Dieu-Père.
C'est ce témoignage de la connaissance d'un homme singulier et unique, en qui
ils ont découvert l'action de Dieu qui est exigé de leur part ; la puissance
de l'Esprit leur permettra de reconnaître en Jésus le Serviteur de Dieu qui a
été glorifié par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Pères,
le Dieu-Père du peuple. L'absence de Jésus et la puissance de l'Esprit vont
permettre aux disciples de prendre la parole, d'exprimer ce qu'ils ont vécu
avec ce Jésus de Nazareth que les juifs ont livré, que les hommes ont
condamné à mort, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts... D'une
certaine manière, le Ressuscité, en disparaissant à la vue de ses disciples,
leur permet de devenir eux-mêmes, dans le témoignage qu'ils rendront de lui :
ce témoignage sera celui de la re-connaissance, celui d'une nouvelle naissance
à l'intérieur d'une communion avec Celui qui est ressuscité ; les disciples
auront alors un avenir marqué par une singularité, celle de la puissance de
l'Esprit qui leur sera donné, au jour de la Pentecôte. Et la tradition la plus
ancienne de l'Eglise découvre, dans cet événement de la Pentecôte, l'acte
fondateur de l'Eglise, précisément dans l'acte de la prise de parole par
Pierre, au nom de tous les disciples, en face des hommes rassemblés à
Jérusalem pour la célébration de la fête juive de Chavouoth.
Arguant de la présence de Jésus parmi eux, les disciples
peuvent l'interroger, afin de savoir si le temps de la restauration d'Israël
est enfin arrivé. Et, à la fin de cette péricope, Jésus est définitivement
absent. Il est enlevé aux regards de ses amis, par une nuée signifiant et
symbolisant la divinité à laquelle il retourne ; de cette façon, Jésus
accède à Dieu d'une manière visible pour ses disciples. Ceux-ci ont reçu de
sa part une promesse, qui sera, pour eux un ordre de mission : ils recevront
l'Esprit qui fera d'eux des témoins, et non seulement dans le cadre étroit du
pays d'Israël, mais aussi dans l'univers tout entier. L'espace de leur
prédication ne sera plus limité au seul peuple d'Israël vers lequel ils
tournaient encore leur espérance, l'espace leur est ouvert jusqu'à
l'extrémité de la terre. Parallèlement, le temps qui est le leur, ce n'est
plus le passé, mais l'avenir qui s'ouvre devant eux, par le fait même de la
disparition du Christ. La présence de Jésus au milieu d'eux leur permettait
encore de tourner les yeux vers le passé, vers la restauration royale en
Israël ; sa disparition et son absence définitive leur permettent de se
découvrir comme porteurs d'une nouvelle espérance, qui n'est plus sélective,
mais universelle. Ils auront une tâche à remplir, maintenant que le Christ
leur est absent. Il ne s'agit plus d'une connaissance des desseins secrets du
Dieu-Père, il ne s'agit pas davantage de travailler à la réalisation d'une
restauration royale en Israël, il s'agit pour eux de témoigner des actes du
Père en faveur de ce Jésus qui, à présent, est soustrait à leurs regards,
de témoigner finalement de la réalisation de la promesse du don de l'Esprit de
Dieu à tous les hommes. Le témoignage qui est demandé aux premiers disciples
n'a donc rien à voir avec une connaissance spéculative de Dieu : ils n'ont pas
à connaître Dieu en lui-même mais plutôt à rendre témoignage à cet homme
singulier qu'était Jésus de Nazareth, et qui est le révélateur du Dieu-Père.
C'est ce témoignage de la connaissance d'un homme singulier et unique, en qui
ils ont découvert l'action de Dieu qui est exigé de leur part ; la puissance
de l'Esprit leur permettra de reconnaître en Jésus le Serviteur de Dieu qui a
été glorifié par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Pères,
le Dieu-Père du peuple. L'absence de Jésus et la puissance de l'Esprit vont
permettre aux disciples de prendre la parole, d'exprimer ce qu'ils ont vécu
avec ce Jésus de Nazareth que les juifs ont livré, que les hommes ont
condamné à mort, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts... D'une
certaine manière, le Ressuscité, en disparaissant à la vue de ses disciples,
leur permet de devenir eux-mêmes, dans le témoignage qu'ils rendront de lui :
ce témoignage sera celui de la re-connaissance, celui d'une nouvelle naissance
à l'intérieur d'une communion avec Celui qui est ressuscité ; les disciples
auront alors un avenir marqué par une singularité, celle de la puissance de
l'Esprit qui leur sera donné, au jour de la Pentecôte. Et la tradition la plus
ancienne de l'Eglise découvre, dans cet événement de la Pentecôte, l'acte
fondateur de l'Eglise, précisément dans l'acte de la prise de parole par
Pierre, au nom de tous les disciples, en face des hommes rassemblés à
Jérusalem pour la célébration de la fête juive de Chavouoth.
Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins
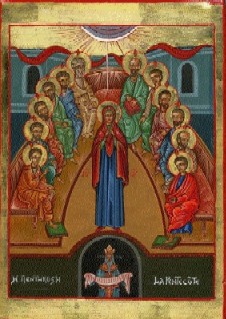 Il y a cinquante jours que les disciples avaient vécu les
événements de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Ils sont réunis
dans une maison, sans doute par crainte des juifs, qui auraient pu les
poursuivre comme ils avaient fait éliminer Jésus de Nazareth, leur maître,
sans doute aussi dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint, objet de la
dernière promesse du Christ, avant sa disparition définitive. Le rédacteur du
livre des Actes des Apôtres qui est le rédacteur de l'évangile selon saint
Luc, situe ce don de l'Esprit au jour de la fête juive de Chavouoth, la fête
qui renouvelait l'alliance passée entre Dieu et son peuple sur le mont Sinaï.
Et l'événement du don de l'Esprit est décrit avec les mêmes images que les
traditions juives reconnaissaient à l'événement du don de la Loi à Moïse :
il s'agit d'un bruit, comme un violent coup de vent, d'une apparition de feu,
comme des langues de feu qui se répandent sur tous les disciples présents,
deux images traditionnelles pour signifier l'action de Dieu, et qui permettent
d'exprimer une réalité essentielle, mais invisible pour les yeux : Tous
furent alors remplis de l'Esprit-Saint (Ac. 2,4).
Il y a cinquante jours que les disciples avaient vécu les
événements de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Ils sont réunis
dans une maison, sans doute par crainte des juifs, qui auraient pu les
poursuivre comme ils avaient fait éliminer Jésus de Nazareth, leur maître,
sans doute aussi dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint, objet de la
dernière promesse du Christ, avant sa disparition définitive. Le rédacteur du
livre des Actes des Apôtres qui est le rédacteur de l'évangile selon saint
Luc, situe ce don de l'Esprit au jour de la fête juive de Chavouoth, la fête
qui renouvelait l'alliance passée entre Dieu et son peuple sur le mont Sinaï.
Et l'événement du don de l'Esprit est décrit avec les mêmes images que les
traditions juives reconnaissaient à l'événement du don de la Loi à Moïse :
il s'agit d'un bruit, comme un violent coup de vent, d'une apparition de feu,
comme des langues de feu qui se répandent sur tous les disciples présents,
deux images traditionnelles pour signifier l'action de Dieu, et qui permettent
d'exprimer une réalité essentielle, mais invisible pour les yeux : Tous
furent alors remplis de l'Esprit-Saint (Ac. 2,4).
Et la présence de cet Esprit se manifeste encore par un fait
sensible : ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. Ce phénomène, qui a fait couler beaucoup d'encre,
au cours de l'histoire de l'Eglise, signifie peut-être tout simplement que le
message dont les disciples seront les porteurs pourra être compris par tous les
peuples de la terre : Pierre et les apôtres prennent la parole, d'une façon
telle que chacun, en les entendant, comprend qu'il s'agit de Dieu, qu'il s'agit
des merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir pour son peuple, Et le récit se
poursuit par l'interprétation que Pierre donne de l'événement. Un tableau
initial présente cette prise de parole de Pierre, au milieu des onze autres
apôtres ; et le tableau final constate que ceux qui accueillirent sa parole et
se joignirent aux douze sont au nombre de trois mille. Cet accroissement
numérique est dû au fait que la parole émise a été entendue, qu'elle a
trouvé un écho favorable auprès des foules rassemblées.
L'efficacité de la parole de Pierre n'est pourtant pas due
à l'éloquence de celui-ci : son discours n'a rien d'une démonstration
rhétorique, il se présente sous la forme du témoignage, c'est-à-dire d'une
reconnaissance de l'action de Dieu dans les événements qui affectent à la
fois certains hommes du peuple juif, et, en particulier, l'homme Jésus. Ce
discours de Pierre est émaillé de citations, relativement longues de l'Ancien
Testament, signe que Pierre ne se situe pas en dehors des perspectives
religieuses de ses auditeurs, mais signe également que l'événement de la
Pentecôte se situe bien dans la continuité du peuple. Cette référence à
l'Ancien Testament recouvre une double fonction : d'abord, elle permet
l'explicitation scripturaire de l'événement, et ensuite, elle met en relief
cet événement qui est présente comme une action de Dieu, dans l'aujourd'hui
de l'histoire de son peuple. Pierre fait donc l'exégèse de l'événement,
qu'il rattache à la prophétie de Joël (Ac. 2, 17-21) ; cet événement, c'est
aussi celui de la Pâque, celui de la Résurrection, prophétisée par David (Ac.
2, 25-28), et pourtant, David est mort, alors que Dieu a ressuscité ce Jésus,
selon la promesse faite à David. Car Dieu a fait Christ et Seigneur ce Jésus
qui a été crucifié par la main des hommes. L'intervention de Dieu en faveur
de Jésus de Nazareth est rattachée à l'espérance et à la foi du peuple :
Dieu réalise ce qu'il a promis aux hommes, il se fait proche d'eux, en étant
dans la proximité immédiate d'un homme qui a vécu au milieu des autres
hommes, sans que ceux-ci reconnaissent en lui l'action directe de Dieu.
 La conclusion légitime que Pierre tire de l'interprétation
de l'événement de Pentecôte, c'est celle-ci : ce que David avait prévu pour
le Christ s'est réalisé pour Jésus, et donc Jésus a été fait Christ et
Seigneur par la puissance de Dieu qui l'a exalté. Tout le kérygme primitif,
toute la profession de foi de l'Eglise de la première génération se trouve
résumé dans la conclusion de ce discours de Pierre : Que toute la maison
d'Israël le sache avec certitude : Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous, vous aviez crucifié (Ac 2 36).
La conclusion légitime que Pierre tire de l'interprétation
de l'événement de Pentecôte, c'est celle-ci : ce que David avait prévu pour
le Christ s'est réalisé pour Jésus, et donc Jésus a été fait Christ et
Seigneur par la puissance de Dieu qui l'a exalté. Tout le kérygme primitif,
toute la profession de foi de l'Eglise de la première génération se trouve
résumé dans la conclusion de ce discours de Pierre : Que toute la maison
d'Israël le sache avec certitude : Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous, vous aviez crucifié (Ac 2 36).
Ayant ainsi pris la parole, Pierre marque le double
caractère de la prédication apostolique : elle est une prise de parole par un
homme, certes, mais elle renvoie immédiatement à une action de Dieu. Cette
action est immédiatement constatable par les hommes qui furent les témoins de
l'événement de la Pentecôte, mais, pour ces mêmes hommes, et pour les
générations ultérieures, elle est aussi constatable de façon médiate, à
savoir par le témoignage que les disciples rendent à l'action de Dieu en
faveur de Jésus. Ce double caractère de la prédication, dans la médiateté
comme dans l'immédiateté, vérifie que la prise de parole des disciples n'est
en aucune façon une prise de pouvoir par les hommes ; au contraire, la prise de
parole se présente comme la forme de dépossession de tout pouvoir afin de
recevoir la puissance de Celui qui permet de parler, puissance de l'Esprit qui
permet de découvrir la trace de l'action de Dieu dans les faits les plus
quotidiens de l'existence de Jésus de Nazareth et de l'existence de la
première Eglise.
La communauté de Jérusalem
Avant l'événement de la Pentecôte, la tentation aurait pu
être grande pour les disciples de se transformer en une sorte de 'club privé'
rassemblant les anciens amis de Jésus. Le don de l'Esprit va ouvrir la
communauté des disciples à l'échelle du monde entier.
La parole de Pierre trouve un écho auprès des hommes qui
furent les témoins de l'événement. Non seulement, ils écoutent cette parole,
mais aussi et surtout ils se décident à faire quelque chose, afin de mettre en
pratique ce qu'ils viennent d'entendre. La communauté qui s'était constituée
dans l'écoute de la parole et dans la compréhension de la prédication de
Pierre va se transformer en une communauté d'action, de mise en oeuvre de la
parole, avant de devenir une communauté de vie fraternelle et de partage. La
réponse que Pierre fait à l'interrogation de la foule : Que ferons-nous,
frères ? (Ac. 2, 37) n'exprime rien d'autre qu'une invitation à participer
à la singularité du destin de Jésus, à entreprendre une nouvelle naissance,
par le baptême et par le don de l'Esprit. Le nom de Jésus devient
l'efficacité de ce nouveau genre d'existence qui s'amorce, de cette nouvelle
communauté qui prend naissance.
Le rédacteur du livre des Actes des Apôtres va s'attacher
à décrire la communauté de Jérusalem, présentant quelques tableaux
dessinant les traits essentiels de cette communauté. Ces tableaux, qui
paraissent idylliques, sont appelés 'sommaires' :
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout
le monde : beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les
apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient
tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en
partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun, Unanimes, ils se
rendaient chaque jour assidûment au Temple ; ils rompaient le pain à
domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de
coeur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple
tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui
trouvaient le salut (Ac. 2, 42-47).
Ce premier 'sommaire' vise à souligner l'aspect de l'unité
qui pouvait exister entre les membres de la première communauté chrétienne.
Cette unité est signifiée par quatre éléments qui la fondent dans son
authenticité évangélique : l'enseignement des apôtres la communion
fraternelle, la fraction du pain et la prière, C'est l'enseignement apostolique
qui enracine la communauté dans son unité, lui permettant de rester fidèle à
l'annonce de l'Evangile proclamé par Jésus, depuis le jour de son baptême par
Jean dans les eaux du Jourdain jusqu'à sa résurrection d'entre les morts.
Autrement dit, l'unité véritable de la communauté ne vient pas de la volonté
de ses membres de constituer eux-mêmes un groupe fraternel mais de la volonté
du Christ, sans lequel il ne pourrait pas y avoir de communauté authentique.
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un coeur et
qu'une âme et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses
biens ; au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance
marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur
Jésus et une grande grâce était à l'oeuvre chez eux tous. Nul parmi eux
n'était indigent : en effet ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou
de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés
et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon
ses besoins (Ac. 4, 32-35).
Ce deuxième 'sommaire' insiste davantage sur le partage des
biens qui avait simplement été évoqué dans le premier. Ce partage était
volontaire et non pas imposé, comme pouvait l'être à la même époque le
partage des biens entre les membres de la secte essénienne installée à Qumran
: la mise en commun des biens n'était pas aussi générale que ne le laisse
entendre ce bref récit. D'ailleurs, une correction à cette généralisation
sera apportée par Pierre, dans l'épisode d'Ananie et Saphire qui suit ce
sommaire. La règle de cette mise en commun des biens repose seulement sur la
satisfaction des besoins de chacun, et elle n'impose aucune hiérarchie : la
communauté des biens signifie la communion des coeurs. Et la mort très
spectaculaire de deux disciples, Ananias et Saphire, illustre le fait que le
partage des biens n'est pas une chose aisée (même s'il ne s'agissait que d'une
pratique recommandée et non pas imposée) : malgré tout son désir d'unité et
de partage, la première communauté n'est pas à l'abri de nouvelles ruptures
de l'alliance entre les hommes et Dieu, l'Eglise naissante ne cesse de
connaître le drame du péché et du mal qui est susceptible de l'affecter en
chacun de ses membres. Ce récit, quelque peu étrange aux yeux de nombreux
commentateurs, témoigne du fait qu'il ne faut pas trop idéaliser la première
communauté chrétienne, même si Luc, le chroniqueur des Actes, ne cesse de la
présenter comme une sorte d'idéal de communion : l'Eglise, faite de membres
pécheurs, n'atteindra peut-être jamais cet idéal de perfection, mais elle
n'en a pas pour autant le droit de s'installer dans des pratiques contraires à
la visée évangélique de l'union des coeurs et du partage fraternel.
Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la
main des apôtres. Ils se tenaient tous, unanimes, sous le portique de
Salomon, mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux ; le peuple faisait
pourtant leur éloge, et des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et
de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. On en venait à sortir les
malades dans les rues, on les plaçait sur des lits ou des civières, afin que
Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. La multitude
accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et
des gens que tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris (Ac.
5, 12-16).
Ce troisième 'sommaire' souligne l'efficacité de l'Esprit
qui accompagne les activités des apôtres, par les signes et les prodiges qui
les instituent dans le prolongement des activités de Jésus : les apôtres
continuent les signes que Jésus accomplissait pour signifier la venue du
Royaume de Dieu. Si les foules n'osent pas s'approcher des apôtres, alors
qu'ils enseignent sous le portique du Temple, elles n'hésitent cependant pas à
placer les malades sur le chemin de Pierre, avec la croyance presque assurée
qu'ils seront guéris par le simple passage de l'ombre de l'apôtre sur eux. Les
plus démunis religieusement expriment ainsi leur conviction dans la puissance
divine qui s'exprime dans la prédication des apôtres.
Le tableau de la première communauté de Jérusalem dressé
par Luc a certainement été idéalisé : tout n'allait certainement pas pour le
mieux dans l'Eglise de Jérusalem, malgré le partage des biens, et des
dissensions ont provoqué des discussions et des mésententes entre les
différents membres de la communauté... Mais Luc a en quelque sorte idéalisé
cette première communauté, non pas pour en dresser un tableau déformé, mais
simplement pour la proposer comme une sorte d'idéal auquel devraient parvenir
toutes les communautés qui se réclamaient du Christ Jésus. L'idéal à
rechercher n'est pas un état de pauvreté matérielle, laquelle est
considérée, dans toute la Bible, comme un mal contre lequel Dieu lui-même
s'insurge : l'idéal ne réside pas dans la pauvreté, mais dans la communauté
où il n'existe plus d'indigents.
Un tel idéal était déjà prôné, à l'époque, par les
membres de la secte essénienne de Qumran, ou encore par les membres du courant
baptiste, ou encore même par les pharisiens... Aux yeux des juifs fidèles à
la tradition des pères, les disciples de ce Jésus de Nazareth ne pouvaient
constituer rien d'autre qu'une secte semblable à toutes celles qui foisonnaient
à l'époque, sans que le terme 'secte' connaisse la même nuance péjorative
qu'au vingtième siècle. Cette nouvelle secte, appelée parfois secte des
Nazoréens, paraît aberrante : ses membres vénèrent comme un dieu un homme
qui a été crucifié par les responsables du peuple juif, ils prétendent agir
en son nom qu'ils ne cessent de proclamer en tous lieux et en tous temps, et
pourtant Ils continuent à pratiquer la Loi juive en fréquentant assidûment le
Temple, surtout pour les prières prescrites par le rituel juif. Les
responsables du peuple juif ne pouvaient que s'émouvoir d'une telle situation :
les disciples de ce Jésus respectaient les autorités, mais n'hésitaient
cependant pas à se dresser contre elles, quand cela leur paraissait
nécessaire, au risque d'effectuer des séjours dans les prisons, au risque
également de connaître les tortures... Aussi est-ce finalement à l'opinion
d'un pharisien, de tendance modérée, Gamaliel, que se rangèrent les
extrémistes : Si c'est des hommes que vient leur résolution, elle
disparaîtra d'elle-même ; si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas la défaire.
N'allez pas vous risquer de vous trouver en conflit avec Dieu (Ac. 5,
38-39).
Pourtant cette solution attentiste ne pourra pas durer : bien
qu'il se prétende dans la continuité du judaïsme, le nouveau groupe se pose
en contradiction avec celui-ci. La prédication de Jésus, Christ et Seigneur,
élevé au même rang que Dieu, est intolérable pour les maîtres et les
docteurs de la Loi juive, dont la théologie ne cesse d'affirmer le monothéisme
absolu. Une telle présentation du message d'un homme, dont la vie a été
connue et dont la mort a été ignominieuse, est en contradiction flagrante avec
l'enseignement traditionnel, et elle apparaît comme dangereuse pour la
communauté juive. Et, c'est précisément à cause de sa foi juive que le
pharisien et maître de la Loi, Saul, ne craindra pas de persécuter la secte
naissante, et dont le nombre des disciples ne cessait d'augmenter.
Dans la communauté de Jérusalem existait un groupe, qui
était quelque peu marginalisé : les Hellénistes. Ceux-ci étaient
vraisemblablement des juifs venus de la Diaspora, de la Dispersion juive à
travers le monde, retournés sur la terre ancestrale pour y mourir ou, du moins,
pour y achever, dans la paix, leurs dernières années. Ces Hellénistes, nés
hors du territoire de Palestine, parlaient le grec, alors que les Hébreux, nés
en Palestine, parlaient l'araméen. Les disciples de Jésus se recrutant d'abord
parmi les juifs, il est normal de constater l'existence de ces deux groupes
parmi eux. Les Hellénistes semblent être déjà bien organisés, avec leurs
responsables propres : les 'Sept', qui sont de véritables chefs de communauté.
Un conflit entre les deux tendances était inévitable, et ce conflit se situait
au niveau même de la hiérarchie : en imposant les mains aux Sept, les apôtres
reconnaissent une véritable autorité aux chefs des communautés hellénistes.
L'ensemble de la communauté des disciples pourra ainsi s'étendre en dehors des
frontières linguistiques : l'Eglise naissante s'ouvrait sur le monde. Et parmi
les Sept, Etienne travaillera particulièrement à l'expansion missionnaire,
rompant avec le judaïsme officiel, ce qui lui vaudra la condamnation à mort.
Sa mort, Luc la décrit en reprenant les thèmes et les images de la mort de
Jésus : par la mort du disciple zélé, c'est la Passion du Christ qui se
poursuit. Parmi les témoins de sa mort, Saul de Tarse, un jeune rabbi,
fermement ancré dans les traditions ancestrales et décidé résolument à ne
pas laisser l'hérésie se propager. Pourtant, après sa conversion, Saul
poursuivra l'oeuvre entreprise par Etienne, étendant l'Eglise aux dimensions du
monde.
La vocation de Paul
 Malgré l'usage, il est préférable de parler d'une vocation
de Paul, plutôt que d'une conversion. En effet, Saul de Tarse, juif pieux,
profondément croyant et instruit dans les traditions de ses pères dans la foi,
ne pouvait pas 'se convertir' au sens strict, c'est-à-dire se détourner des
idoles pour se tourner vers le Dieu unique et véritable puisqu'il l'adorait
déjà.
Malgré l'usage, il est préférable de parler d'une vocation
de Paul, plutôt que d'une conversion. En effet, Saul de Tarse, juif pieux,
profondément croyant et instruit dans les traditions de ses pères dans la foi,
ne pouvait pas 'se convertir' au sens strict, c'est-à-dire se détourner des
idoles pour se tourner vers le Dieu unique et véritable puisqu'il l'adorait
déjà.
Saul persécutait l'Eglise, et plus spécialement les
Hellénistes, qui s'étaient fait les plus ardents défenseurs de la nouvelle
doctrine. Ce sont les Hellénistes qui sont particulièrement visés par cette
première persécution du monde juif, car la tendance hébraïque, conduite par
les Douze, semble échapper pour un temps aux tracasseries juives, puisqu'elle
suit encore fidèlement les pratiques traditionnelles. Les Hellénistes
préconisaient l'abandon de la stricte observance des préceptes de la Loi, et
l'attitude de Saul, zélé défenseur de la foi juive, se comprend assez
facilement devant la menace qui se précisait d'un abandon de la tradition.
La vocation de Saul va constituer un tournant dans la vie de
la première communauté chrétienne, et le rédacteur des Actes des Apôtres va
présenter trois récits de cette vocation, soulignant ainsi l'importance qu'il
attachait à un tel événement. Malgré les variantes qui existent entre ces
trois récits (Ac. 9, 1-30 ; Ac. 22, 1-21 et Ac. 26, 2-23), Luc va insister sur
ce qui constitue le coeur même de cette vocation : la rencontre avec le
Ressuscité dans sa gloire qui s'identifie à la communauté persécutée.
Changeant alors radicalement de vie, Paul, tel sera désormais le nom de celui
qui fut le persécuteur des disciples, va se mettre très rapidement au service
de l'évangélisation, n'hésitant pas à faire sortir la nouvelle foi des
cadres étroits du judaïsme.
Les Hellénistes, pourchassés en Palestine par la
persécution juive, se sont réfugiés à Antioche ; et là, ils enseignent le
nom de Jésus à des non-juifs, qui se tournent aussitôt vers la voie du
Christ. Les païens eux-mêmes se convertissent à l'Evangile, et le succès de
la prédication des Hellénistes est tel que la nouvelle en parvient rapidement
à Jérusalem, d'où Barnabé est envoyé pour authentifier ces conversions.
Barnabé prendra avec lui Paul, et tous deux travailleront une année entière
dans l'Eglise d'Antioche. Et c'est à Antioche que, pour la première fois,
le nom de 'chrétiens' fut donné aux disciples (Ac. 11, 26).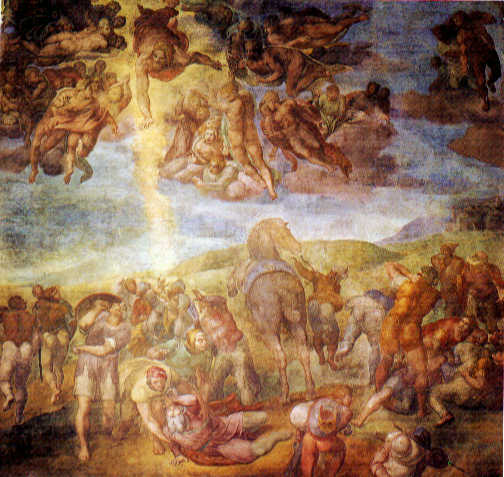
Cette apparition d'un nouveau terme dans le vocabulaire
manifeste que l'Eglise d'Antioche n'est plus perçue comme une secte juive
particulière, mais comme un groupe religieux nouveau qui se réclame
directement du Christ. Cette même Eglise d'Antioche va être à l'origine d'une
mission vers les païens, puisque les juifs avaient refusé d'accueillir l'Evangile
: Barnabé et Paul sont envoyés en mission en Asie Mineure. Mais cette nouvelle
orientation dans l'évangélisation pouvait facilement entraîner une crise dans
l'Eglise : comment était-il possible de concilier la recommandation de Jésus,
qui conseillait à ses disciples de ne pas se tourner vers les païens, mais de
rechercher les brebis perdues de la maison d'Israël avec cette ouverture de l'Eglise
aux païens ? En adoptant une telle attitude, Paul se laissait-il conduire par
l'Esprit ou ne se laissait-il pas emporter par les événements ? La question
allait rebondir à l'occasion du concile de Jérusalem. Cette question se
précisait d'ailleurs dans le problème de la circoncision : si des païens
embrassent la foi en Jésus-Christ, doivent-ils nécessairement adopter en
préalable la Loi mosaïque, et en particulier l'obligation de la circoncision,
comme signe de leur appartenance au peuple élu ? Autrement dit, pour se
convertir au christianisme, faut-il nécessairement se convertir d'abord au
judaïsme ? Pour Paul, la question sera de savoir si l'homme est sauvé par sa
foi au Christ Jésus ou par la circoncision. Et quand Paul et Barnabé arrivent
à Jérusalem, tout heureux des conversions qu'ils avaient vu s'accomplir par
leur prédication de l'Evangile dans le monde païen, cette question essentielle
pour certains judéo-chrétiens fut immédiatement soulevée ; pour eux, il
fallait d'abord devenir juif par la circoncision pour devenir chrétien. Dans
l'assemblée des apôtres et des anciens, à laquelle on donne habituellement le
nom de 'concile de Jérusalem', Pierre intervient pour dire que c'est par la
grâce de Jésus-Christ que les hommes sont sauvés et qu'il n'y a pas lieu
d'imposer un trop lourd fardeau - que les juifs eux-mêmes n'ont pas été
capables de porter - sur les épaules des païens qui se convertissaient, Des
délégués furent alors choisis pour accompagner Paul et Barnabé auprès des
pagano-chrétiens ; une lettre leur sera confiée pour leur signifier les
décisions prises à leur sujet :
Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d'origine
païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons
appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser
vos esprits par leurs propos ; ils n'en étaient pas chargés. Nous avons
décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec
nos chers Paul et Barnabé, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de
notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous
communiquer de vive voix les mêmes directives. L'Esprit-Saint et nous-mêmes,
nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces
exigences inévitables : vous abstenir des viandes de sacrifices païens, du
sang, des animaux étouffés et de l'immoralité. Si vous évitez tout cela
avec soin, vous aurez bien agi. Adieu ! (Ac. 15, 23-29).
Après cette assemblée de Jérusalem, Pierre disparaît de
la scène du livre des Actes des Apôtres. Son rôle s'achève et s'épuise dans
le fait qu'il ait permis à l'Eglise de s'ouvrir à tous les hommes sans
exception : l'Eglise est pour tous, telle est la plus grande décision du
concile de Jérusalem. Il ne reste plus qu'à l'étendre aux dimensions du
monde. Telle sera la mission de Paul, qui conduira la connaissance du nom de
Jésus jusque dans la capitale de l'empire romain. La description de la mission
de Paul par Luc souligne la profonde collaboration de l'Esprit de Dieu avec le
missionnaire Mais, quand l'apôtre s'en remet à ses seules forces ou à son
seul talent de persuasion, le résultat est lamentable : la prédication de Paul
devant les philosophes et le peuple athénien est un échec retentissant, bien
que l'apôtre utilisât toutes les subtilités de la rhétorique grecque, pour
démontrer la vanité de tout culte aux faux-dieux.
Dans toutes les villes qu'il visite et où il séjourne, Paul
fonde des communautés chrétiennes avec lesquelles il entretiendra des
relations épistolaires. La communauté de Philippes restera la préférée dans
le coeur de Paul : c'est d'elle seule qu'il acceptera une aide financière,
alors qu'il se trouvait à Thessalonique, prêchant le Dieu unique qu'il faut
servir et non pas simplement honorer. Après son échec à l'Aréopage
d'Athènes, il se rend à Corinthe où les païens, en plus grand nombre que les
juifs, lui font bon accueil, et où les chrétiens d'origines sociales les plus
diverses se côtoyaient : ce séjour à Corinthe lui permet d'affronter la
mentalité païenne et d'esquisser une première morale chrétienne. En quittant
Corinthe, Paul se rend de nouveau à Ephèse, puis à Jérusalem, avant de
revenir pour quelque temps à Antioche. Ensuite, il regagne Ephèse, où lors de
son précédent passage il n'avait guère voulu demeurer longtemps, promettant :
Je reviendrai chez vous une autre fois si Dieu le veut (Ac. 18, 21).
A Ephèse, il rencontre des 'johannites' qui s'étaient
convertis à la voie de Jésus Christ, mais qui ignoraient jusqu'à l'existence
de l'Esprit Saint : Luc souligne de cette façon la persistance du courant
baptiste dans le monde de la Dispersion juive. Paul passe alors en Grèce, avant
de regagner Jérusalem pour porter à la mère des Eglises le montant d'uns
collecte organisée par les jeunes Eglises, que Paul explique et justifie dans
une lettre aux Corinthiens : Le service de cette collecte ne doit pas
seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de
grâce envers Dieu. Appréciant ce service à sa valeur, ils glorifieront Dieu
pour l'obéissance que vous professez envers l'Evangile du Christ et pour votre
libéralité dans la mise en commun avec eux et avec tous. Et par leur prière
pour vous, ils vous manifesteront leur tendresse à cause de la grâce
surabondante que Dieu vous a accordée (2 Co, 9, 12-14).
Luc, le rédacteur du livre des Actes des Apôtres présente
la montée de Paul à Jérusalem en des termes qui ne sont pas sans évoquer la
montée de Jésus à la ville sainte, là où il dut être crucifié. Et Paul
semble être prêt à rendre le témoignage suprême à son maître ; il affirme
même : je suis prêt, moi, non seulement à être lié mais à mourir à
Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus (Ac. 21, 13).
Arrêté dans le Temple, presque lynché par une foule qui
l'accusait d'avoir fait pénétrer un païen dans le lieu saint, il est amené
à proposer sa propre défense, en reprenant toute l'histoire de sa vie, avec le
moment essentiel de sa vocation sur le chemin de Damas. Pour éviter une menace
de la foule, le tribun romain ordonne de faire enfermer Paul dans une prison et
de le faire fouetter ; mais celui-ci révèle sa citoyenneté romaine, qui lui
donnait certains privilèges. Traduit par ce tribun devant le tribunal juif, le
sanhédrin, Paul suscite habilement un conflit entre les deux tendances,
pharisienne et saducéenne, qui composaient le tribunal et qui se trouvaient en
profond désaccord sur la question de la résurrection d'entre les morts... Paul
est reconduit en prison, où; dans le courant de la nuit, le Seigneur se
présenta à Paul et lui dit : Courage ! Tu viens de rendre témoignage à ma
cause à Jérusalem, il faut qu'à Rome aussi tu témoignes de même (Ac.
23, 11).
Le procurateur romain, pour satisfaire les juifs, laisse Paul
en prison pendant deux ans. Puis quand Festus remplace le procurateur Felix,
Paul refuse de se laisser juger par le tribunal juif : il proclame son innocence
en face de toutes les institutions juives, et, finalement, arguant de sa
citoyenneté romaine, il en appelle au jugement de l'empereur : Je suis
devant le tribunal de l'empereur, c'est donc là que je dois être jugé. Les
juifs, je ne leur ai fait aucun tort, comme tu t'en rends toi-même parfaitement
compte. Si vraiment je suis coupable, si j'ai commis quelque crime qui mérite
la mort, je ne prétends pas me soustraire à la mort. Mais, si les accusations
dont ces gens me chargent se réduisent à rien, personne n'a le droit de me
livrer à leur merci. J'en appelle à l'empereur (Ac. 25, 10-11).
 Quelques jours plus tard, le roi Marcus Julius Agrippa, roi
d'une province du Liban, vient rendre visite à Festus, qui profite de cette
visite pour instruire le rapport qu'il doit envoyer à Rome, au sujet de Paul.
Agrippa, connaissant la Loi juive, pouvait aider le procurateur dans sa tâche
d'élucider les querelles religieuses entre les juifs, querelles relatives à
la religion qui leur est propre et en particulier à un certain Jésus qui est
mort et que Paul prétendait toujours en vie (Ac. 25, 19).
Quelques jours plus tard, le roi Marcus Julius Agrippa, roi
d'une province du Liban, vient rendre visite à Festus, qui profite de cette
visite pour instruire le rapport qu'il doit envoyer à Rome, au sujet de Paul.
Agrippa, connaissant la Loi juive, pouvait aider le procurateur dans sa tâche
d'élucider les querelles religieuses entre les juifs, querelles relatives à
la religion qui leur est propre et en particulier à un certain Jésus qui est
mort et que Paul prétendait toujours en vie (Ac. 25, 19).
Paul, autorisé à plaider sa cause devant le roi Agrippa,
résume l'ensemble de sa prédication : Fort de la protection de Dieu,
jusqu'à ce jour je continue donc à rendre témoignage devant petits et grands
; les prophètes ont prédit ce qui devait arriver et je ne dis rien de plus :
le Christ a souffert et lui, le premier à ressusciter d'entre les morts, il
doit annoncer la lumière au peuple et aux nations païennes (Ac. 26,
22-23).
A la suite de sa plaidoirie, qui le constituait comme
innocent devant ses deux juges, Paul est envoyé à Rome, pour la simple raison
qu'il en avait appelé à l'empereur pour statuer sur son cas. Le voyage vers
Rome fut agité, les vents étaient contraires, la tempête conduisit le navire
au naufrage, mais sans qu'il y ait perte de vie humaine, sur l'île de Malte.
Après trois mois d'hivernage, Paul et ses gardes reprirent leur voyage vers
Rome, où il sera placé en résidence surveillée : il avait obtenu
l'autorisation d'avoir un domicile personnel, avec un soldat pour le garder
(Ac. 28, 16).
Le livre des Actes des Apôtres se termine sur une note
relativement optimiste : Paul vécut ainsi deux années entières à ses
frais et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le Règne de
Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière
assurance et sans entraves (Ac. 28, 30-31).
Rien, dans ce livre, ne permet de connaître la destinée de
Paul ; la tradition chrétienne suppose qu'il a été exécuté, au cours d'une
persécution qui a sévi sur l'ensemble de l'Eglise ; mais il n'est pas possible
de signaler que cette persécution s'est abattue sur l'Eglise, à la fin de
l'assignation à résidence surveillée de Paul, Ce qui importe surtout, aux
yeux du rédacteur des Actes des Apôtres, ce n'est pas le sort historique de
Paul, mais bien le fait que l'annonce de l'Evangile s'est faite jusqu'à
l'extrémité du monde... Sans doute, le martyre de Paul était connu et il
importait bien peu à cet historien des origines de l'Eglise de signaler ce
petit fait divers dans sa grande chronique : l'important est bien que le lecteur
concentre toute son attention au fait que la Parole de Dieu - qui est finalement
le personnage le plus impressionnant de l'ensemble du livre - ne peut être
arrêtée par aucune instance humaine. De même que Jésus n'a pas pu être
retenu dans les filets de la mort, de même la prédication de l'Evangile et de
la venue du Royaume de Dieu ne pourra connaître aucun obstacle. La vie de Paul
s'achève par son exécution, un châtiment qui était réservé aux citoyens
romains, une mort noble par décapitation. Et la tradition chrétienne
ultérieure associera les deux grands apôtres, Pierre et Paul, dans un même
témoignage au Christ, dans un martyre simultané, à proximité du mont
Vatican, sur la voie romaine d'Ostie.
Avec la mort des deux 'grandes colonnes de l'Eglise'
s'achève l'épopée des premières générations chrétiennes ; mais la Parole
de Jésus s'était répandue dans le monde entier. La promesse de Jésus, au
jour de son Ascension, est réalisée : Vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la
terre (Ac. 1, 8).
 Le Nouveau Testament, dans un de ses livres, celui des Actes
des Apôtres retrace la vie et les activités des premières générations qui
ont accepté d'entendre la parole de Jésus de Nazareth comme une Parole venant
de Dieu lui-même. Ce livre se présente ainsi comme une sorte d'épopée des
premiers disciples se lançant à la conquête du monde, comme témoins de la
mort et de la résurrection du Christ. Le livre des Actes des Apôtres
s'inaugure par un court texte, relatant des derniers instants de Jésus au
milieu de ses disciples :
Le Nouveau Testament, dans un de ses livres, celui des Actes
des Apôtres retrace la vie et les activités des premières générations qui
ont accepté d'entendre la parole de Jésus de Nazareth comme une Parole venant
de Dieu lui-même. Ce livre se présente ainsi comme une sorte d'épopée des
premiers disciples se lançant à la conquête du monde, comme témoins de la
mort et de la résurrection du Christ. Le livre des Actes des Apôtres
s'inaugure par un court texte, relatant des derniers instants de Jésus au
milieu de ses disciples : Arguant de la présence de Jésus parmi eux, les disciples
peuvent l'interroger, afin de savoir si le temps de la restauration d'Israël
est enfin arrivé. Et, à la fin de cette péricope, Jésus est définitivement
absent. Il est enlevé aux regards de ses amis, par une nuée signifiant et
symbolisant la divinité à laquelle il retourne ; de cette façon, Jésus
accède à Dieu d'une manière visible pour ses disciples. Ceux-ci ont reçu de
sa part une promesse, qui sera, pour eux un ordre de mission : ils recevront
l'Esprit qui fera d'eux des témoins, et non seulement dans le cadre étroit du
pays d'Israël, mais aussi dans l'univers tout entier. L'espace de leur
prédication ne sera plus limité au seul peuple d'Israël vers lequel ils
tournaient encore leur espérance, l'espace leur est ouvert jusqu'à
l'extrémité de la terre. Parallèlement, le temps qui est le leur, ce n'est
plus le passé, mais l'avenir qui s'ouvre devant eux, par le fait même de la
disparition du Christ. La présence de Jésus au milieu d'eux leur permettait
encore de tourner les yeux vers le passé, vers la restauration royale en
Israël ; sa disparition et son absence définitive leur permettent de se
découvrir comme porteurs d'une nouvelle espérance, qui n'est plus sélective,
mais universelle. Ils auront une tâche à remplir, maintenant que le Christ
leur est absent. Il ne s'agit plus d'une connaissance des desseins secrets du
Dieu-Père, il ne s'agit pas davantage de travailler à la réalisation d'une
restauration royale en Israël, il s'agit pour eux de témoigner des actes du
Père en faveur de ce Jésus qui, à présent, est soustrait à leurs regards,
de témoigner finalement de la réalisation de la promesse du don de l'Esprit de
Dieu à tous les hommes. Le témoignage qui est demandé aux premiers disciples
n'a donc rien à voir avec une connaissance spéculative de Dieu : ils n'ont pas
à connaître Dieu en lui-même mais plutôt à rendre témoignage à cet homme
singulier qu'était Jésus de Nazareth, et qui est le révélateur du Dieu-Père.
C'est ce témoignage de la connaissance d'un homme singulier et unique, en qui
ils ont découvert l'action de Dieu qui est exigé de leur part ; la puissance
de l'Esprit leur permettra de reconnaître en Jésus le Serviteur de Dieu qui a
été glorifié par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Pères,
le Dieu-Père du peuple. L'absence de Jésus et la puissance de l'Esprit vont
permettre aux disciples de prendre la parole, d'exprimer ce qu'ils ont vécu
avec ce Jésus de Nazareth que les juifs ont livré, que les hommes ont
condamné à mort, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts... D'une
certaine manière, le Ressuscité, en disparaissant à la vue de ses disciples,
leur permet de devenir eux-mêmes, dans le témoignage qu'ils rendront de lui :
ce témoignage sera celui de la re-connaissance, celui d'une nouvelle naissance
à l'intérieur d'une communion avec Celui qui est ressuscité ; les disciples
auront alors un avenir marqué par une singularité, celle de la puissance de
l'Esprit qui leur sera donné, au jour de la Pentecôte. Et la tradition la plus
ancienne de l'Eglise découvre, dans cet événement de la Pentecôte, l'acte
fondateur de l'Eglise, précisément dans l'acte de la prise de parole par
Pierre, au nom de tous les disciples, en face des hommes rassemblés à
Jérusalem pour la célébration de la fête juive de Chavouoth.
Arguant de la présence de Jésus parmi eux, les disciples
peuvent l'interroger, afin de savoir si le temps de la restauration d'Israël
est enfin arrivé. Et, à la fin de cette péricope, Jésus est définitivement
absent. Il est enlevé aux regards de ses amis, par une nuée signifiant et
symbolisant la divinité à laquelle il retourne ; de cette façon, Jésus
accède à Dieu d'une manière visible pour ses disciples. Ceux-ci ont reçu de
sa part une promesse, qui sera, pour eux un ordre de mission : ils recevront
l'Esprit qui fera d'eux des témoins, et non seulement dans le cadre étroit du
pays d'Israël, mais aussi dans l'univers tout entier. L'espace de leur
prédication ne sera plus limité au seul peuple d'Israël vers lequel ils
tournaient encore leur espérance, l'espace leur est ouvert jusqu'à
l'extrémité de la terre. Parallèlement, le temps qui est le leur, ce n'est
plus le passé, mais l'avenir qui s'ouvre devant eux, par le fait même de la
disparition du Christ. La présence de Jésus au milieu d'eux leur permettait
encore de tourner les yeux vers le passé, vers la restauration royale en
Israël ; sa disparition et son absence définitive leur permettent de se
découvrir comme porteurs d'une nouvelle espérance, qui n'est plus sélective,
mais universelle. Ils auront une tâche à remplir, maintenant que le Christ
leur est absent. Il ne s'agit plus d'une connaissance des desseins secrets du
Dieu-Père, il ne s'agit pas davantage de travailler à la réalisation d'une
restauration royale en Israël, il s'agit pour eux de témoigner des actes du
Père en faveur de ce Jésus qui, à présent, est soustrait à leurs regards,
de témoigner finalement de la réalisation de la promesse du don de l'Esprit de
Dieu à tous les hommes. Le témoignage qui est demandé aux premiers disciples
n'a donc rien à voir avec une connaissance spéculative de Dieu : ils n'ont pas
à connaître Dieu en lui-même mais plutôt à rendre témoignage à cet homme
singulier qu'était Jésus de Nazareth, et qui est le révélateur du Dieu-Père.
C'est ce témoignage de la connaissance d'un homme singulier et unique, en qui
ils ont découvert l'action de Dieu qui est exigé de leur part ; la puissance
de l'Esprit leur permettra de reconnaître en Jésus le Serviteur de Dieu qui a
été glorifié par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Pères,
le Dieu-Père du peuple. L'absence de Jésus et la puissance de l'Esprit vont
permettre aux disciples de prendre la parole, d'exprimer ce qu'ils ont vécu
avec ce Jésus de Nazareth que les juifs ont livré, que les hommes ont
condamné à mort, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts... D'une
certaine manière, le Ressuscité, en disparaissant à la vue de ses disciples,
leur permet de devenir eux-mêmes, dans le témoignage qu'ils rendront de lui :
ce témoignage sera celui de la re-connaissance, celui d'une nouvelle naissance
à l'intérieur d'une communion avec Celui qui est ressuscité ; les disciples
auront alors un avenir marqué par une singularité, celle de la puissance de
l'Esprit qui leur sera donné, au jour de la Pentecôte. Et la tradition la plus
ancienne de l'Eglise découvre, dans cet événement de la Pentecôte, l'acte
fondateur de l'Eglise, précisément dans l'acte de la prise de parole par
Pierre, au nom de tous les disciples, en face des hommes rassemblés à
Jérusalem pour la célébration de la fête juive de Chavouoth.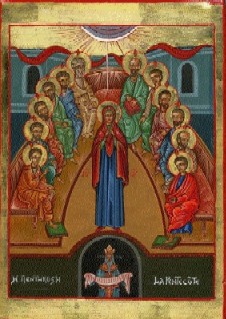 Il y a cinquante jours que les disciples avaient vécu les
événements de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Ils sont réunis
dans une maison, sans doute par crainte des juifs, qui auraient pu les
poursuivre comme ils avaient fait éliminer Jésus de Nazareth, leur maître,
sans doute aussi dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint, objet de la
dernière promesse du Christ, avant sa disparition définitive. Le rédacteur du
livre des Actes des Apôtres qui est le rédacteur de l'évangile selon saint
Luc, situe ce don de l'Esprit au jour de la fête juive de Chavouoth, la fête
qui renouvelait l'alliance passée entre Dieu et son peuple sur le mont Sinaï.
Et l'événement du don de l'Esprit est décrit avec les mêmes images que les
traditions juives reconnaissaient à l'événement du don de la Loi à Moïse :
il s'agit d'un bruit, comme un violent coup de vent, d'une apparition de feu,
comme des langues de feu qui se répandent sur tous les disciples présents,
deux images traditionnelles pour signifier l'action de Dieu, et qui permettent
d'exprimer une réalité essentielle, mais invisible pour les yeux : Tous
furent alors remplis de l'Esprit-Saint (Ac. 2,4).
Il y a cinquante jours que les disciples avaient vécu les
événements de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Ils sont réunis
dans une maison, sans doute par crainte des juifs, qui auraient pu les
poursuivre comme ils avaient fait éliminer Jésus de Nazareth, leur maître,
sans doute aussi dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint, objet de la
dernière promesse du Christ, avant sa disparition définitive. Le rédacteur du
livre des Actes des Apôtres qui est le rédacteur de l'évangile selon saint
Luc, situe ce don de l'Esprit au jour de la fête juive de Chavouoth, la fête
qui renouvelait l'alliance passée entre Dieu et son peuple sur le mont Sinaï.
Et l'événement du don de l'Esprit est décrit avec les mêmes images que les
traditions juives reconnaissaient à l'événement du don de la Loi à Moïse :
il s'agit d'un bruit, comme un violent coup de vent, d'une apparition de feu,
comme des langues de feu qui se répandent sur tous les disciples présents,
deux images traditionnelles pour signifier l'action de Dieu, et qui permettent
d'exprimer une réalité essentielle, mais invisible pour les yeux : Tous
furent alors remplis de l'Esprit-Saint (Ac. 2,4).
 La conclusion légitime que Pierre tire de l'interprétation
de l'événement de Pentecôte, c'est celle-ci : ce que David avait prévu pour
le Christ s'est réalisé pour Jésus, et donc Jésus a été fait Christ et
Seigneur par la puissance de Dieu qui l'a exalté. Tout le kérygme primitif,
toute la profession de foi de l'Eglise de la première génération se trouve
résumé dans la conclusion de ce discours de Pierre : Que toute la maison
d'Israël le sache avec certitude : Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous, vous aviez crucifié (Ac 2 36).
La conclusion légitime que Pierre tire de l'interprétation
de l'événement de Pentecôte, c'est celle-ci : ce que David avait prévu pour
le Christ s'est réalisé pour Jésus, et donc Jésus a été fait Christ et
Seigneur par la puissance de Dieu qui l'a exalté. Tout le kérygme primitif,
toute la profession de foi de l'Eglise de la première génération se trouve
résumé dans la conclusion de ce discours de Pierre : Que toute la maison
d'Israël le sache avec certitude : Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous, vous aviez crucifié (Ac 2 36). Malgré l'usage, il est préférable de parler d'une vocation
de Paul, plutôt que d'une conversion. En effet, Saul de Tarse, juif pieux,
profondément croyant et instruit dans les traditions de ses pères dans la foi,
ne pouvait pas 'se convertir' au sens strict, c'est-à-dire se détourner des
idoles pour se tourner vers le Dieu unique et véritable puisqu'il l'adorait
déjà.
Malgré l'usage, il est préférable de parler d'une vocation
de Paul, plutôt que d'une conversion. En effet, Saul de Tarse, juif pieux,
profondément croyant et instruit dans les traditions de ses pères dans la foi,
ne pouvait pas 'se convertir' au sens strict, c'est-à-dire se détourner des
idoles pour se tourner vers le Dieu unique et véritable puisqu'il l'adorait
déjà.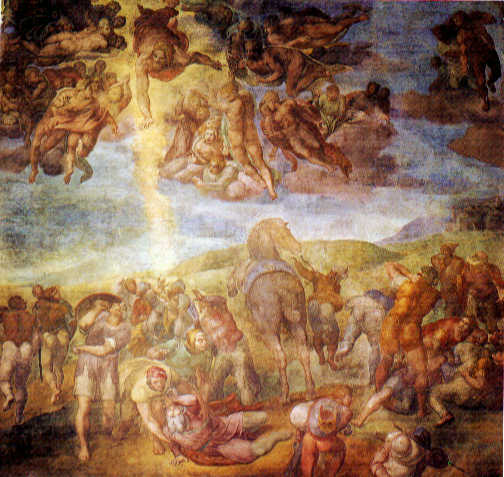

 Quelques jours plus tard, le roi Marcus Julius Agrippa, roi
d'une province du Liban, vient rendre visite à Festus, qui profite de cette
visite pour instruire le rapport qu'il doit envoyer à Rome, au sujet de Paul.
Agrippa, connaissant la Loi juive, pouvait aider le procurateur dans sa tâche
d'élucider les querelles religieuses entre les juifs, querelles relatives à
la religion qui leur est propre et en particulier à un certain Jésus qui est
mort et que Paul prétendait toujours en vie (Ac. 25, 19).
Quelques jours plus tard, le roi Marcus Julius Agrippa, roi
d'une province du Liban, vient rendre visite à Festus, qui profite de cette
visite pour instruire le rapport qu'il doit envoyer à Rome, au sujet de Paul.
Agrippa, connaissant la Loi juive, pouvait aider le procurateur dans sa tâche
d'élucider les querelles religieuses entre les juifs, querelles relatives à
la religion qui leur est propre et en particulier à un certain Jésus qui est
mort et que Paul prétendait toujours en vie (Ac. 25, 19).