Les origines de la Réforme protestante
La fin du quatorzième siècle vit une nouvelle apparition de
l'hérésie en Europe, d'abord en Angleterre, puis en Bohème deux pays qui
n'avaient pas pris une grande part aux hérésies des siècles précédents.
 Comme les Vaudois, Jean Wycliff, un maître d'Oxford,
s'efforçait de retrouver un christianisme primitif. Il entreprit une critique
radicale de l'Eglise ; constatant que celle-ci est corrompue par le péché, il
affirme que la véritable Eglise est invisible et constituée uniquement par
ceux qui sont prédestinés au salut. Pour appartenir à cette Eglise, il
suffisait d'en revenir à l'Écriture Sainte proprement dite, à laquelle il ne
fallait rien ajouter ; le clergé et les sacrements de l'Eglise deviennent
inutiles. Il publia également des traités où il mettait directement en cause
la doctrine traditionnelle sur l'eucharistie, niant la transsubstantiation. Cela
lui valut la condamnation de sa doctrine, en 1382 par un concile réuni à
Londres ; il dut se retirer d'Oxford et il mourut en 1384, après avoir mené de
violentes campagnes littéraires contre le clergé, la papauté et tous les
ordres religieux, et tout en prônant un retour à la vie évangélique selon un
christianisme inspiré de Écriture seule.
Comme les Vaudois, Jean Wycliff, un maître d'Oxford,
s'efforçait de retrouver un christianisme primitif. Il entreprit une critique
radicale de l'Eglise ; constatant que celle-ci est corrompue par le péché, il
affirme que la véritable Eglise est invisible et constituée uniquement par
ceux qui sont prédestinés au salut. Pour appartenir à cette Eglise, il
suffisait d'en revenir à l'Écriture Sainte proprement dite, à laquelle il ne
fallait rien ajouter ; le clergé et les sacrements de l'Eglise deviennent
inutiles. Il publia également des traités où il mettait directement en cause
la doctrine traditionnelle sur l'eucharistie, niant la transsubstantiation. Cela
lui valut la condamnation de sa doctrine, en 1382 par un concile réuni à
Londres ; il dut se retirer d'Oxford et il mourut en 1384, après avoir mené de
violentes campagnes littéraires contre le clergé, la papauté et tous les
ordres religieux, et tout en prônant un retour à la vie évangélique selon un
christianisme inspiré de Écriture seule.
Comme Wycliff, Jean Huss est un universitaire de Prague, qui
commença une carrière de prédicateur, en découvrant dans Écriture seule la
base de la foi ; il considérait Wycliff comme une autorité qui garantissait sa
propre recherche. En 1403, l'université de Prague condamnait les théories de
Wycliff, suivie en cela par le pape Grégoire XII, dont le pontificat était
reconnu par la Bohème et par Jean Huss. Condamné par l'archevêque de Prague
qui l'excommunia, il ne cessait d'être soutenu par le roi et par le peuple.
L'empereur Sigismond proposa à Jean Huss de soutenir sa cause au concile de
Constance, Jean XXIII ayant accepté de lever l'excommunication. Devant les
pères conciliaires, il affirma de nouveau qu'il n'acceptait pas toute la
doctrine de Wycliff, et qu'il refusait, entre autres, ses théories sur
l'eucharistie. Mais les pères conciliaires ne voulurent pas se lancer dans des
débats théologiques ; la doctrine de Jean Huss sur le sacerdoce et sur l'Eglise
suffisait à le faire condamner. Refusant de se rétracter, quant à sa théorie
selon laquelle Écriture avait force de loi pour juger toute doctrine
chrétienne, Huss fut condamné par le concile qui le livra à l'empereur, qui
le trahit et qui le livra au bûcher en 1415.
La crise des consciences
Les différents mouvements de réforme au sein de l'Eglise
catholique n'ont sans doute pas, comme on l'a trop souvent pensé, des causes
socio-économiques, mais bien des causes religieuses ; alors que l'Occident va
sortir du Moyen-Age, l'homme ne cesse d'être hanté et même tourmenté par la
question du salut. C'est parce que les hommes avaient une réelle avidité de
Dieu, et non pas en raison des abus du clergé, qu'ils ont pu prêter une
oreille attentive à tous ceux qui voulaient réformer l'Eglise. Le malaise a
trouvé sa source dans la naissance de la doctrine conciliariste, au moment du
schisme en Occident ; le concile, à condition qu'il soit oecuménique, est
supérieur au pape, dans le sens spirituel comme dans le sens temporel ; mais,
pour diriger ce concile, il n'y a pas une seule autorité, mais le rassemblement
des autorités épiscopales. Déjà, le désir se faisait sentir chez les
responsables hiérarchiques d'une sorte de retour aux premières communautés,
à une époque où la centralisation romaine n'existait pas.
 Ce malaise a pénétré dans le peuple chrétien et s'est
traduit par les déviations de Wycliff et de Jean Huss, qui réclamaient le
retour à la seule foi (sola fides) et à la seule Écriture sainte (sola
Scriptura) Le clergé lui aussi vivait une époque de crise ; certains prêtres
avaient suivi une formation universitaire et comprenaient que l'enseignement
traditionnel de l'Eglise était dépassé, qu'il ne s'adaptait plus aux
circonstances présentes ; ils considéraient la révélation chrétienne comme
un donné qui s'imposait à l'intelligence humaine et que la philosophie devait
tenter d'interpréter, sinon de rationaliser. L'ensemble de la chrétienté
occidentale inaugurait une époque nouvelle ; elle entrait dans une époque
moderne, abandonnant les rêves des générations précédentes. L'idéal des
croisades s'est estompé devant la recherche du profit et des échanges
commerciaux avec les pays d'Orient. L'idéal d'une chrétienté unique et
puissante s'estompe également devant la naissance des nationalités qui font
naître plusieurs langues vernaculaires qui amoindrissent la portée
internationale de la langue officielle de l'Eglise.
Ce malaise a pénétré dans le peuple chrétien et s'est
traduit par les déviations de Wycliff et de Jean Huss, qui réclamaient le
retour à la seule foi (sola fides) et à la seule Écriture sainte (sola
Scriptura) Le clergé lui aussi vivait une époque de crise ; certains prêtres
avaient suivi une formation universitaire et comprenaient que l'enseignement
traditionnel de l'Eglise était dépassé, qu'il ne s'adaptait plus aux
circonstances présentes ; ils considéraient la révélation chrétienne comme
un donné qui s'imposait à l'intelligence humaine et que la philosophie devait
tenter d'interpréter, sinon de rationaliser. L'ensemble de la chrétienté
occidentale inaugurait une époque nouvelle ; elle entrait dans une époque
moderne, abandonnant les rêves des générations précédentes. L'idéal des
croisades s'est estompé devant la recherche du profit et des échanges
commerciaux avec les pays d'Orient. L'idéal d'une chrétienté unique et
puissante s'estompe également devant la naissance des nationalités qui font
naître plusieurs langues vernaculaires qui amoindrissent la portée
internationale de la langue officielle de l'Eglise.
La culture religieuse fait place à une culture plus laïque,
avec la naissance et le développement de l'imprimerie par Gutenberg, en 1456.
Et ce mouvement de laïcisation du christianisme s'amplifie du fait des papes
qui, de 1450 à 1517 environ, sont moralement critiquables ; ils voulaient
refaire de l'Italie un état temporel, sans trop s'occuper des réalités
spirituelles, et pour ce faire, ils recherchaient des alliances avec les
puissances de l'époque ; le pouvoir spirituel était à la dérive, et les
Églises locales devenaient mécontentes de la fiscalité toujours croissante du
Saint-Siège. Pourtant, la vie religieuse restait active ; la direction
spirituelle du clergé n'était pas contestée, malgré les abus de la papauté.
La piété personnelle se développait en parallèles à la piété imposée par
l'autorité pontificale ; et la piété populaire s'abandonnait facilement à la
mystique, c'est-à-dire à l'état de l'âme qui abandonne ses potentialités
rationnelles pour se mettre en contact avec une connaissance spirituelle qui
s'impose à elle sans recourir à des interprétations intellectuelles. La
spiritualité devenait de plus en plu subjective, chacun voulant gagner le ciel
et son salut, par tous les moyens possibles ; multiplication des autels dans les
églises, acquisition d'un maximum d'indulgences, recherche de saints
protecteurs contre tous les maux et toutes les maladies, multiplication des
pèlerinages.
La contestation qui sera adressée à l'Eglise catholique
sera enracinée dans la recherche d'une foi pure de toute compromission
politique ; Martin Luther sera le catalyseur de tous ceux qui estiment que l'Eglise
oublie de plus en plus le spirituel pour ne plus s'intéresser qu'au temporel.
La querelle des indulgences ne sera jamais que le prétexte qui mettra le feu
aux poudres. Toute l'ambition de Luther sera de réformer l'ensemble de l'Eglise,
en lui rappelant les principes évangéliques.
La Réforme, oeuvre personnelle de Luther
 Originellement, la Réforme reposait sur des causes
religieuses, théologiques, mais l'implication politique de la décision de ceux
qui accordaient du crédit à Luther, en particulier les princes allemands, ne
pouvait qu'amener une politisation effective de cette démarche religieuse dans
son essence. Dans l'esprit de Luther, la réforme ne pouvait pas être une
déchirure au sein de l'Eglise d'Occident, il pensait pouvoir réformer l'Eglise
de l'intérieur, sans schisme, en lui rappelant que ce qui la fonde, c'était
Écriture Sainte dans laquelle s'exprime la parole même de Dieu. Il voulait
ainsi rappeler que le véritable trésor de l'Eglise était dans l'évangile
beaucoup plus que dans la discipline interne d'une chrétienté, armée d'un
dispositif philosophique, hérité plus ou moins d'Aristote. C'est sans doute
dans son opposition aux écoles théologiques beaucoup plus que dans sa lutte
contre de sombres machinations financières que la résistance de Luther fut le
plus r"sentie par l'Eglise catholique de Rome. La protestation luthérienne
se situait au plan théologique, mais l'armature doctrinale de Rome ne
permettait pas d'introduire une discontinuité dans l'enseignement traditionnel
de l'Eglise. Et le moine Luther apparaissait alors comme un danger pour le
statut de la papauté.
Originellement, la Réforme reposait sur des causes
religieuses, théologiques, mais l'implication politique de la décision de ceux
qui accordaient du crédit à Luther, en particulier les princes allemands, ne
pouvait qu'amener une politisation effective de cette démarche religieuse dans
son essence. Dans l'esprit de Luther, la réforme ne pouvait pas être une
déchirure au sein de l'Eglise d'Occident, il pensait pouvoir réformer l'Eglise
de l'intérieur, sans schisme, en lui rappelant que ce qui la fonde, c'était
Écriture Sainte dans laquelle s'exprime la parole même de Dieu. Il voulait
ainsi rappeler que le véritable trésor de l'Eglise était dans l'évangile
beaucoup plus que dans la discipline interne d'une chrétienté, armée d'un
dispositif philosophique, hérité plus ou moins d'Aristote. C'est sans doute
dans son opposition aux écoles théologiques beaucoup plus que dans sa lutte
contre de sombres machinations financières que la résistance de Luther fut le
plus r"sentie par l'Eglise catholique de Rome. La protestation luthérienne
se situait au plan théologique, mais l'armature doctrinale de Rome ne
permettait pas d'introduire une discontinuité dans l'enseignement traditionnel
de l'Eglise. Et le moine Luther apparaissait alors comme un danger pour le
statut de la papauté.
En 1505, le pape Jules II avait décidé de faire construire
une nouvelle basilique de Saint-Pierre à Rome. Selon la coutume des siècles
précédents, il entreprit de distribuer des indulgences plénières à ceux
qui, s'étant confessé et ayant reçu la communion, ajoutaient une offrande en
argent pour permettre la réalisation de ce grand projet. Cette campagne des
indulgences ne se répandit en Allemagne du Nord qu'en 1517. La première
manifestation de Luther sur la scène publique a lieu la veille de la Toussaint
de cette même année ; alors, en Saxe, on se préparait à la fête de la
Toussaint, en se confessant, et en vénérant quelques dix-sept mille reliques,
rapportant plus de cent vingt mille années d'indulgences, pouvant transférer
rapidement les âmes des défunts du purgatoire au paradis. Depuis un an déjà,
Luther prêchait contre les indulgences et cherchait à connaître
l'enseignement traditionnel de l'Eglise sur ce sujet. Il avait écrit au prince
et à l'archevêque de Mayence ses réflexions sur cette vente des Indulgences.
Devant la grande préparation de la Toussaint 1517, il rédige une série de
propositions : quatre-vingt quinze thèses qui auraient été affichées, si on
en croit la tradition, aux portes de l'Eglise du château de Wittenberg.
 Ces thèses sur la vertu des indulgences étaient écrites en
latin, ce qui montre que Luther ne voulait pas répandre d'idées subversives
dans la mentalité populaire et qu'il souhaitait simplement soulever un débat
idéologique parmi les docteurs de Eglise catholique. Ces quatre-vingt quinze
propositions n'apportaient aucun enseignement nouveau, elles rappelaient
simplement l'enseignement de l'Eglise depuis les premiers siècles : comment
pourrait-on acheter, à prix d'argent, une grâce de salut que Dieu accorde
librement par la mort du Christ sur la croix ? Mais, le pape, pas plus que ses
collaborateurs, ne se souciait d'un débat idéologique, d'une discussion
théologique, trop occupé qu'il était du gouvernement intérieur de l'Eglise
et des pays qui se trouvaient sous sa coupe. Sommé de rendre compte
publiquement de ses thèses à Rome, alors que le pape avait sans doute été
mal informé, Luther refusa de se rétracter, tant qu'il ne serait pas
convaincu, par ses opposants, au moyen des seules preuves tirées de Écriture,
de l'authenticité de leurs affirmations concernant les indulgences. Comme
Eglise de Rome n'était pas disposée à reconnaître qu'elle pouvait s'être
trompée, en menant son existence sans référence constante à l'Évangile, une
bulle d'excommunication contre Luther "Decet Romanum pontificem" fut
signée par le pape en 1521. Par ailleurs, Luther, excédé, avait fini par
douter de l'infaillibilité des conciles universels eux-mêmes ; il s'attaquait
au magistère doctrinal de Eglise, en affirmant que l'on ne pouvait garder comme
vérité absolue que ce qui pouvait être tiré de Écriture seule.
Ces thèses sur la vertu des indulgences étaient écrites en
latin, ce qui montre que Luther ne voulait pas répandre d'idées subversives
dans la mentalité populaire et qu'il souhaitait simplement soulever un débat
idéologique parmi les docteurs de Eglise catholique. Ces quatre-vingt quinze
propositions n'apportaient aucun enseignement nouveau, elles rappelaient
simplement l'enseignement de l'Eglise depuis les premiers siècles : comment
pourrait-on acheter, à prix d'argent, une grâce de salut que Dieu accorde
librement par la mort du Christ sur la croix ? Mais, le pape, pas plus que ses
collaborateurs, ne se souciait d'un débat idéologique, d'une discussion
théologique, trop occupé qu'il était du gouvernement intérieur de l'Eglise
et des pays qui se trouvaient sous sa coupe. Sommé de rendre compte
publiquement de ses thèses à Rome, alors que le pape avait sans doute été
mal informé, Luther refusa de se rétracter, tant qu'il ne serait pas
convaincu, par ses opposants, au moyen des seules preuves tirées de Écriture,
de l'authenticité de leurs affirmations concernant les indulgences. Comme
Eglise de Rome n'était pas disposée à reconnaître qu'elle pouvait s'être
trompée, en menant son existence sans référence constante à l'Évangile, une
bulle d'excommunication contre Luther "Decet Romanum pontificem" fut
signée par le pape en 1521. Par ailleurs, Luther, excédé, avait fini par
douter de l'infaillibilité des conciles universels eux-mêmes ; il s'attaquait
au magistère doctrinal de Eglise, en affirmant que l'on ne pouvait garder comme
vérité absolue que ce qui pouvait être tiré de Écriture seule. 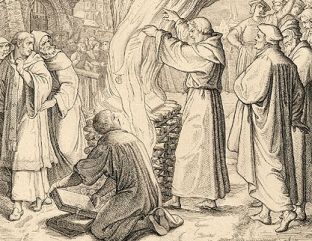
L'histoire ultérieure devait entraîner un durcissement des
deux partis en présence, chacun restant strictement sur ses positions. Mais la
lutte sortit très rapidement du domaine purement ecclésiastique pour devenir
un élément de lutte nationaliste allemande contre l'empereur. Et cela, Luther
le sentit très bien, en laissant de côté les spéculations théologiques pour
placer au premier plan les problèmes de politique ecclésiastique et en
exploitant au maximum le mécontentement général contre l'administration de
Rome ; le pape devient alors l'ennemi personnel de Luther et la figure de
l'ennemi de la nation allemande, d'autant plus que le pape intriguait pour
trouver un successeur à Maximilien, successeur qui puisse défendre les
Intérêts de la papauté... Dès Noël 1521, il abandonna l'habit
ecclésiastique pour célébrer le repas eucharistique et pour assurer la
prédication. Le lendemain, alors qu'il avait été relevé de ses voeux
monastiques quelques mois auparavant, il se maria. Il avait depuis longtemps
réclamé l'obligation du mariage pour les prêtres et sa permission pour les
religieux. Mais là n'était sans doute pas le problème ecclésiastique majeur.
II se trouva, en effet, que les laïcs prirent leur part au mouvement suscité
par Luther ; tout le monde pouvait rapidement devenir prédicateur, quel que
soit son statut social, quel que soit son niveau d'études religieuses. On
renonça bientôt aux études théologiques.
Désormais, le mouvement déclenché par Luther échappait à
la personne du réformateur pour accomplir son destin propre. La référence à
Écriture, comme seule norme, pouvait permettre toutes les interprétations.
Aussi le mouvement luthérien ne pouvait-il pas garder longtemps l'inspiration
de son fondateur. Déjà au temps de Luther, et en Allemagne, se manifestaient
d'autres tendances, qui prenaient appui sur les thèses de Wittenberg, mais en
les exploitant d'une manière ou d'une autre. En Suisse, d'autre part, un
nouveau chef de la révolte contre Rome se manifestait : Zwingli, qui faisait de
la Réforme une affaire humaniste et politique.
 En 1535, Jean Calvin quittait la France pour la Suisse, à la
suite de l'affaire des Placards, affiches qui critiquaient la messe de Eglise
catholique. La Suisse avait accueilli favorablement les idées de la Réforme. A
Genève, il commence à organiser l'Eglise évangélique, ce que les bourgeois
de la ville eux-mêmes souhaitaient.
En 1535, Jean Calvin quittait la France pour la Suisse, à la
suite de l'affaire des Placards, affiches qui critiquaient la messe de Eglise
catholique. La Suisse avait accueilli favorablement les idées de la Réforme. A
Genève, il commence à organiser l'Eglise évangélique, ce que les bourgeois
de la ville eux-mêmes souhaitaient.
Les Genevois s'organisèrent en une communauté qui n'est pas
sans rappeler la communauté des premiers chrétiens ; Calvin donna une
constitution à l'Eglise de cette ville. Si la Réforme, sous la conduite de
Luther puis de Zwingli, s'était distinguée dans l'ensemble de l'Eglise
d'Occident par sa recherche théologique, elle devient, avec Calvin, une
démarche pratique. Pour lui, la spéculation intellectuelle compte moins qu'une
existence menée à la lumière de Évangile Calvin est, avant tout, un homme
d'action, un réalisateur ; sa formation de juriste l'aidera à établir une
sorte de société théocratique. Eglise qu'il fonde ainsi est une Eglise de
saints, le rassemblement des élus, et non pas seulement une Eglise de la foi
où le croyant cherche à obtenir le salut personnel par sa confiance en Dieu.
Une nation allait aussi adopter les principes de la Réforme,
même si elle ne se place pas immédiatement dans l'idéologie des grands
réformateurs. La dénomination d'Eglise anglicane ne date pas de la Réforme.
Avant 1521, elle marquait simplement l'unique Eglise d'Angleterre en communion
avec le siège de Rome. Seulement quarante ans plus tard, cette même
dénomination va désigner une Eglise à part, détachée de Rome, établie par
un acte du Parlement, soumise au roi d'Angleterre. Par ses origines, comme par
ses développements ultérieurs, l'Eglise anglicane ne peut que difficilement
être située dans le courant théologique de la Réforme, et, d'une certaine
manière, l'anglicanisme peut paraître comme l'Eglise séparée de Rome, mais
qui reste la plus proche du siège apostolique de Pierre. C'est que la
séparation de 1534 se situe davantage sur le plan de la juridiction de la
papauté que sur celui de la théologie chrétienne. Sur le continent, les
réformateurs furent des hommes de doctrine, des théologiens avant d'être des
hommes d'action ; en Angleterre, il n'y eut rien de comparable, puisque les
meneurs sont d'habiles politiques, qui s'affranchissent de la tutelle de Rome,
bien avant de se constituer une référence dans des écrits.
La résistance catholique : le concile de Trente
La Réforme constituait une provocation sérieuse dans la vie
de l'Eglise catholique ; une réponse à cette scission devenait nécessaire ;
elle se fit attendre, car les responsables ecclésiastiques n'ont certainement
pas mesuré, sur le coup, la gravité de la situation dans laquelle la
chrétienté risquait de s'enliser. Dans les siècles précédents, il y avait
déjà eu des tentatives de réformes, notamment par l'appel à la pauvreté et
à la vie monastique, mais à mesure que le luthéranisme étendait son rayon
d'action, les petites réformes entreprises dans l'Eglise se révélaient
insuffisantes. Seul, un nouveau concile oecuménique semblait être susceptible
d'apporter une solution satisfaisante à ce problème qui intéressait
l'ensemble de la chrétienté. Les chrétiens ressentaient l'urgence d'un tel
rassemblement des évêques, non seulement pour examiner la question
luthérienne, mais surtout pour apporter des réformes décisives dans la vie de
l'Eglise. Pourtant, la papauté hésita longuement avant de convoquer cette
assemblée conciliaire d'une part, parce que la convocation des conciles
n'était pas un privilège pontifical mais un droit de l'autorité séculière,
et d'autre part, parce que la papauté se souvenait des thèses conciliaristes
des conciles de Bâle et de Constance qui avaient sérieusement entaché le
crédit de la papauté au profit du gouvernement de Eglise par les conciles
généraux. Et les princes allemands auraient été trop heureux de réunir un
concile pour échapper à la lourdeur de la fiscalité romaine qui s'abattait
sur leurs provinces ; la convocation d'un concile aurait pu immédiatement
bouleverser l'équilibre instauré par les papes depuis le grand schisme
d'Occident. Pourtant, Paul III se décide, en mai 1542, à convoquer une
assemblée oecuménique à Trente.
Ouvert en 1545, le concile allait se prolonger jusqu'en
1563, mais avec de nombreuses interruptions et même une longue coupure entre
1552 et 1562 ; une ambiguïté planait dès l'ouverture ; Rome attendait du
concile des définitions dogmatiques, alors que l'empereur, Charles Quint,
espérait une réforme à l'intérieur de Eglise, réforme capable de rallier
les protestants et de rétablir ainsi l'unité de l'Eglise chrétienne. Malgré
les longs travaux du concile de Trente, la restauration de l'unité chrétienne
ne se fit pas ; au contraire, la division fut même mise en évidence par des
définitions dogmatiques que les protestants ne pouvaient accepter ; le concile
affirme qu'il existait deux sources à la vérité chrétienne, Écriture
sainte, mais aussi les traditions de Eglise, comme les écrits patristiques ou
le magistère pontifical et conciliaire... Les pères conciliaires de Trente
définirent aussi la sacramentalité chrétienne, en insistant particulièrement
sur la doctrine catholique de l'eucharistie, en réaction aux propositions de
Luther.
Ce concile de Trente peut se concevoir comme la réponse
toute négative du catholicisme à l'oeuvre de la Réforme protestante ; il est
même parfois présenté comme le concile de la 'Contre-Réforme' catholique, en
raison de la présentation très juridique et disciplinaire des décisions qui
furent les siennes ; d'une certaine manière, ce concile a enfermé l'Eglise
catholique dans un bastion solide qui se protégeait fortement de tout
rapprochement avec ce qui n'était pas la pure vérité catholique. Mais ce
même concile de Trente peut aussi se concevoir sous un jour nettement positif,
puisqu'il a poursuivi l'oeuvre de réforme entreprise auparavant dans l'Eglise
catholique, donnant à celle-ci une structure canonique dont elle ne jouissait
pas avant le concile ; la hiérarchie catholique se dégageait aussi de
l'autorité civile. La ville de Rome elle-même se transforma, cessant d'être
un lieu de licence des moeurs pour s'attacher à une spiritualité plus
authentiquement chrétienne ; les papes travaillèrent alors à favoriser la
dévotion du peuple chrétien envers le siège apostolique de Rome, le
Saint-Siège. De Rome, le mouvement de réforme catholique s'étendit par
étapes à tous les diocèses de la catholicité.
La mise en application des décisions conciliaires revint à
Pie V (1566-1572), dont un ambassadeur vénitien disait qu'il avait transformé
Rome en un véritable cloître, car ce pape voulait maintenir la foi dans toute
sa pureté. Pour unifier l'Eglise catholique, il entreprit la réforme de sa
liturgie, en l'unifiant. En 1566, il fit publier un Catéchisme romain qui
devait servir de base à la formation de tous les chrétiens par le clergé
paroissial ; en 1568, il publia le Bréviaire romain, accordant une grande place
aux textes de Écriture ; en 1570, il fit paraître le Missel romain. Cette
oeuvre d'unification liturgique fut poursuivie sous les pontificats suivants.
Grégoire XIII (1572-1585) acheva la révision du code de droit canon entreprise
par son prédécesseur ; mais ce pape a vu son nom immortalisé par la réforme
qu'il entreprit de mener à bien, celle du calendrier ; le 24 février 1582, il
décida que pour remédier aux erreurs du calendrier julien, le lendemain du 4
octobre 1582 serait le 15 octobre. Les états catholiques admirent
immédiatement cette réforme ; les états protestants et orthodoxes
conservèrent leur ancien calendrier de peur de voir le pape prendre encore de
l'autorité sur eux...
A la fin du seizième siècle, la chrétienté universelle se
trouve ainsi divisée en trois grandes zones d'influence. L'Orient demeure
fidèle à l'orthodoxie de Constantinople ; l'Occident chrétien se sépare
entre les fidèles qui reconnaissent l'autorité du pape et qui se regroupent
ainsi dans le catholicisme romain et les fidèles qui refusent de reconnaître
l'autorité du pape dans la vie de leurs Églises locales et qui se regroupent
alors dans des communautés séparées, qui seront plus simplement rassemblées
sous le nom de 'protestantisme', nom générique donné indistinctement aux
Églises chrétiennes issues de la Réforme.
 Comme les Vaudois, Jean Wycliff, un maître d'Oxford,
s'efforçait de retrouver un christianisme primitif. Il entreprit une critique
radicale de l'Eglise ; constatant que celle-ci est corrompue par le péché, il
affirme que la véritable Eglise est invisible et constituée uniquement par
ceux qui sont prédestinés au salut. Pour appartenir à cette Eglise, il
suffisait d'en revenir à l'Écriture Sainte proprement dite, à laquelle il ne
fallait rien ajouter ; le clergé et les sacrements de l'Eglise deviennent
inutiles. Il publia également des traités où il mettait directement en cause
la doctrine traditionnelle sur l'eucharistie, niant la transsubstantiation. Cela
lui valut la condamnation de sa doctrine, en 1382 par un concile réuni à
Londres ; il dut se retirer d'Oxford et il mourut en 1384, après avoir mené de
violentes campagnes littéraires contre le clergé, la papauté et tous les
ordres religieux, et tout en prônant un retour à la vie évangélique selon un
christianisme inspiré de Écriture seule.
Comme les Vaudois, Jean Wycliff, un maître d'Oxford,
s'efforçait de retrouver un christianisme primitif. Il entreprit une critique
radicale de l'Eglise ; constatant que celle-ci est corrompue par le péché, il
affirme que la véritable Eglise est invisible et constituée uniquement par
ceux qui sont prédestinés au salut. Pour appartenir à cette Eglise, il
suffisait d'en revenir à l'Écriture Sainte proprement dite, à laquelle il ne
fallait rien ajouter ; le clergé et les sacrements de l'Eglise deviennent
inutiles. Il publia également des traités où il mettait directement en cause
la doctrine traditionnelle sur l'eucharistie, niant la transsubstantiation. Cela
lui valut la condamnation de sa doctrine, en 1382 par un concile réuni à
Londres ; il dut se retirer d'Oxford et il mourut en 1384, après avoir mené de
violentes campagnes littéraires contre le clergé, la papauté et tous les
ordres religieux, et tout en prônant un retour à la vie évangélique selon un
christianisme inspiré de Écriture seule. Ce malaise a pénétré dans le peuple chrétien et s'est
traduit par les déviations de Wycliff et de Jean Huss, qui réclamaient le
retour à la seule foi (sola fides) et à la seule Écriture sainte (sola
Scriptura) Le clergé lui aussi vivait une époque de crise ; certains prêtres
avaient suivi une formation universitaire et comprenaient que l'enseignement
traditionnel de l'Eglise était dépassé, qu'il ne s'adaptait plus aux
circonstances présentes ; ils considéraient la révélation chrétienne comme
un donné qui s'imposait à l'intelligence humaine et que la philosophie devait
tenter d'interpréter, sinon de rationaliser. L'ensemble de la chrétienté
occidentale inaugurait une époque nouvelle ; elle entrait dans une époque
moderne, abandonnant les rêves des générations précédentes. L'idéal des
croisades s'est estompé devant la recherche du profit et des échanges
commerciaux avec les pays d'Orient. L'idéal d'une chrétienté unique et
puissante s'estompe également devant la naissance des nationalités qui font
naître plusieurs langues vernaculaires qui amoindrissent la portée
internationale de la langue officielle de l'Eglise.
Ce malaise a pénétré dans le peuple chrétien et s'est
traduit par les déviations de Wycliff et de Jean Huss, qui réclamaient le
retour à la seule foi (sola fides) et à la seule Écriture sainte (sola
Scriptura) Le clergé lui aussi vivait une époque de crise ; certains prêtres
avaient suivi une formation universitaire et comprenaient que l'enseignement
traditionnel de l'Eglise était dépassé, qu'il ne s'adaptait plus aux
circonstances présentes ; ils considéraient la révélation chrétienne comme
un donné qui s'imposait à l'intelligence humaine et que la philosophie devait
tenter d'interpréter, sinon de rationaliser. L'ensemble de la chrétienté
occidentale inaugurait une époque nouvelle ; elle entrait dans une époque
moderne, abandonnant les rêves des générations précédentes. L'idéal des
croisades s'est estompé devant la recherche du profit et des échanges
commerciaux avec les pays d'Orient. L'idéal d'une chrétienté unique et
puissante s'estompe également devant la naissance des nationalités qui font
naître plusieurs langues vernaculaires qui amoindrissent la portée
internationale de la langue officielle de l'Eglise.  Originellement, la Réforme reposait sur des causes
religieuses, théologiques, mais l'implication politique de la décision de ceux
qui accordaient du crédit à Luther, en particulier les princes allemands, ne
pouvait qu'amener une politisation effective de cette démarche religieuse dans
son essence. Dans l'esprit de Luther, la réforme ne pouvait pas être une
déchirure au sein de l'Eglise d'Occident, il pensait pouvoir réformer l'Eglise
de l'intérieur, sans schisme, en lui rappelant que ce qui la fonde, c'était
Écriture Sainte dans laquelle s'exprime la parole même de Dieu. Il voulait
ainsi rappeler que le véritable trésor de l'Eglise était dans l'évangile
beaucoup plus que dans la discipline interne d'une chrétienté, armée d'un
dispositif philosophique, hérité plus ou moins d'Aristote. C'est sans doute
dans son opposition aux écoles théologiques beaucoup plus que dans sa lutte
contre de sombres machinations financières que la résistance de Luther fut le
plus r"sentie par l'Eglise catholique de Rome. La protestation luthérienne
se situait au plan théologique, mais l'armature doctrinale de Rome ne
permettait pas d'introduire une discontinuité dans l'enseignement traditionnel
de l'Eglise. Et le moine Luther apparaissait alors comme un danger pour le
statut de la papauté.
Originellement, la Réforme reposait sur des causes
religieuses, théologiques, mais l'implication politique de la décision de ceux
qui accordaient du crédit à Luther, en particulier les princes allemands, ne
pouvait qu'amener une politisation effective de cette démarche religieuse dans
son essence. Dans l'esprit de Luther, la réforme ne pouvait pas être une
déchirure au sein de l'Eglise d'Occident, il pensait pouvoir réformer l'Eglise
de l'intérieur, sans schisme, en lui rappelant que ce qui la fonde, c'était
Écriture Sainte dans laquelle s'exprime la parole même de Dieu. Il voulait
ainsi rappeler que le véritable trésor de l'Eglise était dans l'évangile
beaucoup plus que dans la discipline interne d'une chrétienté, armée d'un
dispositif philosophique, hérité plus ou moins d'Aristote. C'est sans doute
dans son opposition aux écoles théologiques beaucoup plus que dans sa lutte
contre de sombres machinations financières que la résistance de Luther fut le
plus r"sentie par l'Eglise catholique de Rome. La protestation luthérienne
se situait au plan théologique, mais l'armature doctrinale de Rome ne
permettait pas d'introduire une discontinuité dans l'enseignement traditionnel
de l'Eglise. Et le moine Luther apparaissait alors comme un danger pour le
statut de la papauté. Ces thèses sur la vertu des indulgences étaient écrites en
latin, ce qui montre que Luther ne voulait pas répandre d'idées subversives
dans la mentalité populaire et qu'il souhaitait simplement soulever un débat
idéologique parmi les docteurs de Eglise catholique. Ces quatre-vingt quinze
propositions n'apportaient aucun enseignement nouveau, elles rappelaient
simplement l'enseignement de l'Eglise depuis les premiers siècles : comment
pourrait-on acheter, à prix d'argent, une grâce de salut que Dieu accorde
librement par la mort du Christ sur la croix ? Mais, le pape, pas plus que ses
collaborateurs, ne se souciait d'un débat idéologique, d'une discussion
théologique, trop occupé qu'il était du gouvernement intérieur de l'Eglise
et des pays qui se trouvaient sous sa coupe. Sommé de rendre compte
publiquement de ses thèses à Rome, alors que le pape avait sans doute été
mal informé, Luther refusa de se rétracter, tant qu'il ne serait pas
convaincu, par ses opposants, au moyen des seules preuves tirées de Écriture,
de l'authenticité de leurs affirmations concernant les indulgences. Comme
Eglise de Rome n'était pas disposée à reconnaître qu'elle pouvait s'être
trompée, en menant son existence sans référence constante à l'Évangile, une
bulle d'excommunication contre Luther "Decet Romanum pontificem" fut
signée par le pape en 1521. Par ailleurs, Luther, excédé, avait fini par
douter de l'infaillibilité des conciles universels eux-mêmes ; il s'attaquait
au magistère doctrinal de Eglise, en affirmant que l'on ne pouvait garder comme
vérité absolue que ce qui pouvait être tiré de Écriture seule.
Ces thèses sur la vertu des indulgences étaient écrites en
latin, ce qui montre que Luther ne voulait pas répandre d'idées subversives
dans la mentalité populaire et qu'il souhaitait simplement soulever un débat
idéologique parmi les docteurs de Eglise catholique. Ces quatre-vingt quinze
propositions n'apportaient aucun enseignement nouveau, elles rappelaient
simplement l'enseignement de l'Eglise depuis les premiers siècles : comment
pourrait-on acheter, à prix d'argent, une grâce de salut que Dieu accorde
librement par la mort du Christ sur la croix ? Mais, le pape, pas plus que ses
collaborateurs, ne se souciait d'un débat idéologique, d'une discussion
théologique, trop occupé qu'il était du gouvernement intérieur de l'Eglise
et des pays qui se trouvaient sous sa coupe. Sommé de rendre compte
publiquement de ses thèses à Rome, alors que le pape avait sans doute été
mal informé, Luther refusa de se rétracter, tant qu'il ne serait pas
convaincu, par ses opposants, au moyen des seules preuves tirées de Écriture,
de l'authenticité de leurs affirmations concernant les indulgences. Comme
Eglise de Rome n'était pas disposée à reconnaître qu'elle pouvait s'être
trompée, en menant son existence sans référence constante à l'Évangile, une
bulle d'excommunication contre Luther "Decet Romanum pontificem" fut
signée par le pape en 1521. Par ailleurs, Luther, excédé, avait fini par
douter de l'infaillibilité des conciles universels eux-mêmes ; il s'attaquait
au magistère doctrinal de Eglise, en affirmant que l'on ne pouvait garder comme
vérité absolue que ce qui pouvait être tiré de Écriture seule. 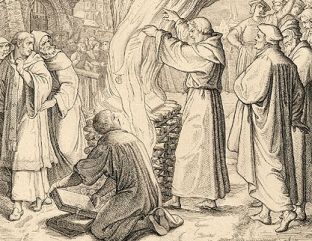
 En 1535, Jean Calvin quittait la France pour la Suisse, à la
suite de l'affaire des Placards, affiches qui critiquaient la messe de Eglise
catholique. La Suisse avait accueilli favorablement les idées de la Réforme. A
Genève, il commence à organiser l'Eglise évangélique, ce que les bourgeois
de la ville eux-mêmes souhaitaient.
En 1535, Jean Calvin quittait la France pour la Suisse, à la
suite de l'affaire des Placards, affiches qui critiquaient la messe de Eglise
catholique. La Suisse avait accueilli favorablement les idées de la Réforme. A
Genève, il commence à organiser l'Eglise évangélique, ce que les bourgeois
de la ville eux-mêmes souhaitaient.