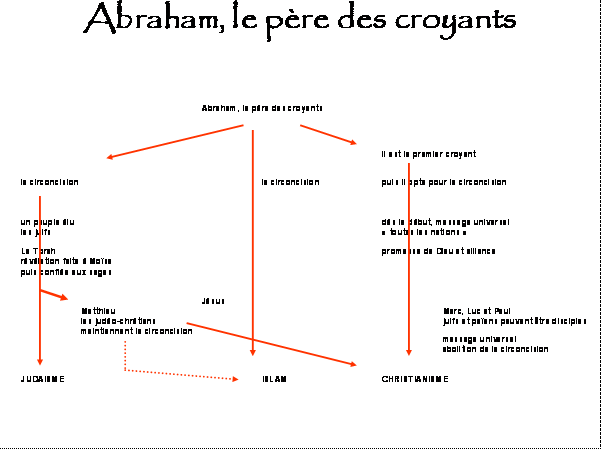
Les
religions abrahamiques
Trois
grandes religions, trois monothéismes, judaisme, christianisme et islam, se réfèrent
explicitement au même patriarche Abraham. Que ce soit par tradition, comme
les descendants d'Ismaël et d'Israël, que ce soit, comme les chrétiens, par
une filiation toute spirituelle, les uns et les autres se considèrent comme
des fils d'Abraham. Saint-Paul dira : "Ceux qui se réclament de la foi,
ce sont eux les fils d'Abraham".
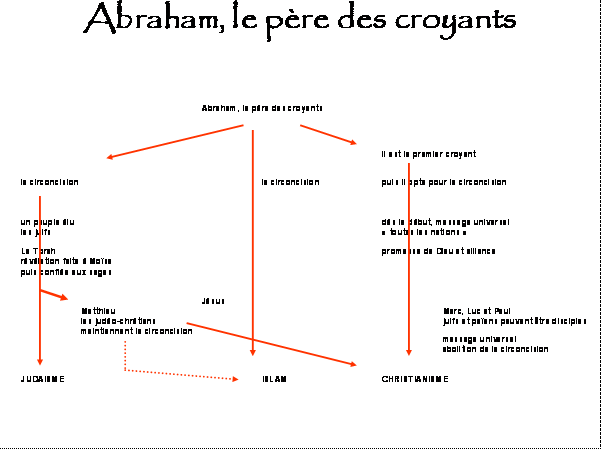
Ainsi
des millions de croyants se rejoignent dans le souvenir d'un même homme, père
de leurs peuples, mais aussi modèle de la foi au Dieu unique, essentielle à la
religion des uns et des autres. Le Coran le propose comme "un guide, un
homme docile à Dieu qui l'a choisi et guidé vers une Voie Droite".
Abraham (hébreu אברהם
abrāhām, père d'une multitude; arabe إبراهيم
الخالِد
Ibrāhīm
al-khālid,
Ibrahim l'inoubliable), est le nom d'un personnage de l'Ancien
Testament. Son histoire est racontée dans le livre de la Genèse
ainsi que dans le Coran.
La
filiation abrahamique
Pour
rapprocher les religions monothéistes, on utilise parfois l’expression de
« religions abrahamiques ». Dès lors, on ne cherche pas
l'identité fondamentale dans l'idée de Dieu (monothéisme), ni dans le mode
abstrait de connaissance (révélation), mais dans le concret, dans cet homme
particulier, Abraham, qui a reçu la connaissance de Dieu, et de qui dérivent,
par filiation charnelle ou par filiation spirituelle, les trois religions qui
permettent cette connaissance.

Selon
les traditions juive et musulmane, la filiation charnelle est indubitable :
Abraham est l'ancêtre charnel des juifs par Isaac, le fils de Sara, la femme légitime,
et celui des musulmans par Ismaël, par la servante Agar. Si certains, parmi les
premiers chrétiens étaient des juifs pouvant se réclamer de la filiation
charnelle, l’arrivée en masse de fidèles d'origine païenne a donné une
dimension spirituelle au rattachement à cet homme singulier qu’était
Abraham.
Parler
de « religion abrahamique » permet de se dégager de conflits qui
pourraient apparaître quand on parle de « religion révélée »,
puisque Dieu a manifesté sa présence à Abraham, ou encore quand on discute
sur le sens du terme « monothéisme », puisque, selon la Bible,
Abraham a quitté sa patrie, rompant avec les divinités mésopotamiennes, pour
obéir au Dieu unique.
Il
est un fait qui mériterait un plus grand examen, c’est celui de l’origine
historique même de l’islam. Lorsque Muhammad entreprit ses méditations
spirituelles, la Kaaba, le lieu saint d’Arabie, était remplie d'idoles et les
rites qui s’y déroulaient étaient purement païens. Méditant sur ce qu'il
savait, à travers les récits bibliques et les légendes juives, de
l'histoire d'Abraham, Muhammad découvrit des analogies entre les
circonstances de la vie d'Abraham et celles de sa propre vie. Il prit Abraham
pour prédécesseur privilégié et pour modèle, non sans se projeter lui-même
en Abraham. Du même coup, il remontait à la source des religions juive et
chrétienne, qui avaient été perverties et il pouvait alors exhorter tous
les croyants à revenir à la religion d'Abraham.
La
filiation charnelle permet de créer une parenté au plan de la religion. Mais
il faut savoir que l'héritage spirituel d'Abraham s'est transmis, non seulement
à Isaac et à ses descendants, mais aussi à Ismaël et à sa postérité. Ce
serait commettre une grossière erreur que de penser que les bénédictions
promises par Dieu aux fils d’Abraham ne dépassent pas le stade de constituer
de « grandes nations » au sens strictement historique ; ces bénédictions
engagent aussi un aspect spirituel, dans la mesure où ces « grandes
nations » se réfèrent à la vocation spirituelle du patriarche.
Néanmoins,
s’agit-il de la même « foi » qui anime les trois traditions
religieuses abrahamiques ? Quand on parle de foi, il faut toujours
distinguer la foi objective (ce que l’on croit, le contenu ou l’objet de la
foi, et la foi subjective (qui relève d’aspects plus psychologiques, la
persuasion, la confiance).
En
tant que phénomène humain, la foi revêt des aspects psychologiques voisins,
sinon identiques, dans les diverses religions. Le croyant a souvent une
conviction entière, immense... Il peut éprouver pour Dieu un vif sentiment,
non seulement de crainte et de révérence, mais aussi de reconnaissance,
d'intimité et d'amour, allant jusqu'à l'approche mystique. Ces sentiments,
ainsi que des attitudes et des pratiques diverses se rencontrent dans toutes les
religions. Mais ce qui caractérise en propre une foi, ce n’est pas son côté
subjectif, mais plutôt son côté objectif.

Que
dit la Bible de la foi d’Abraham ? Elle souligne qu’Abraham mit sa foi
en Dieu, qu’il quitta son pays, qu’il accepta la promesse presque impossible
d’avoir un fils et « cela lui fut compté comme justice » pour
reprendre une expression de saint Paul. Abraham n'est pas un prophète, il
n’est chargé d'aucun message à transmettre ; il a pour mission simplement d'être
le premier chaînon, l'origine de la lignée qui aboutira à un peuple.

Il
n'est demandé à Abraham qu’une seule chose : abandonner les assurances
humaines pour se tourner vers l'intervention divine, promise contre toute
vraisemblance et pour un jour lointain qu'Abraham ne verra pas lui-même. La foi
d’Abraham n’est pas foi en l'être de Dieu, mais en la promesse, sa foi est
attente, elle s'appelle espérance.

La
foi chrétienne, appuyée sur le Nouveau Testament, éclaire la conception de la
foi d’Abraham d’une autre manière, en donnant une impulsion à la promesse
qui lui a été faite : la terre promise à Abraham préfigure le Royaume
universel ; sa postérité, c'est Jésus-Christ, Roi de ce Royaume.
Mais
qu’en est-il alors de l’Abraham coranique ? Sa foi est une foi
intemporelle et abstraite en l'unicité de Dieu ; Abraham parvient à cette foi
par un raisonnement sur une expérience « naturelle ». Il cherche un
Seigneur et un Dieu, d'abord dans le ciel visible (il faut se souvenir que les
dieux du paganisme étaient souvent des dieux astraux), qu’il élimine tour
à tour, il comprend qu’aucun être visible n'est divin et ne peut être
« associé » à Dieu. Il se tourne vers celui qui a créé les cieux
et la terre, et c'est l’origine du monothéisme. Ensuite Abraham exhortera
son peuple et brisera les idoles. C’est de cette manière qu’il devient réellement
un prophète.
Dès
lors, il est facile de voir qu’il ne s’agit pas d’une seule et unique foi ;
elles ne sont pas apparentées simplement par le seul fait de revendiquer la
paternité d’Abraham. D’un côté, on souligne que le patriarche a été un
point de départ à la naissance d’un peuple qui allait se mettre en quête
de Dieu (en ce qui concerne le judaïsme) ou un ancêtre de Jésus-Christ
qui serait l’héritier d’Abraham (en ce qui concerne le christianisme) ; de
l’autre, on présente un prophète qui prêche un Dieu déjà conceptualisé.
Il y a parenté extérieure, mais une divergence intérieure.
Pour
en terminer avec les religions abrahamiques, il faut dire quelques mots des
rapports que le prophète de l’islam a pu avoir avec les communautés des
religions qui lui ont préexisté. Il est certain que Muhammad a connu les
textes saints des autres religions, qu’il a pu les utiliser dans son
enseignement. Relativement au christianisme, des chrétiens de condition modeste
et de tendances plus ou moins hétérodoxes ont pu lui faire connaître des
extraits des Evangiles canoniques ou apocryphes qui circulaient dans le
Proche-Orient. Mais cette connaissance est demeurée incomplète, en raison des
sources dont il disposait.
Rencontrant
les membres des chrétientés orientales Muhammad constate que les divergences
qui les opposent viennent du problème de « la nature » de Jésus
: qui est-il véritablement ? Est-il fils de Dieu ? Dieu lui-même ?
Quelle place accorder à Jésus ? Dans ce contexte le Prophète Muhammad,
veut honorer et réhabiliter Jésus et préciser sa mission.
A
y regarder d’un peu plus près, le fondateur de l'islam a subi l'influence du
nestorianisme, qui ne voit en Jésus seulement qu’une nature humaine, il a
connu le monophysisme, qui attribuait à Jésus une seule nature, d'essence
divine, il a été influencé par les docètes pour lesquels Jésus n’avait
qu’une apparence humaine. C’est dire qu’il n’avait que très peu de
connaissances précises sur le véritable christianisme, mais davantage avec
les sectes orientales issues de la première prédication des apôtres,
influencées surtout par les apocryphes qui circulaient à cette époque.

La première Église chrétienne se
trouve héritière du judaïsme. Ses croyances sont fondées sur la personne et
l'enseignement de Jésus-Christ. Elle se considère voulue et conduite par Dieu,
« instituée par le Christ ». Elle trouve toutefois plus précisément
son origine historique dans l'Église chrétienne latine qui s'est développée
en Occident à partir du deuxième siècle, qui est marqué par de nombreuses
ruptures appelées « hérésies ». Les
premières hérésies de la réflexion théologique portent sur la personne du
Christ. Des sectes se sont formées à partir de la reconnaissance de Jésus
comme du plus grand et du dernier des prophètes juifs, sans le reconnaître
comme Fils de Dieu. D'autres ont plus ou moins refusé de reconnaître le Christ
comme un homme : il est bien le Fils de Dieu, mais sa situation humaine n'est
qu'une apparence. Dans le même temps, se propageaient des doctrines remettant
en cause la notion de péché et élaborant des spéculations intellectuelles
sur la foi, ou niant purement et simplement le péché. D'autres opposaient à
Dieu une force contraire, situant Dieu, Bien souverain, dans une lutte perpétuelle
contre les forces du mal.
Une
hérésie est souvent, au départ, la défense véhémente et exclusive d'un
point partiel (quoique parfois authentique) de la Révélation, développant ce
point au détriment de l'équilibre de la foi.

La
gnose va être la première menace intérieure sérieuse pour le christianisme
du deuxième siècle. L’homme serait un être purement spirituel précipité
dans un monde matériel dominé par le mal (dualisme). C'est la connaissance
du divin qui lui permet de se libérer de son emprise terrestre. Connaître,
c'est donc être sauvé, et peu y parviendront. Le gnosticisme intègre le
Christ comme une émanation divine venu nous apprendre à nous libérer de la
matière par la connaissance, il nie l'Incarnation du Christ.
L'initiateur
de la gnose chrétienne Simon le magicien (mentionné dans le livre des Actes
8,9) en même temps qu’il est aussi l'initiateur de la simonie (le fait de
monnayer les biens spirituels). Simon se prend pour une manifestation du dieu
inconnu, descendu comme Fils chez les juifs, Père en Samarie, et Esprit-Saint
chez les autres peuples.
Les
manichéens ne constituent pas à proprement parler une hérésie du
christianisme mais d'un christianisme gnostique il est facile de glisser vers le
manichéisme. Mani professait qu'il y avait deux principes égaux : un Dieu
bon et un Dieu du mal au pouvoir duquel est le monde.
Aux
deuxième et troisième siècles se développe une doctrine selon laquelle, le
Fils ne s'est pas incarné mais a seulement pris une apparence humaine. Le docétisme
:
L'Arianisme
part d'une simple constatation de bon sens : comment Dieu peut-il être un et
trois à la fois ? Arius, prêtre d'Alexandrie répond que le Verbe (le Christ)
n'est qu'une créature, n'ayant reçu le privilège d'être Fils que par
adoption. La foi trinitaire n'ayant pas encore reçu de formulation définitive
à cette époque, la crise va se propager dans tout l'Orient au point que
l'empereur Constantin décidera d'intervenir en convoquant le concile de
Nicée, le 20 mai 325. Arius sera exilé et excommunié.
Lorsque
les fils de Constantin se partagèrent l'Empire, la situation provoquée par
l'arianisme s'aggrava, et ce, malgré les décisions prises au concile de Nicée.
C'est ainsi que les divisions entre ariens et Nicéens (tenants de l'orthodoxie
chrétienne définie au concile de Nicée) s'accentuèrent. Dans ce contexte
politique et théologique troublé, l'empereur Théodose finalement décida de
convoquer un concile afin d'obtenir le retour à la paix religieuse et à
l'orthodoxie définie par le concile de Nicée en 325. L’orthodoxie de la foi
telle qu'elle avait été définie à Nicée rejetait l'arianisme. Or les ariens
avaient depuis réussi à s'imposer à Constantinople, où ils s'étaient emparés
de toutes les églises. L'évêque lui-même était arien, lorsque Théodose accéda
au pouvoir, en 379 !
En
381, le concile de Constantinople clarifiera certains points que le concile de
Nicée n'avait pas assez développés
Il
proclame que le Père et le Fils étaient de même nature. De plus, le concile
de Constantinople juge nécessaire de compléter le symbole de Nicée, en
affirmant clairement la divinité du Saint-Esprit (le Saint-Esprit « procède
du Père..., avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire »).
Le
concile de Nicée avait déclaré solennellement que le Fils était de même
nature (consubstantiel) que le Père et donc qu'il était Dieu. Cinquante
ans plus tard, le concile de Constantinople déclarait, non moins
solennellement, que le Saint-Esprit était de même nature (consubstantiel) que
le Père.
Du
quatrième au huitième siècle une tension dans l'église entre l'Est et
l'Ouest se fait jour à propos du vrai sens de la primauté de Rome. Cette
tension latente apparaît en surface au neuvième siècle pour devenir une
hostilité ouverte. L'événement politique qui a occasionné ce conflit fut la
fondation de l'empire carolingien dans l'Ouest.
La séparation entre l’Orient et
l’Occident devient de plus en plus sensible. Auparavant, ce n’était
qu’une question de langue (grec d’un côté, latin de l’autre), désormais
l’affaire sera aussi théologique, en plus de la question politique :
deux empires se font face dans une unique chrétienté… Si auparavant, on ne
se fréquentait guère, désormais on s’observe et on se méfie l’un de
l’autre, alors qu’il fallait s’unir davantage face à la montée de
l’islam…
L’Islam apparaît au septième siècle
au Moyen Orient et en Méditerranée. L'année de l'hégire est donc 622 de
notre ère et c'est à Médine que Mahomet est reconnu comme prophète. En
quelques décennies, l'Islam s'impose dans la péninsule arabique, puis le
long de la côte nord africaine, puis vers l'Asie mineure. La rivalité entre
les deux religions est frontale : la parole du prophète s'étend très rapidement,
avec des moyens militaires alors que la chrétienté s’est d’abord répandue
pacifiquement. La poussée musulmane s'exerce moins en direction de l'Europe
occidentale que vers Constantinople, qui repousse la flotte arabe par trois fois
en 674, en 678, et puis encore en 718. Plus que Charles Martel, c’est l’échec
arabe devant Constantinople qui a stoppé la progression des Arabes en Europe.
L'échec du siège de Constantinople par les armées arabes sauve Byzance mais
sauve aussi la chrétienté. L'empire byzantin devient l'héritier politique
de l'Empire romain d'Occident, lorsque ce dernier disparaît au cinquième siècle.
Jusqu’au onzième siècle, il restera le bastion de la chrétienté, ce que ne
reconnaîtra jamais Rome.
En 630, le grec devient langue officielle
de l'empire Byzantin. Et le fossé entre l'occident (parlant latin) et l'orient
(parlant grec) se creuse, à tel point que la religion catholique se scinde en
deux (ce qu'on appelle schisme) : à l'ouest, les catholiques romains, à
l'est, les catholiques orthodoxes. Deux mondes qui ne se comprennent toujours
pas actuellement... Les orientaux traiteront toujours les occidentaux de
barbares.
Le
roi des Francs, Charles,
fils de Pépin le Bref, est couronné à Rome par le pape Léon III à la Noël
800. En remerciement des services rendus à la papauté et notamment de l’élimination
des Lombards, il reçoit du souverain pontife le titre inédit d’ « Empereur
des Romains ». La cérémonie se déroule dans la basilique Saint-Pierre,
en présence d’une nombreuse délégation de Francs.
La profession de foi (ou credo) des
conciles de Nicée
(325) et Constantinople
(381) dit très clairement : « Je crois en l'Esprit Saint qui procède du
Père ». Charlemagne use de son influence pour le faire imposer définitivement.
En 806, Charlemagne,
fait chanter le Credo avec le « Filioque » et le fait adopter en 809
pour toute l’Eglise franque au Concile d’Aix
la Chapelle. Après de nombreuses querelles idéologiques, Henri II
de Germanie, en 1014, obtient du pape, Benoît VIII, pour la messe de son
couronnement impérial à Rome, l’adoption du « Filioque » pour
toute la liturgie catholique romaine. Pour les orientaux, il s'agit d'une hérésie
et d'une trahison des décisions des conciles oecuméniques. La mention du pape
fut supprimée dans la liturgie. A partir de ce moment, la communion entre
Rome et Constantinople cessa.
Une grave querelle éclata entre les
Normands et les Grecs d'Italie ; elle eut pour effet la fermeture des églises
latines de Constantinople en 1052. Le patriarche s'efforça cependant de rétablir
la paix l'année suivante. De son côté, en 1054, le pape envoya trois légats
dont le chef était le cardinal Humbert. Le contact entre les deux partis fut
peu charitable et dès lors le patriarche refusa tout nouveau contact avec les légats.
Le « Filioque » joua un rôle
important au cours des événements tumultueux de 1054, lorsque des représentants
des Églises orientales et occidentales s’excommunièrent mutuellement. Le
cardinal Humbert de Silva Candida, légat du pape Léon IX, dans le contexte des
anathèmes qu’il lança contre le patriarche Michel Cérulaire de Constantinople
et certains de ses conseillers, accusa les byzantins d’avoir supprimé indûment
le Filioque du Credo et critiqua d’autres usages liturgiques orientaux.
En réponse à ses accusations, le
patriarche Michel se rendit compte que les anathèmes lancés par Humbert n’étaient
pas le fait de Léon IX, et il lança ses propres anathèmes contre la seule délégation
du pape. Léon, en effet, était déjà mort et n’avait pas encore de successeur.
Le patriarche Michel condamna en même temps l’emploi occidental du Filioque
dans le Credo, de même que d’autres usages liturgiques occidentaux. Le 16
juillet 1054, le cardinal Humbert perdit patience et déposa sur l'autel de
Sainte Sophie en pleine célébration une bulle d'excommunication
pour Michel Cérulaire. Le lendemain, une assemblée d'évêques, déniant au
pape le droit d'intervenir sur les questions d'investiture, jetait le document
romain au feu et excommuniait Humbert et sa suite. Par ailleurs,
l'accumulation des divergences théologiques relatives à la procession du
Saint-Esprit, à l'épiscopat, à la primauté de Rome et aux usages liturgiques
aggrava l'opposition entre Constantinople et Rome.
Les croisades rendirent le schisme définitif
en introduisant un esprit de haine et d'amertume, dans la conscience du peuple.
Ainsi le de Constantinople, en 1204, ne fit qu'intensifier l'hostilité de l'Église
orientale à l'égard de l'Église d'Occident. Huit cents ans ont passé depuis
la quatrième Croisade de 1204, c’est-à-dire depuis le moment où les milices
chrétiennes d’Occident, parties pour libérer les Lieux saints, préférèrent
changer leur destination, dévier de leur route et saccager Byzance pour rentrer
ensuite rapportant avec elles un butin d’or et de marbres destiné à embellir
les églises de Venise. Tout le second millénaire chrétien se déroulera sous
le signe de la division entre l’Église d’Occident et celle d’Orient. Ce
n'est qu'à partir du concile Vatican II (1962-1965) que s'esquissa une nouvelle
tendance au rapprochement : en 1964, le patriarche Athénagoras et le pape Paul
VI décidèrent de lever les anathèmes réciproques lancés en 1054. En se
donnant l’accolade, Athénagoras et Paul VI à Jérusalem, le 5 janvier 1964,
manifestaient que l’inimitié entre les frères n’était ni irréversible ni
éternelle.
En 1453, les Turcs s'emparaient de
Constantinople et l'Église byzantine était asservie par l'Empire ottoman.

En Occident, les choses ne vont pas
tarder à se gâter. D'abord pendant quarante ans (1377-1417), le trône de
Pierre sera l'objet d'une rivalité incessante entre plusieurs pontifes, appuyés
par telle ou telle puissance d'Europe. Il conviendra également de se souvenir
que la papauté, au cours du Moyen Age et de la Renaissance, ne fut pas toujours
d'une conduite exemplaire pour l'ensemble de la chrétienté. Ce qu'il est
convenu d'appeler la Réforme n'est pas simplement l'oeuvre de Martin Luther
(1483-1546) ou d'un Jean Calvin (1509-1564). Elle a connu des antécédents
comme John Wyclif et Jean Huss (au quatorzième siècle) ; ces derniers s'élevaient
contre les abus des autorités pontificales. Le réveil, deux siècles plus
tard, de leurs théories condamnées par l'Eglise, n'est pas sans rapport avec
une crise politique qui secoue l'Europe, la réveillant contre la suprématie
abusive des papes. De fait, Martin Luther sera le catalyseur de ceux qui estiment
que l'Eglise oublie le spirituel pour ne plus s'intéresser qu'au temporel. La
querelle des Indulgences ne sera que le prétexte qui mettra le feu aux poudres.
En 1505, le pape Jules II avait décidé
de faire construire une nouvelle basilique de Saint-Pierre à Rome. Selon la
coutume des siècles précédents, il entreprit de distribuer des indulgences plénières
à ceux qui, s'étant confessé et ayant reçu la communion, ajoutaient une
offrande en argent pour permettre la réalisation de ce grand projet. Cette
campagne des indulgences ne se répandit en Allemagne du Nord qu'en 1517. La
première manifestation de Luther sur la scène publique a lieu la veille de
la Toussaint de cette même année ; alors, en Saxe, on se préparait à la fête
de la Toussaint, en se confessant, et en vénérant quelques dix-sept mille
reliques, rapportant plus de cent vingt mille années d'indulgences, pouvant
transférer rapidement les âmes des défunts du purgatoire au paradis. Depuis
un an déjà, Luther prêchait contre les indulgences et cherchait à connaître
l'enseignement traditionnel de l'Eglise sur ce sujet. Il avait écrit au
prince et à l'archevêque de Mayence ses réflexions sur cette vente des Indulgences.
Devant la grande préparation de la Toussaint 1517, il rédige une série de
propositions : quatre-vingt quinze thèses qui auraient été affichées, si on
en croit la tradition, aux portes de l'Eglise du château de Wittenberg.
Ces quatre-vingt quinze propositions
n'apportaient aucun enseignement nouveau, elles rappelaient simplement
l'enseignement de l'Eglise depuis les premiers siècles : comment pourrait-on
acheter, à prix d'argent, une grâce de salut que Dieu accorde librement par la
mort du Christ sur la croix ? Mais, le pape, pas plus que ses collaborateurs,
ne se souciait d'un débat idéologique, d'une discussion théologique, trop
occupé qu'il était du gouvernement intérieur de l'Eglise et des pays qui se
trouvaient sous sa coupe. Sommé de rendre compte publiquement de ses thèses à
Rome, alors que le pape avait sans doute été mal informé, Luther refusa de se
rétracter, tant qu'il ne serait pas convaincu, par ses opposants, au moyen des
seules preuves tirées de Écriture, de l'authenticité de leurs affirmations
concernant les indulgences. Comme Eglise de Rome n'était pas disposée à
reconnaître qu'elle pouvait s'être trompée, en menant son existence sans référence
constante à l'Évangile, une bulle d'excommunication contre Luther "Decet
Romanum pontificem" fut signée par le pape en 1521. Par ailleurs, Luther,
excédé, avait fini par douter de l'infaillibilité des conciles universels
eux-mêmes ; il s'attaquait au magistère doctrinal de Eglise, en affirmant que
l'on ne pouvait garder comme vérité absolue que ce qui pouvait être tiré
de Écriture seule. Désormais, le mouvement déclenché par Luther échappait
à la personne du réformateur pour accomplir son destin propre. La référence
à Écriture, comme seule norme, pouvait permettre toutes les interprétations.
Aussi le mouvement luthérien ne pouvait-il pas garder longtemps l'inspiration
de son fondateur.
En 1535, Jean Calvin quittait la France
pour la Suisse, à la suite de l'affaire des Placards, affiches qui critiquaient
la messe de Eglise catholique. La Suisse avait accueilli favorablement les idées
de la Réforme. A Genève, il commence à organiser l'Eglise évangélique, ce
que les bourgeois de la ville eux-mêmes souhaitaient.
Les Genevois s'organisèrent en une
communauté qui n'est pas sans rappeler la communauté des premiers chrétiens ;
Calvin donna une constitution à l'Eglise de cette ville. Si la Réforme, sous
la conduite de Luther puis de Zwingli, s'était distinguée dans l'ensemble de
l'Eglise d'Occident par sa recherche théologique, elle devient, avec Calvin,
une démarche pratique. Pour lui, la spéculation intellectuelle compte moins
qu'une existence menée à la lumière de Évangile Calvin est, avant tout, un
homme d'action, un réalisateur ; sa formation de juriste l'aidera à établir
une sorte de société théocratique. L’Eglise qu'il fonde ainsi est une
Eglise de saints, le rassemblement des élus, et non pas seulement une Eglise de
la foi où le croyant cherche à obtenir le salut personnel par sa confiance
en Dieu.
Une nation allait aussi adopter les
principes de la Réforme, même si elle ne se place pas immédiatement dans l'idéologie
des grands réformateurs. La dénomination d'Eglise anglicane ne date pas de
la Réforme. Avant 1521, elle marquait simplement l'unique Eglise d'Angleterre
en communion avec le siège de Rome. Seulement quarante ans plus tard, cette même
dénomination va désigner une Eglise à part, détachée de Rome, établie par
un acte du Parlement, soumise au roi d'Angleterre. Par ses origines, comme par
ses développements ultérieurs, l'Eglise anglicane ne peut que difficilement
être située dans le courant théologique de la Réforme, et, d'une certaine
manière, l'anglicanisme peut paraître comme l'Eglise séparée de Rome, mais
qui reste la plus proche du siège apostolique de Pierre. C'est que la séparation
de 1534 se situe davantage sur le plan de la juridiction de la papauté que sur
celui de la théologie chrétienne. Sur le continent, les réformateurs furent
des hommes de doctrine, des théologiens avant d'être des hommes d'action ; en
Angleterre, il n'y eut rien de comparable, puisque les meneurs sont d'habiles
politiques, qui s'affranchissent de la tutelle de Rome, bien avant de se
constituer une référence dans des écrits.
La Réforme constituait une provocation sérieuse
dans la vie de l'Eglise catholique ; une réponse à cette scission devenait nécessaire
; elle se fit attendre, car les responsables ecclésiastiques n'ont certainement
pas mesuré, sur le coup, la gravité de la situation dans laquelle la chrétienté
risquait de s'enliser. Seul, un nouveau concile oecuménique semblait être
susceptible d'apporter une solution satisfaisante à ce problème qui intéressait
l'ensemble de la chrétienté. Les chrétiens ressentaient l'urgence d'un tel
rassemblement des évêques, non seulement pour examiner la question luthérienne,
mais surtout pour apporter des réformes décisives dans la vie de l'Eglise.
Pourtant, la papauté hésita longuement avant de convoquer cette assemblée
conciliaire. Néanmoins, Paul III se décide, en mai 1542, à convoquer une
assemblée oecuménique à Trente. Ouvert en 1545, le concile allait se
prolonger jusqu'en 1563, mais avec de nombreuses interruptions.
Malgré les longs travaux du concile de
Trente, la restauration de l'unité chrétienne ne se fit pas ; au contraire, la
division fut même mise en évidence par des définitions dogmatiques que les
protestants ne pouvaient accepter ; le concile affirme qu'il existait deux
sources à la vérité chrétienne, Écriture sainte, mais aussi les traditions
de Eglise, comme les écrits patristiques ou le magistère pontifical et
conciliaire... Les pères conciliaires de Trente définirent aussi la sacramentalité
chrétienne, en insistant particulièrement sur la doctrine catholique de
l'eucharistie, en réaction aux propositions de Luther.
Ce concile de Trente peut se concevoir
comme la réponse toute négative du catholicisme à l'oeuvre de la Réforme
protestante ; il est même parfois présenté comme le concile de la « Contre-Réforme »
catholique, en raison de la présentation très juridique et disciplinaire des décisions
qui furent les siennes.
La mise en application des décisions
conciliaires revint à Pie V (1566-1572), dont un ambassadeur vénitien disait
qu'il avait transformé Rome en un véritable cloître, car ce pape voulait
maintenir la foi dans toute sa pureté. Pour unifier l'Eglise catholique, il
entreprit la réforme de sa liturgie, en l'unifiant. En 1566, il fit publier
un Catéchisme romain qui devait servir de base à la formation de tous les
chrétiens par le clergé paroissial ; en 1568, il publia le Bréviaire romain,
accordant une grande place aux textes de Écriture ; en 1570, il fit paraître
le Missel romain. Cette oeuvre d'unification liturgique fut poursuivie sous les
pontificats suivants. Grégoire XIII (1572-1585) acheva la révision du code de
droit canon entreprise par son prédécesseur ; mais ce pape a vu son nom
immortalisé par la réforme qu'il entreprit de mener à bien, celle du
calendrier ; le 24 février 1582, il décida que pour remédier aux erreurs du
calendrier julien, le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 octobre. Les états
catholiques admirent immédiatement cette réforme ; les états protestants et
orthodoxes conservèrent leur ancien calendrier de peur de voir le pape prendre
encore de l'autorité sur eux...
A la fin du seizième siècle, la chrétienté
universelle se trouve ainsi divisée en trois grandes zones d'influence. L'Orient
demeure fidèle à l'orthodoxie de Constantinople ; l'Occident chrétien se sépare
entre les fidèles qui reconnaissent l'autorité du pape et qui se regroupent
ainsi dans le catholicisme romain et les fidèles qui refusent de reconnaître
l'autorité du pape dans la vie de leurs Églises locales et qui se regroupent
alors dans des communautés séparées, qui seront plus simplement rassemblées
sous le nom de « protestantisme », nom générique donné
indistinctement aux Églises chrétiennes issues de la Réforme.